Comment mettre en place une communauté d’énergie en Wallonie ?
Comment mettre en place une communauté d’énergie en Wallonie ?
Webinaire Energie+ du jeudi 8 décembre 2022



Le système énergétique actuel est en pleine transformation et tend vers toujours plus de décentralisation. Ceci s’explique notamment par une volonté citoyenne grandissante de participer à la transition énergétique amorcée il y a quelques années. En plus de cela, beaucoup d’entreprises et de particuliers ont pour objectif de décarboner leurs consommations énergétiques en ayant recours à des énergies vertes plus respectueuses de l’environnement.
En réponse à ces volontés, le modèle de partage d’énergie apparaît comme une solution tout à fait adéquate. Le partage d’énergie peut prendre différentes formes. Elles reposent toutes sur la mutualisation des moyens de production et de stockage de l’électricité((https://www.cwape.be/node/158)).
Autoconsommation individuelle/collective – L’autoconsommation correspond à la production plus ou moins égale à la consommation d’énergie renouvelable par un foyer ou un immeuble collectif .L’énergie produite est consommée localement et instantanémentà l’échelle du bâtiment.
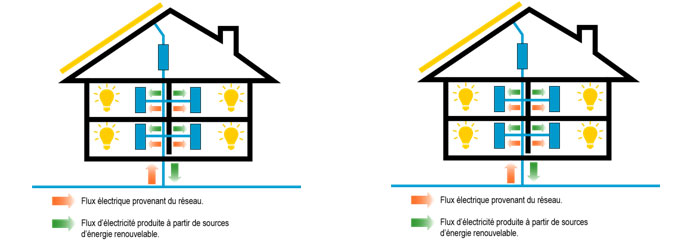
Communauté d’énergie renouvelable – Les CER ont pour but de produire, consommer, stocker et vendre de l’électricité. Elles peuvent regrouper des particuliers, des petites et moyennes entreprises et des autorités locales. Un périmètre local est défini par le Gouvernement, en accord avec le gestionnaire du réseau concerné. Ce périmètre doit se situer en aval de postes publics de transformation électrique. Il est défini en fonction de la pertinence de la production d’électricité dans ce périmètre et de l’autoconsommation collective locale potentielle. Les unités de production produisent de l’énergie renouvelable et peuvent être installées sur les bâtiments ou librement sur le périmètre local((Bricourt, P. (2021, 30 mars). Feedback : Webinar – Les communautés d’énergie, outil pour la transition énergétique ? Ma CER. https://macer.clustertweed.be/2021/05/01/feedback-liege-creative/)).
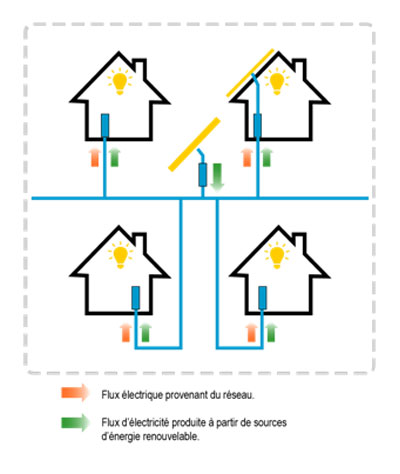
Communauté d’énergie citoyenne – Aucune restriction n’est prévue en ce qui concerne les participants potentiels à une communauté d’énergie citoyenne. En revanche un contrôle effectif devra être réalisé par des personnes physiques. Dans ce type de communautés, et seulement dans celles-ci, la production d’électricité à partir de sources non renouvelables est autorisée. Le périmètre de la communauté n’est pas non plus limité. Tout comme pour les CER, les installations ne seront pas forcément liées à des bâtiments.
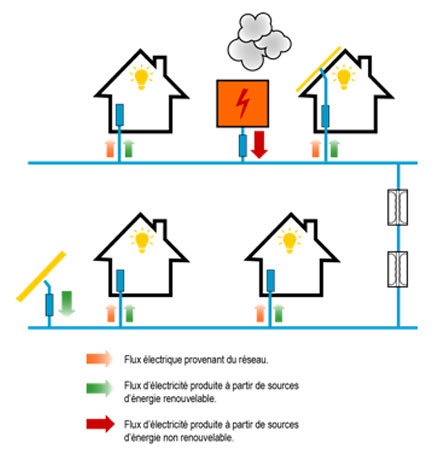
Les partages d’énergie fonctionnent selon quelques grands principes repris en détail sur le site https://macer.clustertweed.be/. Ce site internet dédié spécifiquement aux communautés d’énergie renouvelables reprend toutes les informations nécessaires sur le sujet. De plus, le gouvernement est actuellement en cours d’élaboration d’un décret visant à encadrer les échanges et partages d’énergie. Pour en savoir plus sur la réglementation et son application, consultez cette page.
En résumé, il existe5 critères principaux qui cadrent les communautés d’énergie renouvelables :
Pour qu’un partage d’énergie soit pertinent, il est évident que celui-ci doit répondre à quelques principes importants:
Les membres de la communauté ayant chacun des besoins et des consommations en électricité différentes, la question de la proportion de l’énergie produite par les installations communes distribuée à chaque consommateur doit être analysée afin de garantir le bon fonctionnement de la collectivité.
Le partage s’effectue tous les quarts d’heure par le réseau public, à l’aide de compteurs intelligents selon le mode de répartition choisi par la communauté. Attention toutefois que ces modèles sont évidemment théoriques, ils ne représentent en aucun cas le trajet des électrons réellement en mouvement dans le réseau.
Plusieurs modes de répartition sont envisageables, ayant chacun des points forts et des points faibles:
Modèle fixe
Un pourcentage fixe de l’injection totale d’énergie est attribué à chaque participant, selon des critères prédéfinis. Cette quote-part peut être fonction de la puissance de soutirage de chaque consommateur, du tarif d’achat, de la consommation individuelle ou encore de l’investissement de chacun dans le projet d’installation d’énergie renouvelable commune.
Ce type de répartition peut engendrer de fortes disparités entre les gros et petits investisseurs, risquant d’exclure de la communauté les personnes en situation de précarité énergétique. De plus, dans un modèle de répartition fixe, il existe un grand risque de surplus résiduel non autoconsommé si le consommateur ayant la plus grosse part ne consomme pas l’intégralité de ce qui lui est attribué. Lorsque celui-ci est absent ou consomme moins durant un intervalle de temps, le surplus est renvoyé sur le réseau, alors que d’autres membres de la communauté pourraient en bénéficier.
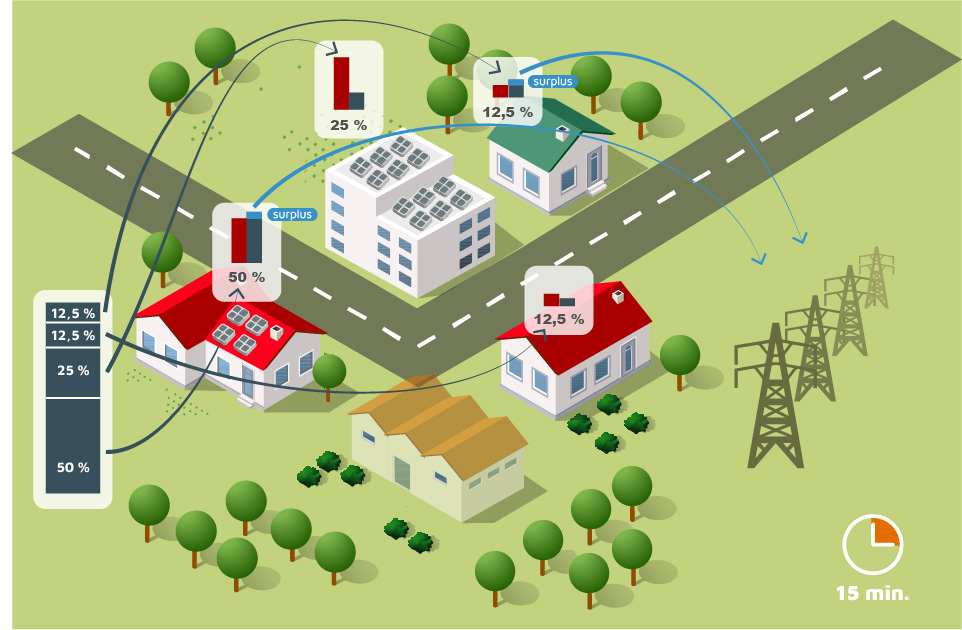
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Parts attribuées
Modèle équitable
La production est répartie de manière égale entre chaque participant ayant une consommation non-nulle au moment de la répartition. Cette manière de répartir l’énergie produite provoque moins de discriminations entre participants de la communauté. De la même manière que pour le modèle fixe, le risque de surplus non autoconsommé est grand, même lorsque la quantité d’énergie produite est inférieure à la consommation totale de la communauté.
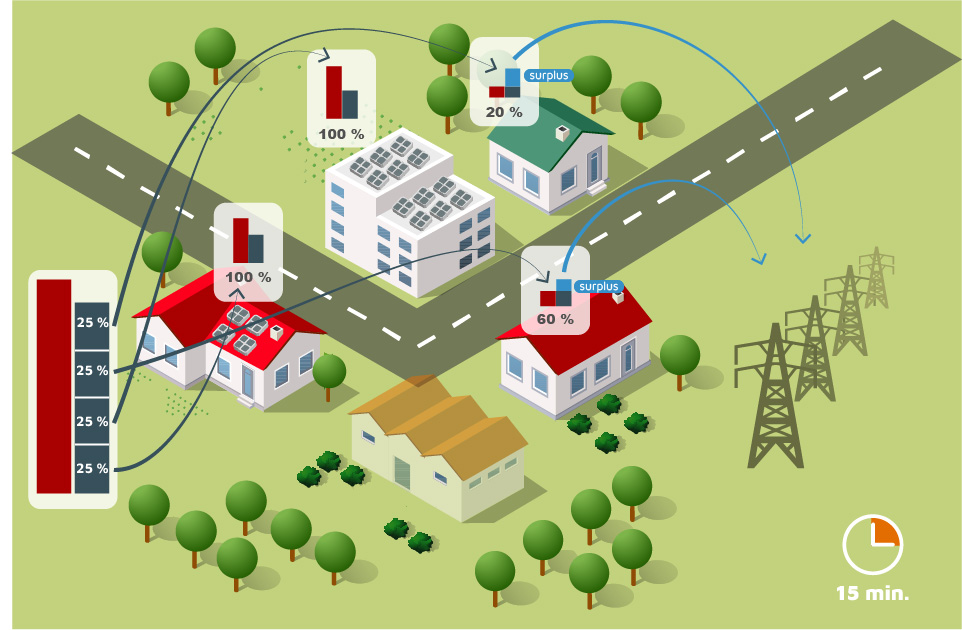
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Autoconsommation collective
Modèle au prorata
Répartition au prorata de la consommation individuelle par rapport à la consommation totale de la communauté. Répartir l’énergie selon ce modèle permet d’utiliser l’entièreté de la production, sans injection vers le réseau BT. L’énergie mise à disposition de chaque membre de la communauté est proportionnelle à sa consommation propre. Toutefois, ce modèle provoque des discriminations envers les personnes faisant des efforts d’économie d’énergie. En effet, les clients résidentiels consommant peu sont incapables de couvrir l’entièreté de leurs besoins, face aux gros consommateurs journaliers de la communauté (restaurants, écoles, bâtiments publics…).
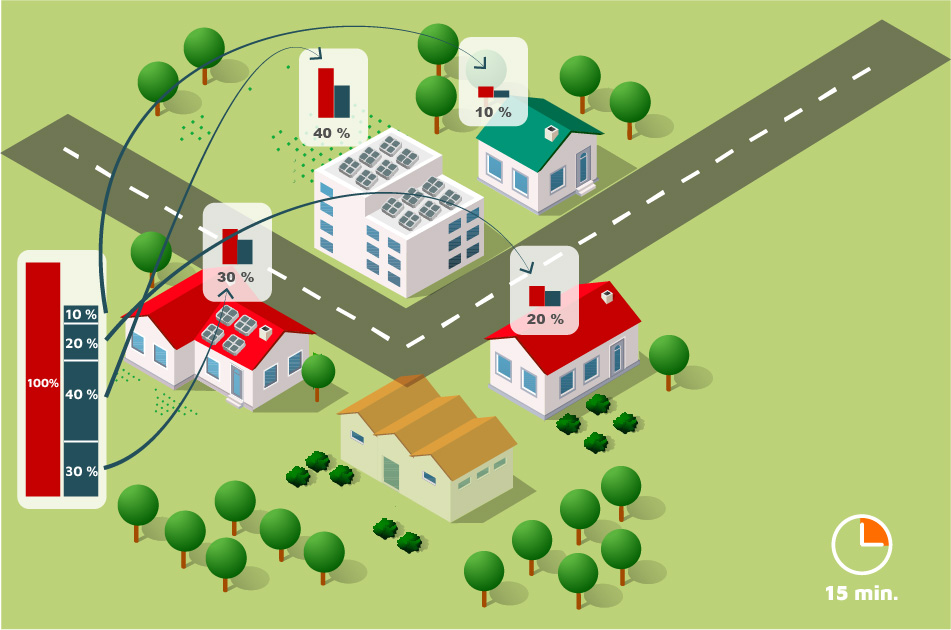
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.
Modèle hybride
Répartition de la production en deux temps: d’abord une répartition équitable, ensuite une répartition au prorata. Le surplus non autoconsommé des membres ayant été satisfaits lors de la première répartition est réparti par la suite entre les consommateurs ayant une consommation toujours non-nulle au second tour. Durant la première étape de répartition, tout le monde reçoit la même quantité d’énergie, permettant ainsi aux plus petits consommateurs de la communauté d’atteindre une meilleure autosuffisance. Les plus gros consommateurs sont encore une fois favorisés lors de la deuxième phase de répartition((Frippiat, J. (2020, juin). Autoconsommation collective, le partage de l’énergie au sein d’une communauté (Mémoire). https://hera.futuregenerations.be/fr/portal/publication/autoconsommation-collective-le-partage-de-lenergie-au-sein-dune-communaute)).
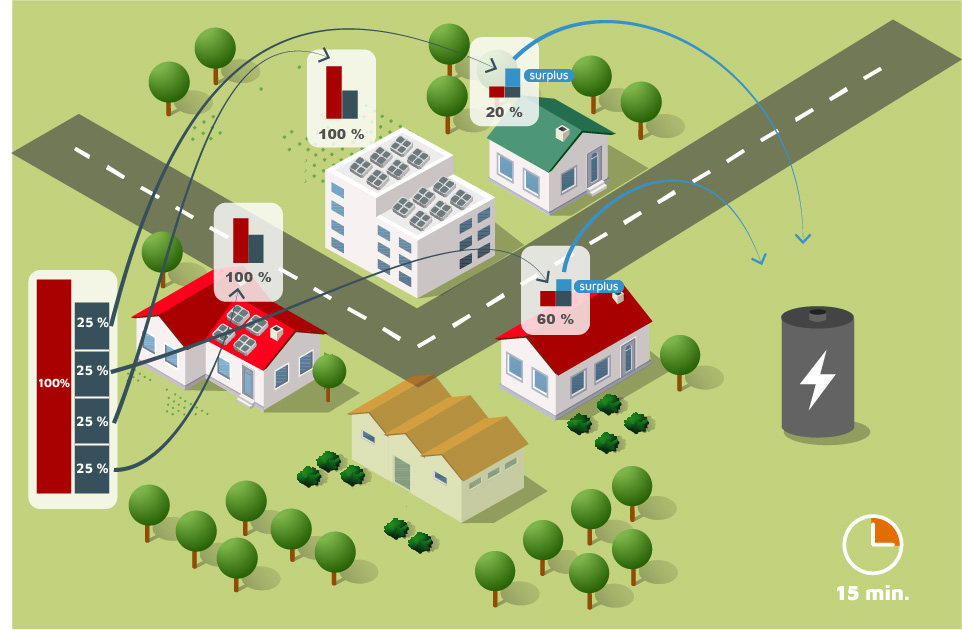
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Autoconsommation collective
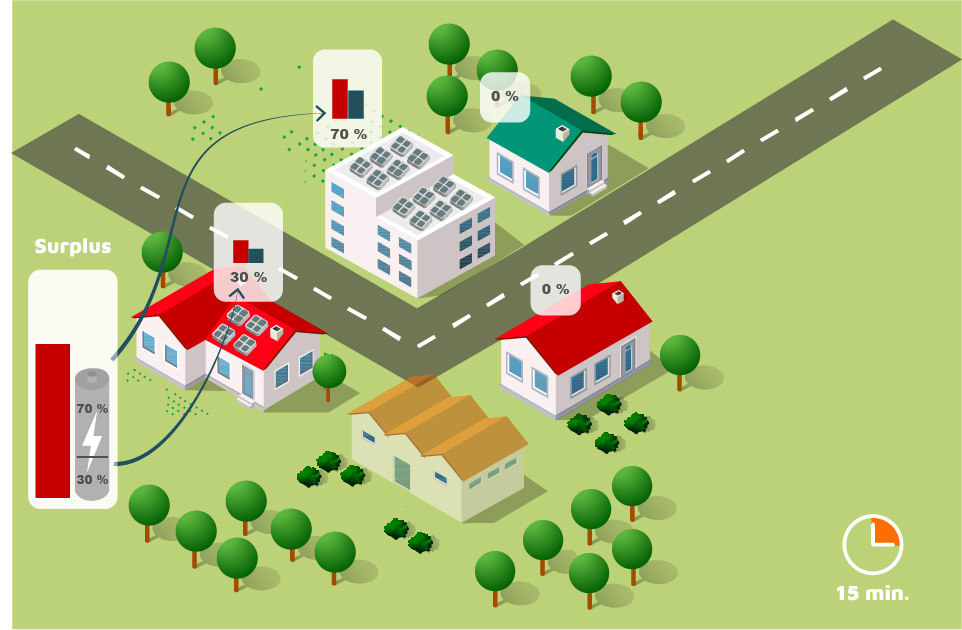
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.
Modèle en cascade
Enchaînement de répartitions équitables entre les consommateurs ayant une consommation non-nulle. Le surplus non autoconsommé par certains au tour précédent sera redistribué équitablement lors du prochain tour vers d’autres consommateurs de la communauté. Dans ce modèle, on ne sait donc jamais le nombre d’itérations successives nécessaires avant que l’énergie produite soit totalement consommée par la communauté (ou renvoyée sur le réseau)((Communautés d’énergie et autoconsommation collective : partageons nos énergies ! (2020, 18 décembre). SPW Wallonie. https://energie.wallonie.be/fr/18-12-2020-communautes-d-energie-et-autoconsommation-collective-partageons-nos-energies.html?IDD=146181&IDC=8187)).
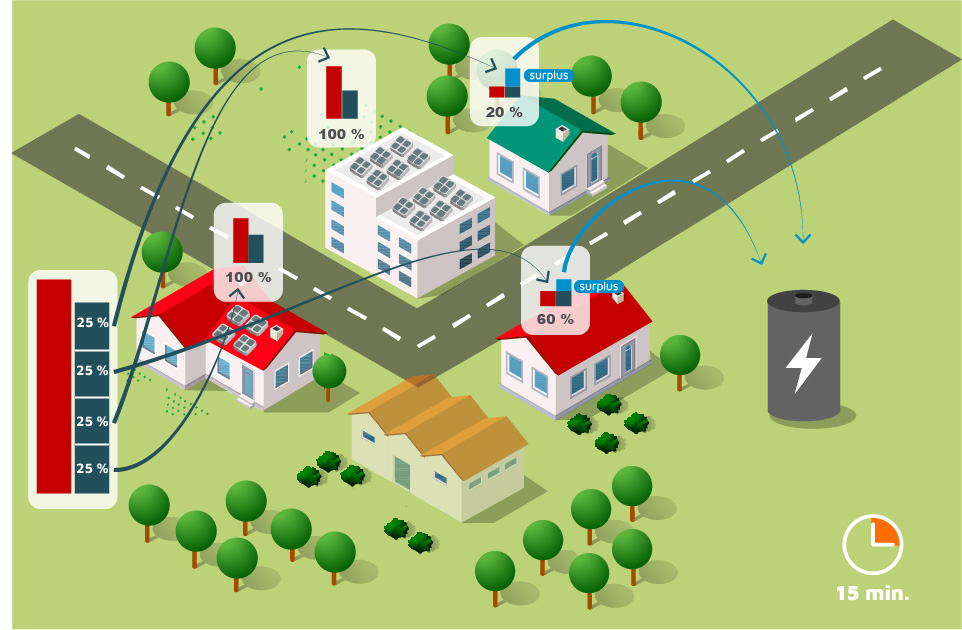
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Autoconsommation collective
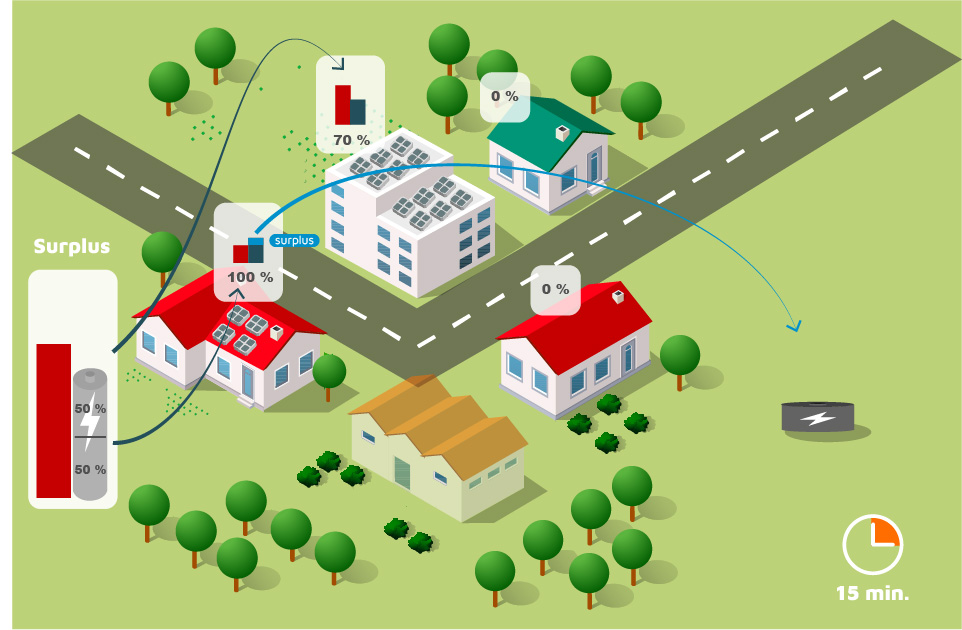
Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.

Rouge = Consommation de la communauté
Bleu foncé = Production de la communauté
Bleu clair = Surplus non autoconsommé
Pourcentage = Conso. inst. / Conso. tot.
Avantages
Inconvénients


Améliorer les performances de l’enveloppe de son bâtiment semble être une des mesures les plus efficaces et courantes dans un projet de rénovation. Toutefois, dans une démarche zéro carbone, on ne peut se contenter d’une simple augmentation de l’épaisseur d’isolant. Il est aussi primordial de limiter les impacts de l’utilisation des matériaux de construction.
En Europe, on estime que le secteur de la construction est responsable de la consommation de 40% des ressources matérielles et de 35% de la production de déchets.
L’énergie est un enjeu majeur des crises géopolitiques mondiales. Le réchauffement climatique et les autres pollutions menacent nos environnements naturels, et mènent à des crises humanitaires, sociales, économiques qu’on ne peut ni nier ni négliger.
Économiquement, les matériaux représentent un marché important, et une part non négligeable du budget d’un bâtiment. Par le choix des matériaux, le maître d’ouvrage se positionne en consommateur et possède de ce fait un pouvoir sur le marché, et la société qui y est liée. La valorisation de critères environnementaux et sociaux pour le choix des matériaux de construction est donc un levier pour un changement global de la société vers un monde plus durable.
Les multiples impacts des matériaux ainsi que le pouvoir de « consommacteur » qu’il donne au maître d’ouvrage en font un des enjeux d’un projet d’école durable.
Le lien entre les matériaux de construction et la santé des travailleurs et des occupants est aussi à considérer dans le choix. Les matériaux composites, synthétiques, issus de la chimie industrielle, peuvent émettre des polluants atmosphériques, dont l’impact négatif sur la santé est avéré. Les matériaux de finition intérieure, qui ont un impact direct sur la qualité de l’air intérieur, seront choisis avec soin.
Afin de prendre en compte l’impact au sens large de ces matériaux de construction, de nombreuses actions sont à envisager, elles sont reprises sur cette page [site Rénover mon école] et à travers ce schéma :
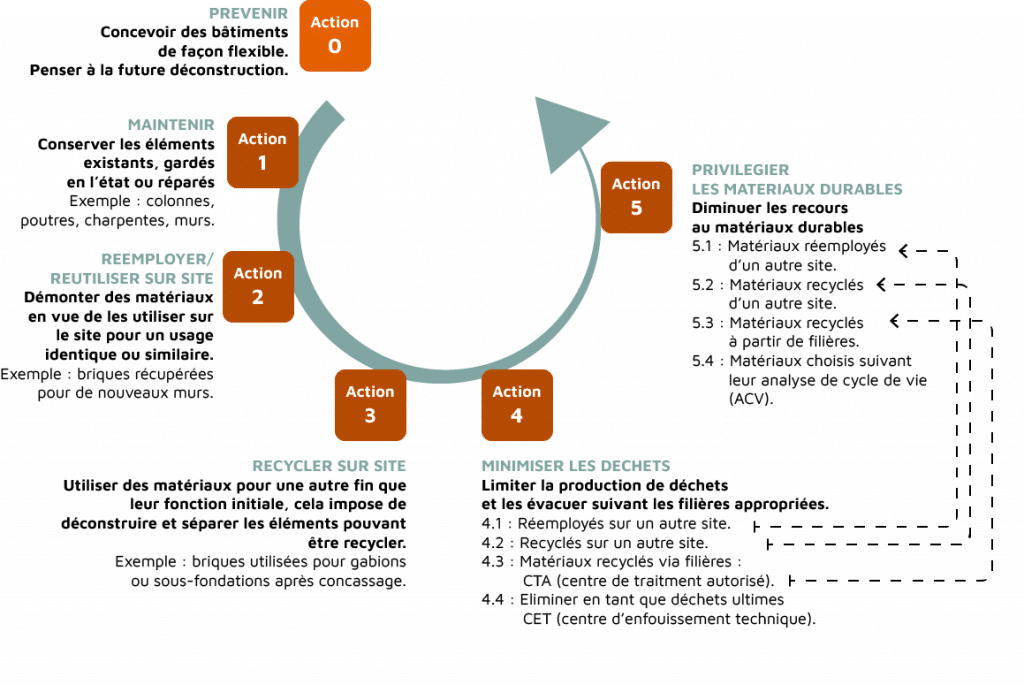
L’analyse multicritère des impacts d’un matériau ou d’une solution est un exercice complexe.
Si on privilégie le réemploi et qu’on choisit des matériaux
Alors, on est dans le bon ! Analysons tout ceci de façon détaillée : ici
Plus d’info sur les hypothèses et la méthode d’évaluation ? En cliquant sur ce lien, vous serez redirigez vers le site rénover mon école.
Le choix des matériaux à mettre en œuvre nécessite donc une réflexion globale sur deux impacts différents : l’impact environnemental global et l’impact carbone global.
Tous les matériaux possèdent donc un impact environnemental et un impact carbone qu’il est primordial de prendre en considération dès la conception d’un projet de rénovation visant la neutralité carbone. Depuis quelques années on sait que plus la performance énergétique des bâtiments s’améliore, plus la part des émissions de CO₂ liée aux matériaux mis en œuvre augmente. Dès lors, il est intéressant de toujours chercher à optimiser les compositions de paroi en tentant de trouver le juste équilibre entre l’impact environnemental des nouveaux matériaux mis en œuvre et l’empreinte carbone liée à l’énergie opérationnelle. Les deux indicateurs ne sont pas toujours liés, l’optimisation d’un facteur n’entraînera pas d’office une amélioration du second. Un isolant biosourcé performant sur le plan carbone peut, par exemple, causer un impact environnemental défavorable à partir d’une certaine épaisseur.
Actuellement, les valeurs U de paroi des bâtiments ne sont optimisées qu’en fonction de leur capacité à réduire l’utilisation d’énergie opérationnelle dans le bâtiment.
Au vu de l’urgence climatique et sachant qu’au plus un bâtiment est performant au niveau énergie opérationnelle, au plus il a une grande empreinte carbone et un grand impact environnemental lié à ses matériaux, il semble donc intéressant d’optimiser cette valeur U paroi par paroi en tenant compte des deux composantes globales : l’empreinte carbone globale et l’impact environnemental global. De cette manière, il est possible d’une part d’identifier pour chaque mode constructif considéré, le niveau U à viser pour minimiser l’impact ; et d’autre part, de comparer les modes constructifs, pour ces niveaux U minimisant l’impact, de façon à identifier des modes constructifs à privilégier.
Nous avons effectué ces comparaisons sur base de courbes d’interpolations construites sur les points extraits du logiciel TOTEM. Le tableau ci-dessous illustre le résultat :
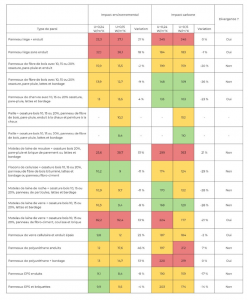

Les conclusions que l’on peut tirer de cette étude sont les suivantes :
De plus, les U optimum varient fortement en fonction de la paroi. Ils peuvent être de l’ordre des valeurs Umax réglementaires (cas du verre cellulaire ou du PUR), ou sensiblement plus bas : environ 0,16 W/m2K pour la fibre de bois, 0,11 W/m2K pour la cellulose et le verre cellulaire.
La question du “jusqu’où isoler”, dans le cadre de cette démarche zéro-carbone, pose donc la pertinence de mettre en oeuvre davantage de matériaux en regard des besoins de chauffage et du « surcoût » engendré. Pour certains, les Umax réglementaires représentent une valeur en-dessous de laquelle il n’est pas pertinent de descendre. Pour d’autres, des valeurs U sensiblement plus basses peuvent être proposées, d’un point de vue carbone comme d’un point de vue environnemental. Isoler plus ne signifie pas juste : « ajouter des couches ». Il faut veiller à ce que l’amélioration de la valeur U ne dégrade pas l’impact environnemental. Dés lors, pour une isolation renforcée, il faut interroger le mode constructif afin que la valeur U optimal s’accompagne d’un score d’impact environnemental également optimal.
Si vous souhaitez aller plus loin dans l’évaluation du bilan environnemental du bâtiment, nous vous proposons cet outil. Il vous permet de calculer l’impact environnemental total d’un bâtiment, en tenant compte non seulement des matériaux employés mais également des usages d’énergie. Il est évident que les consommations énergétiques d’une école ont, elles aussi, un impact environnemental plus ou moins important, selon la source de production. Modifier et/ou améliorer une paroi impacte également les consommations en énergie générales du bâtiment. Dès lors, en combinant l’impact des parois et des usages d’énergie, vous pourrez comparer différents scénarios et choisir celui ayant l’impact global le plus faible sur l’environnement.


Dans le cas d’une rénovation complète de votre école, plusieurs solutions sont envisageables pour réaliser les travaux. Cet article vous présentera ces différents scénarios et vous guidera dans une démarche afin de fixer les objectifs de votre projet de rénovation en accord avec la démarche zéro-carbone.
Comme mentionné, plusieurs scénarios sont possibles afin de réaliser la rénovation complète de votre bâtiment.
Avant toute chose, il est primordial de préciser votre définition et votre vision d’un bâtiment zéro-carbone. Sans cela, il est compliqué d’établir des objectifs à atteindre dans le projet.
La vision générale du bâtiment zéro-carbone prônée dans ce dossier identifie quatre priorités qui correspondent à quatre axes de réflexion sur lesquels il est nécessaire de se pencher avant de fixer les objectifs pour une rénovation zéro-carbone pertinente.
1.Qualité de l’air
2. Enveloppe
3. Electricité
4. Chauffage
En conséquence, tout projet de rénovation doit porter simultanément sur (au moins) ces quatre volets pour s’assurer une qualité globale et une cohérence d’ensemble. Si au niveau des travaux ils peuvent faire l’objet de lots différents, il est par contre indispensable qu’au niveau des études ils soient intégrés dans une démarche globale qui détermine comment atteindre les objectifs visés.
Peu importe le scénario dans lequel se trouve l’école pour les travaux, il est toujours nécessaire de fixer au départ des objectifs clairs à atteindre qui guideront le marché et les propositions imaginées par les bureaux d’étude.
Dans le cahier des charges décrivant le marché, il est possible de formuler les objectifs à atteindre de 2 manières différentes :
Les objectifs choisis et leur formulation dépendent de l’approche dans laquelle on se place. Sur base de tous les éléments présentés dans de dossier, nous voyons deux voies possibles pour une rénovation zéro-carbone : l’approche énergétique classique actuelle (généraliste), en excluant certaines technologies, et celle visant une modification plus profonde de l’approche énergétique.
Les exigences principales à mettre en avant dans cette approche de la rénovation zéro-carbone sont les suivantes :
Concrètement, les objectifs à documenter par les bureaux d’étude peuvent être :
| Indicateurs | Objectifs « + » |
| Ventilation et qualité de l’air | Objectif performanciel
|
Objectif descriptif
|
|
| Performance de l’enveloppe | Objectifs performanciels
|
Objectifs descriptifs
|
|
| Systèmes de chauffe | Objectifs performanciels
/ |
Objectif descriptif :
|
|
| Confort d’été | Objectif performanciel
|
Objectif descriptif
|
|
| Eclairage | Objectifs performanciels
|
Objectif descriptif
|
|
| Système électrique | Objectif performanciel
/ |
Objectif descriptif
|
|
| Energies renouvelables | Objectif performanciel
/ |
Objectif descriptif
|
|
| Systèmes de gestion | Objectif performanciel
/ |
Objectif descriptif
|
|
| Programmation architecturale | De manière générale, réfléchir à une programmation circulaire avec une vision sur plusieurs cycles de vie du bâti. Alternativement, choisir ou adapter le programme imaginé en fonction de la richesse spatiale du bâti existant.
Les objectifs précis de programmation varient selon la situation particulière de chaque projet. |
Les exigences principales à mettre en avant dans ce projet de rénovation zéro-carbone sont les suivants :
Concrètement, les objectifs à documenter par les bureaux d’étude peuvent être :
| Indicateurs | Objectifs « +++ » |
| Ventilation et qualité de l’air | Objectif performanciel
|
Objectif descriptif
|
|
| Performance de l’enveloppe | Objectifs performanciels
|
Objectifs descriptifs
|
|
| Systèmes de chauffe | Objectifs performanciels
/ |
Objectif descriptif :
|
|
| Confort d’été | Idem que l’approche classique |
| Eclairage | Idem que l’approche classique |
| Système électrique | Idem que l’approche classique |
| Energies renouvelables | Idem que l’approche classique |
| Systèmes de gestion | Idem que l’approche classique |
| Programmation architecturale | Idem que l’approche classique |
Il est toujours intéressant d’exiger plusieurs propositions afin de pouvoir comparer les résultats. Nous suggérons les quatre propositions suivantes :
Les propositions pourront alors être comparées selon leur respect plus ou moins fort de la démarche “zéro carbone”. Attribuez des points supplémentaires aux propositions les moins émettrices en carbone.


Par le terme rénovation urgente nous entendons tous les travaux sur des équipements essentiels au confort des occupants qui nécessitent un remplacement et/ou une intervention rapide. Ces travaux d’urgence peuvent être causés par des évènements exceptionnels (inondations, incendie…), par la casse du matériel (châssis, luminaires…) ou encore simplement parce que les équipements sont arrivés en fin de vie (chaudière, luminaire…).
Le plus important dans ce genre de situation est souvent de ne pas se précipiter et de ne pas toujours opter pour la « solution facile » : remplacer à l’identique. Bien souvent, les équipements sur lesquels intervenir ne sont plus aux normes ou bien existent en version plus performante. Dans une situation d’urgence, il est donc toujours utile de réfléchir au-delà de la facilité afin d’anticiper l’évolution des travaux en question.
Voici donc une série de recommandations pour traiter quelques situations d’urgence de la manière la plus optimale, en accord avec les principes de la démarche zéro-carbone.
Remplacer sa chaudière est l’occasion de faire de grandes économies, d’autant plus si celle-ci a plus de 20 ans. Il existe aujourd’hui des chaudières dites à « haute performance énergétique », qui pourront aisément remplacer des installations en fin de vie.
Dans le meilleur des cas, il est toujours préférable d’avoir établi un plan de rénovation à l’avance avec un professionnel. Celui-ci aura pu prendre le temps d’analyser différentes offres, de revoir le surdimensionnement de la chaudière, d’étudier l’éventuel changement de combustible ou encore les améliorations à apporter au système de régulation. Ce plan de rénovation étant prêt, on peut répondre rapidement à une situation d’urgence, tout en optimalisant le choix de la nouvelle installation.
Souvent, malheureusement, ce diagnostic et cette étude préalable n’ont jamais été faites. Lorsque la chaudière tombe en panne ou est à remplacer en plein cœur de l’hiver, une solution rapide et efficace est nécessaire. La chaudière à condensation est celle à envisager en priorité car elle propose les rendements les plus élevés et est beaucoup moins émettrice en CO² que d’autres technologies de chaudières. Attention toutefois de, malgré l’urgence, prendre le temps de demander 2 ou 3 devis afin de comparer les offres. Certains chauffagistes remplacent l’existant par une installation ayant exactement les mêmes fonctionnalités. D’autres proposent une installation dont la puissance est judicieusement revue à la baisse et dont la régulation répond aux standards de performance actuels. Il est évident que cette dernière solution est de loin préférable si on veut optimaliser l’économie d’énergie réalisable.
Pour en savoir plus :
Il est rare de devoir remplacer un seul châssis dans une école. Souvent, ceux-ci doivent être remplacés par groupe. Peu importe le nombre de châssis à remplacer, une autorisation de l’administration communale est souvent la première démarche à entreprendre.
D’un point de vue technique, la principale question à prendre en compte rapidement lorsque des travaux comme tel doivent être réalisés rapidement est celle de la ventilation.
Souvent, les locaux scolaires ne sont munis d’aucun système de ventilation. Dès lors, il est primordial de prévoir des grilles de ventilation dans les nouveaux châssis afin de rendre possible les échanges d’air entre intérieur et extérieur. Les grilles de ventilation permettront également d’éviter des risques de condensation et de moisissures indésirables sur les parois intérieures de la classe.
Remplacer un châssis sans y ajouter de grille de ventilation peut alors porter la réflexion sur la mise en place d’un système de ventilation mécanique dans les locaux en question.
De plus, il peut aussi être intéressant de se poser la question de la place du nouveau châssis dans le mur. Si le mur n’est pas isolé, il peut être intéressant de réfléchir à placer le châssis de manière la plus adéquate pour être intégré plus tard dans une enveloppe isolée (par l’intérieur ou par l’extérieur).
Pour en savoir plus :
Dans le cas où des travaux doivent être réalisés sur une paroi à cause de dégât des eaux par exemple, la principale réflexion à avoir porte sur l’isolation de celle-ci. La paroi est-elle déjà isolée ? Est-ce utile de le faire ?
Malgré une prise de décision rapide, il est toujours utile de réfléchir à employer des matériaux à faible impact environnemental pour isoler thermiquement et/ou acoustiquement.
Agir sur les corps de chauffe peut soulever des questionnements concernant les besoins en chaleur des occupants des locaux en question. Peut-on se passer de ce radiateur moyennant d’autre systèmes de chauffage ? Combien de radiateurs sont réellement nécessaires ? Quelle température est la plus idéale ?
Souvent le remplacement de ce type d’équipements se fait lampe par lampe. De cette manière, l’économie d’énergie met du temps à devenir significative. Cependant, malgré un remplacement petit à petit comme cela, il est intéressant de s’inscrire dans une stratégie globale, permettant de revoir la position des luminaires dans les locaux, la puissance installée nécessaire ainsi que les techniques de régulation des luminaires.


Les bâtiments scolaires sont sujets à de nombreux gaspillages d’énergie suite à leurs périodes d’occupations ponctuelles. Durant les weekends, les mercredis après-midi ou les congés, beaucoup d’appareils électriques restent branchés et utilisent de l’électricité inutilement. Malheureusement, le problème est voué à une grosse augmentation à cause de la numérisation de la pédagogie (bornes wifi, salles informatiques et autre). Il est donc impératif d’agir dès maintenant !
Contrairement à ce que l’on pense, les appareils en standby durant les périodes d’inoccupation consomment énormément d’électricité, faisant augmenter la facture totale à la fin du mois. En effet, si les puissances en cause sont limitées, les durées de fonctionnement de ces équipements sont longues. La quantité totale d’énergie n’est donc pas à négliger. Ces sources d’électricité cachées participent à former le talon de consommation de l’école, c’est à dire le seuil en dessous duquel il est difficile d’aller en termes de consommations.
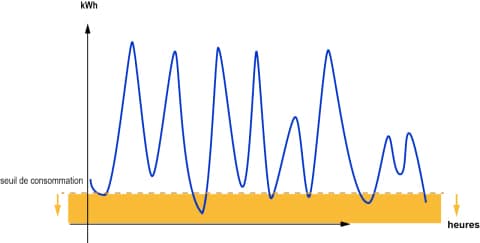
Agir sur le talon de consommations est relativement simple et abordable pour tous. C’est donc la première chose à réaliser afin de réduire les consommations électriques dans l’école. Ensuite, pour aller plus loin, il sera pertinent de se pencher sur le choix des équipements et/ou l’amélioration de leurs performances. Une bonne conception et régulation de ceux-ci est essentielle afin de réduire efficacement les consommations d’électricité.
Le projet Génération Zéro Watt a pour objectif d’aller à la recherche des sources de consommation d’énergie cachées ou inutiles et d’agir localement sur celles-ci. Par le biais de petites actions simples sur les appareils électriques, l’éclairage et le chauffage, les enfants des écoles impliquées dans le projet sont sensibilisés à des comportements efficaces en termes de réduction de consommation d’énergie. De cette manière, les écoles participantes peuvent atteindre durant le défi des économies allant en moyenne jusqu’à 20% de la consommation électrique initiale.
Le pourcentage d’économies dépend du nombre d’élèves dans les établissements concernés. Les grandes écoles éprouvent plus de difficulté à mobiliser l’ensemble de leurs occupants à réduire leurs consommations. Toutefois, celles qui y parviennent peuvent atteindre un ratio de consommation par élève logiquement plus bas que les petites écoles.
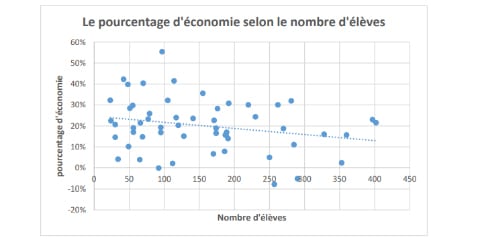
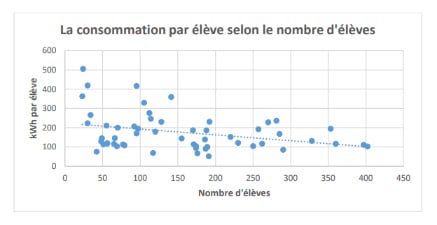
Source : https://www.educationenergie.be/moyennes-du-secteur/
Plus largement, les actions à entreprendre pour améliorer sa consommation peuvent être réparties selon le budget disponible. Le site educationenergie.be reprend, selon la taille du budget, les actions possibles à envisager dans l’école : https://www.educationenergie.be/actions-zero-budget/
Si l’on réfléchit aux bâtiments scolaires dans une optique zéro carbone, ce talon de consommation, bien que réduit par les diverses actions menées, produit toujours du carbone, nuisant ainsi à l’objectif nul recherché. Dès lors, il est nécessaire de réfléchir à d’autres solutions, parfois plus expérimentales ou innovantes.
Cette solution est hypothétique et va au-delà des petites actions ponctuelles sur les appareils électriques, le chauffage ou l’éclairage. Elle propose une gestion centralisée et automatisée des circuits électriques parcourant le bâtiment de l’école. Ce mode de fonctionnement permettrait une plus grande efficacité dans la lutte contre le talon de consommation de l’école. Pour plus d’informations concernant la gestion centralisée (GTC), consultez cet article consacré au réseau électrique.
Les principes de GTC existent déjà mais sont actuellement peu propices à l’utilisation dans des écoles car ils sont onéreux et nécessitent beaucoup de maintenance. Ils sont donc principalement réservés à des projets hauts de gamme.
Une mesure plus pragmatique concernant la modification des systèmes électriques dans une école serait de réfléchir avec l’électricien à un découpage qui, outre la logique “spatiale”, intègre la division entre 3 types d’usages.
Imaginons donc que 3 circuits électriques composent l’installation de l’école
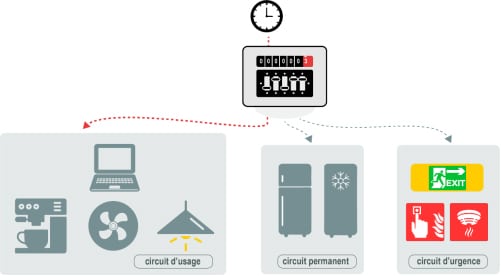
Ces trois circuits sont contrôlés via un tableau électrique et chacun d’entre eux est doté d’un interrupteur horaire. Ceux-ci ont pour but d’allumer et de couper le circuit électrique selon un horaire prédéfini. La répartition proposée sous forme de circuit permet, lors des périodes d’inoccupation de simplement couper en une fois l’ensemble du circuit d’usage, sans devoir éteindre chaque appareil individuellement. Cette simplification des manipulations agit en faveur de la réduction des consommations énergétiques de l’école.

Des réglages pourraient être envisagés lorsque l’école est occupée en dehors des heures habituelles. Par une détection de présence d’occupants, le circuit comprenant l’éclairage pourrait se mettre en route par exemple..
S’il n’est pas envisageable de refaire le réseau électrique complet, il faut trouver d’autres solutions. Par exemple, avoir recours à des prises de courant intelligentes, pour pouvoir leur ajouter une programmation horaire individuelle. L’utilisation de technologies de l’internet des objets permet elle aussi de réduire les consommations énergétiques, mais à moindre niveau et au prix d’une consommation de ressources non négligeable.


Les émissions de carbone dans les écoles proviennent de nombreuses sources qui vont bien au-delà de la simple consommation d’énergie. En effet, les bâtiments scolaires se situent à l’intersection de trois facteurs contribuant aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, pouvant être explorés à différents stades du cycle de vie de la construction :
Pour atteindre la neutralité carbone, l’école doit donc non seulement porter une attention particulière sur les aspects techniques de la rénovation mais également sur la sensibilisation et la mise en place de pratiques alternatives décarbonées. L’asbl COREN propose un outil permettant aux écoles de quantifier leur bilan carbone, en intégrant ces différents volets((https://www.coren.be/images/outils/bilan_carbone/Guide%20accompagnement%20bilan%20carbone.pdf)).
Les écoles sont, par leur caractère éducatif visant une citoyenneté responsable, des lieux propices à la sensibilisation et à l’éducation de notions relatives à la protection de l’environnement.
Sensibiliser à la neutralité carbone va au-delà de placarder des affiches sur les murs de l’école, c’est une réelle réflexion globale qui doit être menée sur de nouvelles pratiques alternatives moins consommatrices en carbone. L’objectif général étant d’éveiller les occupants des écoles à des comportements moins hostiles vis-à-vis de l’environnement. Pour cela, nous proposons 3 pistes de réflexions.

Une voiture transportant une seule personne consomme environ 0,2 kgCO²e par kilomètre parcouru, contre plus de la moitié en moins pour le même trajet en bus ou en train. Dès lors, il paraît évident, dans une optique zéro carbone, que l’école mette la question de la mobilité à l’ordre du jour de ses préoccupations. Les écoles en Wallonie sont assez bien desservies en transports publics, rendant leur utilisation facile pour tous les enfants de l’école.
Avec le soutien de certaines associations comme Empreintes, l’école peut facilement mettre en place certains gestes agissant en faveur d’une diminution des émissions de carbone liées à la mobilité. Agir durablement sur les modes de transports vers et depuis l’école est une étape importante dans la sensibilisation à la neutralité carbone et dans l’éducation relative à l’environnement des élèves prenant part au projet.
La Région Wallonne propose également de nombreux outils pour traiter la question de la mobilité durable. Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes :

Projet Ose le Vert ! à l’école de Gentinnes
Développer la végétation dans l’école est indispensable pour sensibiliser les occupants à l’environnement. La présence de nature dans l’environnement direct des enfants permettra non seulement de les rapprocher de la nature mais également de rendre visible et tangible des processus écologiques au sein même de leur école. La nature environnante s’accompagne de potentiels pédagogiques importants, elle doit servir de support d’apprentissage pour les élèves.
La végétation permet une meilleure gestion du cycle de l’eau dans l’école mais également d’accueillir de la biodiversité sur le site. En plus de cela, les potagers, jardins, vergers et autres peuvent agir comme de réels puits de carbone. Les émissions de gaz à effet de serre pourront en partie être réduites grâce à une absorption directe par la végétation présente sur le site même de l’école((Last child in the woods – saving our children from nature-deficit disorders – Richard Lou)).
Pour aborder la question de la végétalisation dans votre école, consultez les pages suivantes :
Chaque année, des appels à projets ont lieu en Wallonie et à Bruxelles pour des projets de végétalisation des cours de récréation.

Avoir une réflexion sur une alimentation plus durable permet également d’alléger le bilan carbone de l’école. En plus de cela, ces actions ont un effet positif sur notre santé.
Les leviers à mettre en place pour se diriger vers une alimentation plus respectueuse de l’environnement sont les suivants :
Pour aller plus loin dans ces réflexions, vous pouvez consultez les pages suivantes :
On considère souvent le contact avec la nature comme un avantage, mais rarement comme une nécessité absolue. Pourtant, des recherches scientifiques montrent qu’on peut considérer notre lien avec la nature comme un besoin essentiel à notre bien-être et à notre développement.
Le contact avec la nature a de multiples impacts bénéfiques sur la santé physiologique et psychologique. Des recherches ont montré des relations entre le manque de contact avec la nature et des problèmes tels que l’obésité, les troubles de l’attention ou la dépression. Les enfants en contact avec la nature sont considérés comme plus « résilients ». Ils résistent et s’adaptent plus facilement à des situations de stress.
En parallèle à ses impacts sur le bien-être physiologique et psychologique des enfants, la nature sollicite tous les sens de l’enfant et offre des possibilités d’expérimentations et d’apprentissages multiples. Elle est le support idéal pour enseigner de nombreuses notions faisant partie du programme scolaire. Comme terrain de jeu, un environnement naturel met à disposition des enfants, une série d’éléments variables et sans usage prédéterminé qui, utilisés pour jouer, stimulent l’inventivité et la créativité.
Pourtant, dans notre société actuelle, l’accès à la nature est de plus en plus difficile pour les enfants. L’urbanisation importante, la peur des parents qui les mènent à réduire leur autonomie et la multiplication des activités parascolaires limitant le temps libre des enfants sont différents facteurs qui font que les enfants passent de moins en moins de temps dans la nature, a fortiori pour y avoir des activités libres, non dirigées.
Dans le cadre de l’école, la nature est donc à la fois une nécessité pour les enfants, qui dépasse le cadre strictement scolaire, et une formidable opportunité d’apprentissage.
Les enfants ayant pu bénéficier de cette sensibilisation pourront-ils inciter efficacement leurs parents à modifier leur comportement en matière de consommation d’énergie ? Il a été démontré qu’amener les élèves de primaire et secondaire à encourager leurs familles à suivre de bonnes pratiques de consommation est un moyen efficace d’organiser des engagements volontaires en matière d’économies d’énergie. Ces études nous montrent que le milieu scolaire est un levier efficace pour toucher plus largement la société en général((AGARWAL S., RENGARAJAN S., FOO SING T. & YANG Y (2016), Nudges of school children and electricity conservation: evidence form the “project carbon zero” campaign in Singapore)).
Cependant, l’éveil environnemental tel que pratiqué aujourd’hui dans de nombreuses écoles n’est pas encore assez efficace que pour inciter à de réels changements comportementaux à long terme chez les enfants. Toutefois, cela reste une généralité car certaines écoles parviennent tout de même à inciter de manière concluante leurs occupants à des changements de comportements par une sensibilisation plus poussée et plus active((DE PAUW & VAN PETEGEM (2013), The effect of eco-schools on children’s environmental values and behavior, Journal of Biological Education, 47:2, p.102)). Voilà de quoi motiver les troupes !
Dans ce dossier adressé aux responsables énergies, aux concepteurs et gestionnaires de bâtiments scolaires et aux bureaux d’études, vous trouverez un ensemble d’articles théoriques et d’outils pour vous guider dans la rénovation des bâtiments scolaires dans le but d’approcher au plus près la neutralité carbone fixée par le Green Deal à l’horizon 2050.
Beaucoup de documentation se trouve déjà sur le site “Rénover mon école” et dans le “Guide de la rénovation soutenable des bâtiments scolaires” mais l’intention ici est de hiérarchiser les actions à mener sous forme d’une feuille de route adaptée au cas particulier des bâtiments sur lesquels vous vous pencherez.
De plus, à la différence de ces deux outils existants, nous proposons dans ce dossier une approche des projets de rénovation dans une démarche zéro-carbone. La neutralité carbone de nos écoles d’ici 2050 est absolument nécessaire afin d’atteindre les objectifs européens.
Le processus hiérarchique peut contribuer à réduire la complexité de la réalisation d’un projet de rénovation. Il permettra de donner la priorité aux considérations les plus importantes à chaque étape de la conception plutôt que de les considérer toutes ensemble comme dans un modèle « plat ». Cette priorisation des démarches de rénovation permet aux gestionnaires de projets d’avoir plus de flexibilité et de répartir les interventions et le budget sur une vision à long terme.
Nous détaillons dans les sous-chapitres ci-dessous la priorisation que nous en faisons, tenant compte de la répartition des émissions carbone dans le parc scolaire ainsi que des besoins spécifiques des fonctions propres aux bâtiments scolaires.

Webinaire Energie+ – du vendredi 18 septembre 2020
INFORMATION :
Le premier Webinaire Energie+ consacré aux responsables énergies a eu lieu le 18 septembre 2020 de 10h à 11h40.
Nous avions décidé de sélectionner 2 modules pour ce premier Webinaire :
1. Energie+ : les nouvelles fonctionnalités d’Energie+ à la loupe !
2. POE occupant : la quête du confort dans les bureaux !
La première partie fut consacrée à la présentation de l’équipe « Architecture et Climat » :
10:00 – 10:20
Présentation de la cellule Architecture et Climat et du site Energie+ par Sergio Altomonte et Geoffrey Van Moeseke.
10:20 – 11:00
Premier module – Energie+ : les nouvelles fonctionnalités d’Energie+ à la loupe ! Présentation de l’outil « responsable énergie » par Denis De Grave.
11 :00 – 11:40
Second module – POE occupant : La quête du confort dans les bureaux ! Présenté par Sergio Altomonte.

Webinaire Energie+ – du jeudi 8 octobre 2020 de 10h à 11h30
Ces modules ont été présentés par Science Infuse et l’ICEDD.

> Intervenants :
Shady Attia
Prof. in Sustainable Architecture & Building Technology & Head of Sustainable Building Design Lab (SBD)
Tanguy Boucquey
Responsable du Bureau d’études Bâtiments/Energie à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve



On peut distinguer 2 principales formes d’énergies consommées au sein de l’école :
Ces deux postes de consommation sont responsables d’une grande partie des émissions carbones des écoles. Cependant, ce ne sont pas les seuls car l’impact carbone des bâtiments scolaires va bien au-delà de la consommation d’énergie. En effet, beaucoup d’autres facteurs sont à prendre en compte dans le bilan carbone général d’une école (alimentation, mobilité, énergie grise…), alourdissant celui-ci de manière considérable. Agir en priorité sur les postes de consommations d’énergie paraît toutefois être une solution efficace pour tendre vers la neutralité carbone.
De nombreuses questions liées à la rénovation ont des répercussions sur la consommation d’énergie de l’école. Il existe donc de nombreux moyens de réduire celle-ci : l’isolation des bâtiments, agir sur la performance des systèmes de chauffage et des équipements électriques, l’installation d’un système de ventilation, la production d’énergie renouvelable, le choix des matériaux de construction…
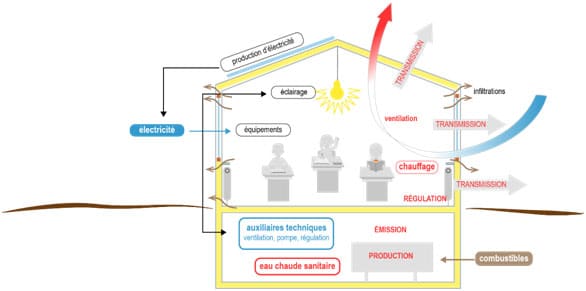
La consommation d’énergie dans les écoles wallonnes en quelques chiffres :
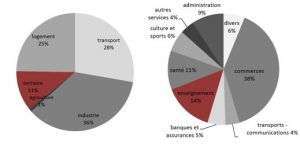
La part de la consommation énergétique wallonne dont les écoles sont responsables
Selon les données du bilan énergétique wallon, la consommation énergétique du secteur de l’enseignement représente 14% de la consommation du secteur tertiaire, qui représente elle-même 11% de la consommation énergétique globale wallonne. Elle est donc estimée à 1,5% de la consommation énergétique totale de la Wallonie.
Cette consommation varie également d’un réseau d’enseignement à l’autre((https://www.renovermonecole.be/fr/content/part-consommation-energetique-wallones-dont-ecoles-sont-responsables)).
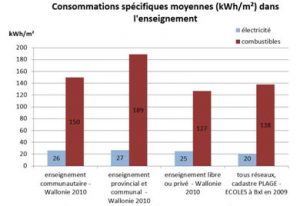
Les grandes variations que l’on peut observer dans le graphique ci-dessus((https://www.renovermonecole.be/fr/content/part-consommation-energetique-wallones-dont-ecoles-sont-responsables)) ont plusieurs explications :
Comme le montre le graphique, les consommations spécifiques de combustibles dans l’enseignement dépassent largement les consommations en électricité, dans l’état du parc au moment de la réalisation de ce cadastre. C’est pourquoi beaucoup d’écoles se tournent de plus en plus vers des travaux de rénovation, dans l’objectif de diminuer cette part importante de consommation. En moyenne, les écoles aujourd’hui consomment en combustibles 138 kWh/m² (40 kWh/m³).
La région Wallonne propose aux écoles (voir critères d’éligibilité) les subventions UREBA exceptionnelles destinées à soutenir les travaux d’amélioration des performances énergétiques. La prime propose une couverture de 30% des coûts éligibles à celle-ci. En moyenne, les écoles effectuant des travaux (plus ou moins importants) et ayant recours à cette prime effectuent une économie de 38 % sur leurs consommations de combustibles. Cependant, il est évident que ce chiffre varie en fonction du type de travaux, de la taille de l’école, de la consommation initiale, etc… ((Consommations spécifiques moyennes dans l’enseignement dans les écoles à Bruxelles – https://www.renovermonecole.be/fr/content/part-consommation-energetique-wallones-dont-ecoles-sont-responsables.))
La consommation d’énergie dans les écoles représente un budget important et ce budget est en constante augmentation. Réduire ces dépenses est nécessaire pour l’équilibre financier des écoles et permet de développer des projets plus passionnants que la combustion des énergies fossiles.
Il existe mille projets plus intéressants à financer dans une école que la consommation d’énergie, dont l’impact sur le climat et la paix mondiale n’est pas vraiment brillant.
Le coût de l’énergie pour l’école dépend de nombreux facteurs tels que les bâtiments, leurs caractéristiques techniques, le nombre d’élèves, les enseignants et leurs habitudes, le type de chauffage, …
Chaque école devrait connaître le coût de sa consommation d’énergie. Pour en savoir plus sur l’évolution des prix de l’énergie : cliquez ici.
Les actions qui améliorent le confort dans l’école ont un impact sur le bien-être, la santé et les performances des élèves et des enseignants.
La ventilation, la lumière naturelle, le confort thermique et acoustique contribuent à réduire l’absentéisme et à augmenter les chances de réussite des élèves. Et cela permet aussi de faire des économies. Si elles ne profitent pas directement à l’école, elles n’en sont pas moins intéressantes au niveau collectif.
Le coût de la scolarité d’un élève à charge de la Fédération Wallonie Bruxelles varie selon le niveau d’enseignement, avec une moyenne de 5097 € par élève et par an en 2011.
La Fédération Wallonie Bruxelles estime qu’en 2019, l’échec scolaire a généré un coût supplémentaire d’environ 391 millions d’euros dans l’enseignement obligatoire ordinaire. Investir dans la rénovation des établissements scolaires permettrait donc, dans certaines mesures, de réduire ce gouffre financier.
En plus de réduire la dépendance économique de l’école, rénover zéro-carbone peut aussi offrir plus de résilience aux écoles face à la raréfaction de l’énergie. Les sources d’énergie fossiles (pétrole, gaz, charbon) sont, par définition, limitées en quantité. De plus, cette contrainte d’épuisement n’est pas la seule à diriger la production d’énergie fossile. Des contraintes économiques et politiques participent aussi à la raréfaction de l’énergie, réduisant ainsi encore plus la production par rapport à la quantité d’énergie disponible. Ces contraintes sont par exemple l’augmentation des prix provoquant un déclin de la demande ou encore les crises politiques.
Limiter ses consommations et consommer de l’énergie renouvelable peu donc permettre aux écoles une meilleure stabilité dans le temps, moins de dépendance et plus de résilience face au marché fluctuant de l’énergie.
Rénover son école dans une démarche durable tel que le zéro carbone est une réelle opportunité pour sensibiliser et éduquer les élèves, enseignants et parents au développement durable et à l’efficacité énergétique. Les bâtiments scolaires rénovés offrent le potentiel de devenir des vitrines pour les élèves et les familles d’une architecture respectueuse de l’environnement. Cette vitrine, une fois vécue, peut influencer leur attitude et les amener à développer des comportements et des habitudes plus responsables afin de devenir de vrais éco-citoyens.
L’architecture de l’école possède une vertu pédagogique, capable d’enseigner et de sensibiliser de manière directe ou indirecte ses occupants à une série de concepts clés liés au développement durable. Le bâtiment scolaire ne devient plus uniquement une structure qui accueille les apprentissages mais un outil d’apprentissage en tant que tel.
Rénover son école dans l’optique zéro carbone offre donc le potentiel de proposer une architecture pédagogique au service de l’éducation à l’environnement de ses occupants.
L’éducation à l’environnement est une thématique très actuelle portée par beaucoup d’écoles à Bruxelles et en Wallonie. Au vu des problématiques auxquelles notre société fait face aujourd’hui, il semble indispensable d’éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à des valeurs et des comportements pro-environnementaux.
L’éducation relative à l’environnement (ErE) passe par un travail mené en parallèle sur 3 dimensions :
L’architecture de l’école peut donc participer à l’éducation relative à l’environnement de ses élèves en agissant sur les deux dernières dimensions.

Dans ce dossier adressé aux responsables énergies, aux concepteurs et gestionnaires de bâtiments scolaires et aux bureaux d’études, vous trouverez un ensemble d’articles théoriques et d’outils pour vous guider dans la rénovation des bâtiments scolaires dans le but d’approcher au plus près la neutralité carbone fixée par le Green Deal à l’horizon 2050.
Beaucoup de documentation se trouve déjà sur le site “Rénover mon école” et dans le “Guide de la rénovation soutenable des bâtiments scolaires” mais l’intention ici est de hiérarchiser les actions à mener sous forme d’une feuille de route adaptée au cas particulier des bâtiments sur lesquels vous vous pencherez.
De plus, à la différence de ces deux outils existants, nous proposons dans ce dossier une approche des projets de rénovation dans une démarche zéro-carbone. La neutralité carbone de nos écoles d’ici 2050 est absolument nécessaire afin d’atteindre les objectifs européens.
Le processus hiérarchique peut contribuer à réduire la complexité de la réalisation d’un projet de rénovation. Il permettra de donner la priorité aux considérations les plus importantes à chaque étape de la conception plutôt que de les considérer toutes ensemble comme dans un modèle « plat ». Cette priorisation des démarches de rénovation permet aux gestionnaires de projets d’avoir plus de flexibilité et de répartir les interventions et le budget sur une vision à long terme.
Nous détaillons dans les articles ci-dessous la priorisation que nous en faisons, tenant compte de la répartition des émissions carbone dans le parc scolaire ainsi que des besoins spécifiques des fonctions propres aux bâtiments scolaires.
Dans le cas de rénovations partielles, il faut identifier les priorités d’action et la bonne séquence de travaux. Se référer à un plan, avec un objectif clair, est indispensable pour cela. Pour garantir la santé et le bien-être et éviter des désordres constructifs, la qualité d’air doit être le premier objectif. Ensuite viennent l’économie d’énergie, puis le basculement vers des formes d’énergie décarbonée.


Actuellement, en termes d’éclairage, on s’oriente en majorité vers la technologie LED. Celle-ci est en plein essor et ne cesse de s’améliorer au fil des années. Les arguments les plus souvent énoncés en faveur des LED sont leur grande efficacité lumineuse, leur durée de vie extrêmement longue et leur faible consommation électrique.
Technologie miracle ? Pas tout à fait…. Autant les LEDs paraissent meilleurs que la concurrence sur le plan performanciel et énergétique, il n’est pas de même en termes de confort visuel et d’impact sur la santé.
Aujourd’hui, les lampes à LED sont particulièrement performantes et beaucoup plus économes en énergie que les technologies classiques.
À titre d’exemple, le tableau comparatif ci-dessous provient d’une étude scientifique((L.T. Doulos et al. Minimizing energy consumption for artificial lighting in a typical classroom of a Hellenic public school aiming for near Zero Energy Building using LED DC luminaires and daylight harvesting systems, Energy and Buildings, Volume 194, 2019, Pages 201-217)) et met en évidence les dernières avancées en termes de LED par rapport à un luminaire classique à tube fluorescent. Les résultats peuvent évidemment dépendre selon les produits testés.
| LED (AC supply) | LED (DC supply) | T5 2x35W | |
| Puissance (W) | 41.0 | 50.5 | 76.0 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 116.1 | 107.6 | 62.0 |
| Puissance spécifique (W/m2) | 3.16 | 3.90 | 5.86 |
| Nombres de luminaires utilisés | 4 | 4 | 4 |
| Puissance totale installée (W) | 164 | 202 | 304 |
| Consommation annuelle (kWh) | 255.8 | 315.1 | 474.2 |
| Eclairement (lx) | 302 | 322 | 308 |
On remarque que les luminaires LED sont aujourd’hui largement plus efficaces en termes de consommation électrique, à niveau d’éclairement similaire.Il est donc très intéressant de se tourner vers des solutions 100% LED dans des projets de rénovation visant le zéro-carbone, d’autant plus que l’efficacité lumineuse retenue pour les luminaires ci-dessus n’est pas le plein potentiel de la technologie.
Face à la constante amélioration de la technologie LED, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a récemment publié un nouveau rapport étudiant les effets sanitaires de ces systèmes sur la population. Les LED sont caractérisées par un spectre de lumière plus riche en lumière bleue et plus pauvre en lumière rouge que d’autres sources lumineuses, créant un déséquilibre spectral particulièrement nocif pour nos yeux. De plus, “les lumières à LED peuvent être plus éblouissantes que les lumières émises par d’autres technologies (incandescence, fluo-compactes, halogènes, etc.)” (ANSES, p.355). “Enfin, les LED sont très réactives aux fluctuations de leur courant d’alimentation. De ce fait, selon la qualité du courant injecté, des variations de lumière peuvent apparaître, suivant la fréquence et le niveau de ces variations.” (ANSES, p.355)
Le rapport étudie donc différents effets sanitaires :
Afin de protéger la population de tous ces effets sanitaires, l’ANSES émet une série de recommandations liées à l’utilisation de lumières à LED. Certaines sont de l’ordre de futures recherches à mener ou de suggestions d’évolutions réglementaires tandis que d’autres sont de l’ordre de bonnes pratiques à prendre en compte directement dans des projets de relighting. On retiendra les deux principales :
Toutefois, les difficultés des LED ciblées dans l’étude sont surtout liées au lien entre lumière bleue et endormissement. Elles sont donc peu pertinentes dans les écoles.
Pour plus d’informations, celles-ci sont reprises dans le document « Effets sur la santé humaine et sur l’environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED) » en page 363 : https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2014SA0253Ra.pdf
Avant de se lancer dans un projet de rénovation de l’éclairage de l’école, il faut impérativement passer par l’étape d’analyse et de diagnostic de la situation existante. Pour cela, il est préférable de faire appel à un bureau spécialisé en éclairage. Cependant, il existe quelques outils sur le site de Rénover mon école qui vous permettront de réaliser un rapide diagnostic de l’installation lumineuse de vos salles de classe. Les pages suivantes sur Energie+ peuvent également être utiles :
Le site internet de Rénover mon école regroupe une grande partie des questions générales à se poser lors de la rénovation de l’éclairage. Attention que les informations mentionnées en termes d’objectifs et de techniques ne sont plus de toute fraîcheur… En plus de cela, elles ne visent pas l’objectif zéro-carbone qui nous intéresse dans ce dossier.
Pour plus d’infos concernant le passage au LED, consultez la page suivante.
Que faire donc dans notre cas ?
Procéder à un relighting de l’école dans une démarche zéro carbone nécessite de faire attention à deux points principaux :
En termes de puissance...
Comme vu plus haut, le LED offre de faibles puissances et donc a fortiori de meilleures performances énergétiques. C’est donc principalement vers cette technologie qu’il faut se tourner lorsqu’on envisage le relighting d’un bâtiment scolaire.
L’emplacement des luminaires dans le local a toute son importance en termes de puissance. Un moins grand nombre de luminaires, mais bien situés afin de garantir une uniformité de l’éclairement, permettra de réduire la puissance totale et donc la consommation en carbone.
La question de la gestion….
C’est principalement sur ce point qu’il est utile d’insister lorsque l’on conçoit un relighting d’une école. 35% de la facture énergétique des écoles correspond à l’électricité consommée par l’éclairage. Bien souvent, cela est dû à une mauvaise gestion du système d’éclairage. Il est impératif de rendre les occupants des locaux conscients de leurs décisions en limitant au maximum l’allumage automatique de lampes par exemple. L’extinction automatique, le zonage ou encore le dimming des lampes sont autant de principes qu’il est nécessaire de prendre en compte dans une démarche zéro-carbone. Pour plus d’informations sur ces techniques, consultez les pages suivantes :
De plus, une attention particulière doit être portée sur le programme de maintenance afin de garantir la pérennité du projet de relighting.
Rénover pour consommer…plus ?
Il est nécessaire de pointer la faiblesse actuelle en termes de niveaux d’éclairage dans les écoles. Les installations vétustes et inconfortables ne respectent souvent pas les normes visées lors de projets de relighting ou de constructions neuves. Dès lors, il se peut qu’après rénovation, le système d’éclairage consomme plus qu’auparavant. Cependant, au profit d’un meilleur confort visuel, qui s’avère bénéfique en de nombreux points pour tous.
Réemploi des systèmes existants
Lors de nouvelles constructions, il est facile et logique de concevoir l’ensemble de l’éclairage sur un système électrique approprié à la technologie LED. Mais est-il aussi simple d’adapter un système d’éclairage existant à la technologie LED? Dans un souci d’économie financière, est-il possible dans un projet de rénovation scolaire de garder les luminaires existants en y changeant simplement les tubes ?
Les luminaires existants de type tube T5 ou T8 sont toujours équipés de ballasts électroniques ou ferromagnétiques. Dans les deux cas, il est possible, moyennant certaines manipulations (voir article G0W), de passer d’une technologie de tube fluorescent vers des tubes LED. Il est donc tout à fait envisageable de maintenir les luminaires existants lors d’un projet de relighting au LED. Cependant, les lampes LED ayant des niveaux de luminance élevés, il est impératif d’utiliser des mécanismes optiques adaptés. On favorisera donc des mécanismes de réfraction ou de transmission à la place de mécanismes de réflexion.

À proscrire : mécanismes de réflexion

À recommander : mécanismes de réfraction
Les situations de relighting sont très différentes en fonction de l’usage des espaces à rénover. La disposition des luminaires, le type de luminaire, la température de lumière ou encore le mode de gestion de l’éclairage sont autant de paramètres qui varient en fonction de l’utilisation de l’espace.
Le site de Rénover mon école reprend, sur les deux pages suivantes, les grandes recommandations à prendre en compte pour des classes, des espaces de circulations, des bureaux ou encore des réfectoires :


A cause de la présence des planchers et murs intérieurs qui se raccordent aux différentes parois de l’enveloppe du volume protégé (façades, toitures, planchers, …) assurer la continuité de la couche d’isolant thermique est quasiment impossible à coût raisonnable.
Le raccord du plancher avec la façade, tous deux étant isolés par l’intérieur, ne pose pas de difficulté. C’est également le cas entre la toiture et la façade.
Les principales difficultés seront donc localisées au droit des raccords entre les parois intérieures et les parois de l’enveloppe. Dans le cas des façades, deux solutions existent cependant :
Les nœuds constructifs entre les fenêtres et les façades (appuis de fenêtre, linteaux, piédroits) nécessitent parfois des petites adaptations.
En rénovation, la mise en œuvre de l’isolation du plancher et de la jonction avec le mur n’est pas évidente et lourde. Il faut vraiment se trouver dans un cas de figure où la rénovation :
Jonction avec le plancher sur local non chauffé ou sur terre-plein – Isolation sous chape
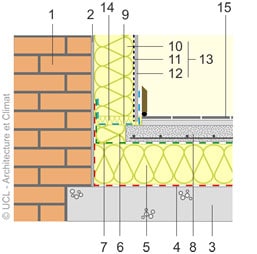
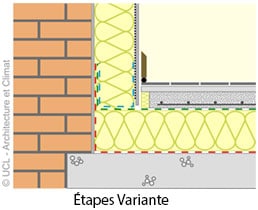
Seuil et linteau – cas du panneau isolant revêtu d’un enduit
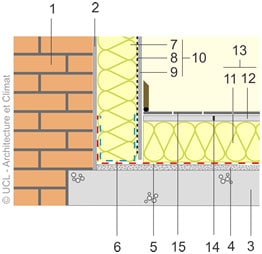
Plancher en bois entre étages
Dans le cas d’un plancher en bois, l’extrémité de celui-ci qui vient s’encastrer dans la maçonnerie atteint des températures plus basses qu’avant isolation par l’intérieur. Alors qu’il est possible d’éviter le transfert de vapeur interne au travers du mur par l’usage d’un pare-vapeur, il n’existe pas de moyen efficace pour éviter ce transfert au niveau du plancher. Ainsi, il y a risque de condensation à proximité des têtes de solives et possibilité de pourrissement.
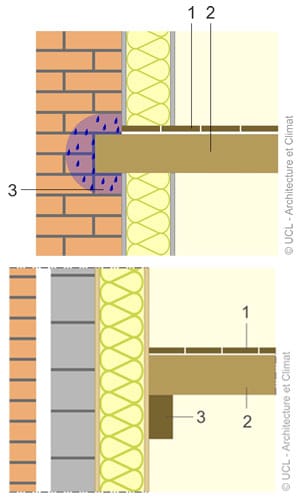
Le projet de recherche Renofase, mené par la Région Flamande a pour objectif de soutenir les projets de rénovation de son parc immobilier et d’en assurer une réalisation performante et de qualité. Dans son dernier rapport, portant sur l’isolation par l’intérieur, elle propose le , offrant sous forme schématique une multitude de solutions afin de résoudre les ponts thermiques aux jonctions avec des planchers ou avec des murs de refend. Pour supprimer ces ponts, beaucoup de solutions peuvent être envisagées :
| Possibilités de réduction des ponts thermiques | |||
| Isolation continue | Appliquer l’isolation du retour | Augmenter l’épaisseur de l’isolation intérieure | Appliquer l’isolation extérieure locale |
 |
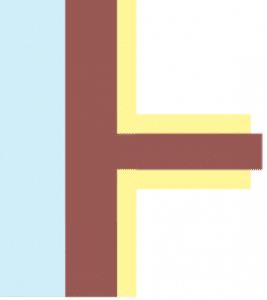 |
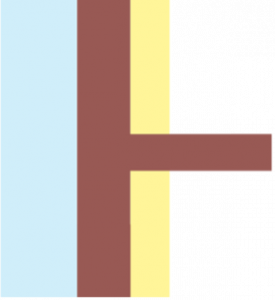 |
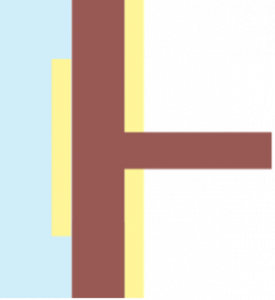 |
| ++ SOLUTION OPTIMALE
– Souvent impossible à réaliser avec une isolation intérieure.
– Une connexion structurelle entre les deux éléments de construction est souvent nécessaire, ce qui peut entraîner des ponts thermiques.
! Attention à l’isolation acoustique : les fuites acoustiques doivent être évitées.
Les matériaux d’isolation rigides peuvent être interrompus par des isolants souples au point de raccordement. |
+ SOLUTION STANDARD
Dimensionnement : longueur de l’isolation de retour standard 60 cm à partir de la surface intérieure du mur existant ; en l’étendant à 100 cm à partir de la surface extérieure, le nœud du bâtiment est accepté par la PEB
– Impact sur la forme de la surface du mur ou du plancher à l’intérieur (parfois non possible ou souhaité)
+ Peut être utile de le combiner avec l’intégration de techniques (conduit de tuyaux, éclairage, …) |
+ Impact visuel minimal
– Perte d’espace relativement importante
– Une simulation thermique est toujours nécessaire pour déterminer l’épaisseur minimale de l’isolation (car elle dépend de l’épaisseur de la paroi et des propriétés du matériau).
– Cette solution permet d’éviter les dommages (facteur de température suffisamment élevé) mais les pertes d’énergie ne sont réduites que de manière limitée |
Dimensionnement : la règle de base « chemin de moindre résistance > 1 m » peut être utilisée pour rendre le nœud de bâtiment acceptable pour les PEB.
+ Impact visuel et perte d’espace minimaux
– Impact sur l’aspect de la façade, donc pas toujours possible ;
+ Parfois, cela permet à la fois de résoudre un pont thermique et d’apporter une valeur ajoutée architecturale
! Attention aux contraintes thermiques dans la maçonnerie |
| Quelques variantes | |||
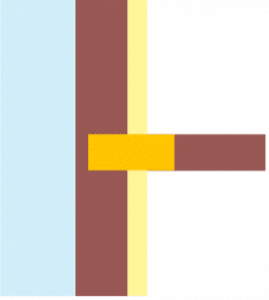 |
 |
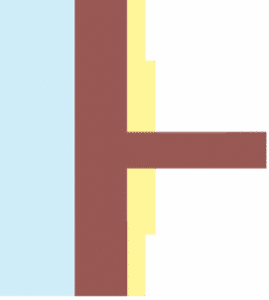 |
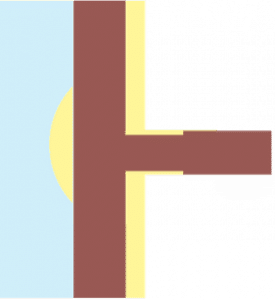 |
| La maçonnerie existante est remplacée localement par une maçonnerie isolante.
! Attention : la maçonnerie isolante peut devenir humide : l’impact de celle-ci doit être pris en compte (impact sur la valeur lambda, le transport capillaire de l’humidité, la durabilité…). |
Continuez sur l’ensemble du mur ou du plancher et combinez avec une isolation ou une absorption acoustique.
Afin de limiter les pertes d’énergie, des matériaux super-isolants et isolants peuvent être utilisés dans les premiers 20 à 50 cm du mur.
– Attention : la dalle de plancher peut devenir relativement froide en hiver ; les contraintes thermiques d’impact doivent être vérifiées ; pas de tuyaux sensibles au gel dans le plancher.
|
L’épaississement peut être limité à une bande de chaque côté de la paroi intérieure ou du plancher.
+ Peut être utilement combiné avec l’intégration de techniques (conduite, éclairage, …) |
Peut être intégré dans des éléments de façade décoratifs nouveaux ou existants (par exemple, dans le cas de bâtiments patrimoniaux) et/ou être associé à une isolation à retour limité, par exemple. |
Pour ne pas provoquer de pont thermique et de risque de condensation superficielle autour de la baie, l’isolation thermique doit être prolongée jusqu’à la menuiserie.
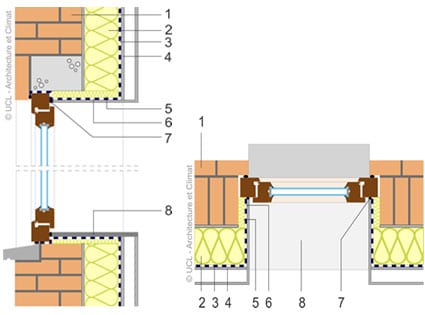
Pour augmenter les performances thermiques du retour d’isolation, la finition autour de la baie peut être réalisée en bois (ébrasement et tablette).
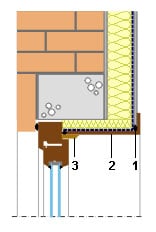
Remarque : cette partie s’inspire de la brochure “Méthodes de modification du gros-œuvre – isolation thermique d’un bâtiment existant” et du projet de recherche Renofase mené par la Région Flamande.
Jonction mur-plancher étanche à l’air
Pour éviter tout risque de condensation interne, les systèmes d’isolation par l’intérieur doivent garantir une parfaite étanchéité à l’air. La ruine des parois peut avoir lieu lorsque de l’air chargé en humidité pénètre derrière la couche d’isolation et condense sur l’arrière de celle-ci.
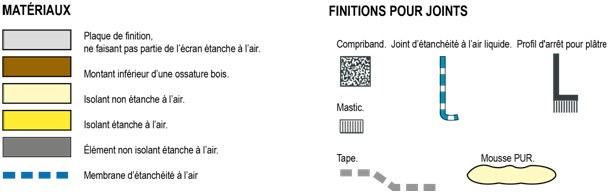
| Couche étanche à l’air((DOBBELS F, RenoFase WP4 – Detaillering van binnenisolatie, WTCB, 2017, p.31-32)) | |||
| Matériau isolant étanche à l’air, placé correctement. | Panneau préfabriqué avec membrane intégrée (la feuille ne dépasse pas des bords du panneau). | Membrane placée séparément entre la finition et l’isolant (la membrane peut dépasser des bords). | Revêtement en plâtre |
| Possibilités de finitions étanches à l’air | |||
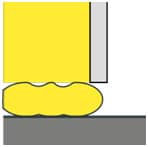 |
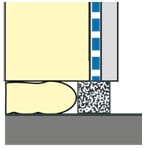 |
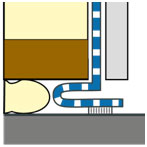 |
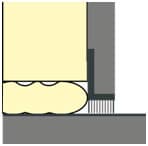 |
| Solutions alternatives | |||
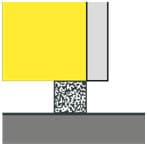 |
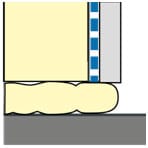 |
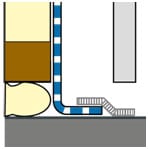 |
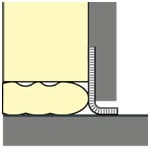 |
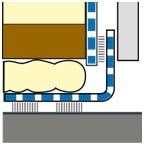 |
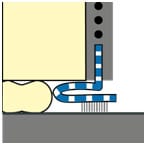 |
||
| Points d’attention | |||
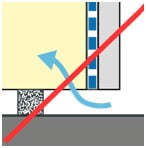 |
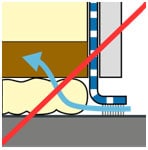 |
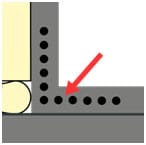 |
|
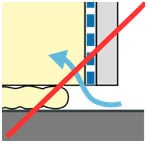 |
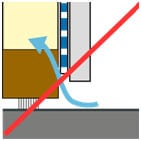 |
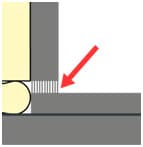 |
|
Les installations électriques (prises et interrupteurs)
Elles sont disposées dans un espace technique (ménagé entre l’isolant (ou le pare-vapeur) et la finition.
Détail en plan et en coupe :
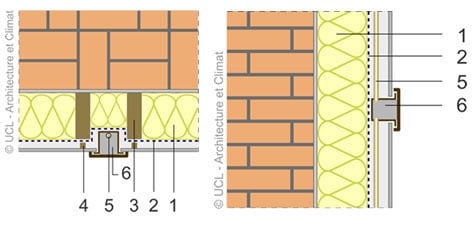
Les canalisations d’eau
Les canalisations encastrées avant rénovation (isolation par l’intérieur) sont réchauffées par l’ambiance intérieure.
Si aucune précaution n’est prise lorsqu’on isole par l’intérieur, la maçonnerie, et avec elle, la canalisation sont directement exposées au climat extérieur et donc au gel.
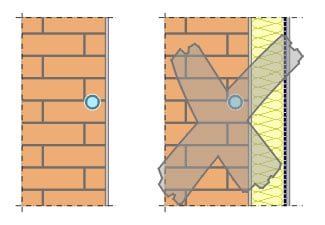
Il existe différentes solutions pour protéger la canalisation contre le gel.
Solution n°1 : déplacer le tuyau et le laisser apparent.
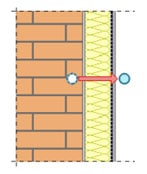
Solution n° 2 : (peu pratique) agrandir la saignée dans laquelle se trouve la canalisation et introduire un isolant thermique (mousse expansée, par exemple.)
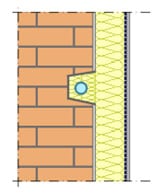
Solution n° 3 : déplacer le tuyau et le placer dans un espace technique ménagé entre l’isolant (ou le pare-vapeur) et la finition.
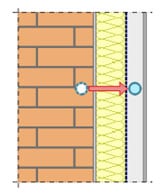
Attention : ne pas traverser le pare-vapeur avec le tuyau !
Les radiateurs
Les radiateurs doivent être déplacés et fixés à la nouvelle paroi. Dans ce cas, la structure doit être renforcée.
Le radiateur peut également être posé sur un pied fixé au sol.
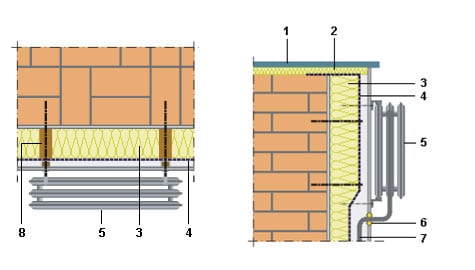
Concernant les tuyaux des radiateurs, ceux-ci peuvent soit rester là où ils sont et être prolongés pour alimenter la nouvelle position du radiateur ou alors ils peuvent être déplacés dans le même plan que les corps de chauffe.
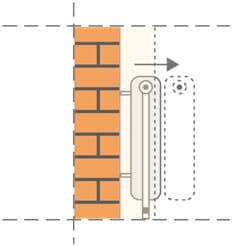
Si on garde le tuyau à sa place :
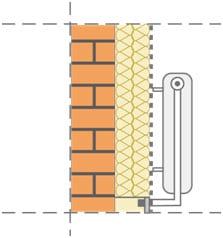
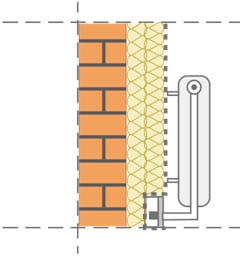
Si on peut déplacer le tuyau :
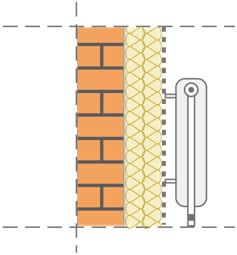
Sol
Lorsque l’isolation des murs est prolongée par l’isolation du sol, cela exige de créer une marche au niveau de l’accès aux autres locaux.
Remplacement des châssis
L’organigramme ((DOBBELS F, RenoFase WP4 – Detaillering van binnenisolatie, WTCB, 2017, p.201)) ci-dessous proposé par Renofase, évoque les différentes solutions envisageables pour le placement de nouveaux châssis dans le cas d’une isolation par l’intérieur.
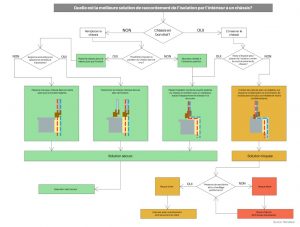
Si vous souhaitez savoir comment évaluer le risque de condensation à partir des données propres à votre bâtiment.
Si vous souhaitez voir, par un exemple, comment évaluer concrètement le risque de condensation au droit d’un pont thermique dans un immeuble de bureau.


Attention ! L’isolation par l’intérieur est la seule technique possible lorsque l’aspect extérieur de la façade doit rester inchangé. Cependant, cette technique d’isolation est délicate et peut engendrer des problèmes. Ainsi, beaucoup d’architectes belges l’évitent.
En respectant une série de principes et en effectuant les vérifications préliminaires nécessaires mentionnées plus bas, cela permet simplement de se mettre le plus possible du côté de la sécurité !
Avant toute chose, il est impératif de traiter tout type de problème d’humidité! Rajouter une couche isolante sur la face intérieur d’un mur a des conséquences importantes sur son comportement hygrothermique. Dès lors, il est impératif de démarrer sur une bonne base, avec un mur sain. Les dommages liés à l’humidité se produisent généralement lorsque des matériaux sensibles à l’humidité sont en contact direct avec celle-ci. La présence de tâches, d’efflorescences, de fissures ou encore d’écaillages sur les murs existants sont autant de signaux révélateurs d’humidité. Le mur doit être complètement sec et exempt de toute trace d’humidité lorsqu’on pose l’isolation par l’intérieur.
Une bonne gestion du climat intérieur a toute son importance dans l’apparition ou non de dommages au niveau des zones sous-isolées. L’ampleur des dégâts est caractérisée par la température ambiante et par l’humidité relative de l’air intérieur. Pour éviter tout risque lié à une isolation par l’intérieur, le bâtiment doit appartenir à la classe de climat intérieur 1 ou 2. Ces classes de confort sont facilement atteintes grâce à des systèmes de ventilation mécanique.
Les ponts thermiques sont les principales failles des systèmes d’isolation par l’intérieur. Ils sont parfois complexes à éliminer mais de nombreuses solutions existent pour les combattre. Une mauvaise gestion des ponts thermiques peut entraîner des moisissures dues à la condensation ainsi que d’importantes pertes d’énergie. Attention cependant que tous les ponts thermiques ne doivent pas nécessairement être réglés. La température minimale de surface dépend beaucoup du climat intérieur : si celui-ci est particulièrement humide, l’augmentation de la température de surface sera plus rapide et une humidité relative critique se produira plus rapidement que dans les climats plus secs. Il est indispensable de ne pas laisser les ponts thermiques insolubles se refroidir trop longtemps pendant les périodes de froid afin que la température de surface des zones non isolées ne tombe pas en dessous de la température en dessous de laquelle le développement de moisissures devient possible.
Des pistes de résolution des situations à risque sont proposées sur cette page.
Pour éviter tout risque de, les systèmes d’isolation par l’intérieur doivent garantir une parfaite étanchéité à l’air. La ruine des parois peut avoir lieu lorsque de l’air chargé en humidité pénètre derrière la couche d’isolation et condense sur l’arrière de celle-ci.
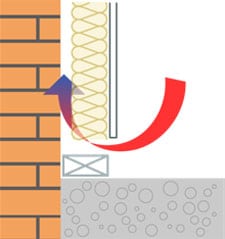
Dans la réalisation d’une enveloppe étanche à l’air, les situations à risque sont les suivantes: le passage des techniques à travers l’enveloppe et les joints entre différents éléments ou matériaux. Des pistes de résolution de ces situations à risque sont proposées sur .
Si vous voulez , il peut être utile de faire appel à un test de pressurisation qui permettra de détecter toutes les fuites, même celles qui ne sont pas visuellement perceptibles. Attention toutefois que ces tests ont pour objectif de détecter les flux d’air qui se produisent entre l’environnement intérieur et extérieur et non au sein d’une construction.
Une fois ces principes pris en compte, une attention particulière doit être portée sur les nœuds constructifs. Un bon traitement de ces nœuds améliore fortement les performances des bâtiments considérés, quelle que soit la technique d’isolation considérée. L’amélioration est de l’ordre de 30 % pour une épaisseur d’isolant de 6 cm et de l’ordre de 70 % pour une épaisseur de 20 cm. Augmenter l’épaisseur d’isolant sans traiter les nœuds constructifs a peu de sens, cela ne permettra pas d’atteindre les performances thermiques recherchées.
Le graphique ci-dessous illustre les valeurs U moyennes des trois façades d’une maison standard, intégrant l’effet des nœuds constructifs pour différentes épaisseurs d’isolant.
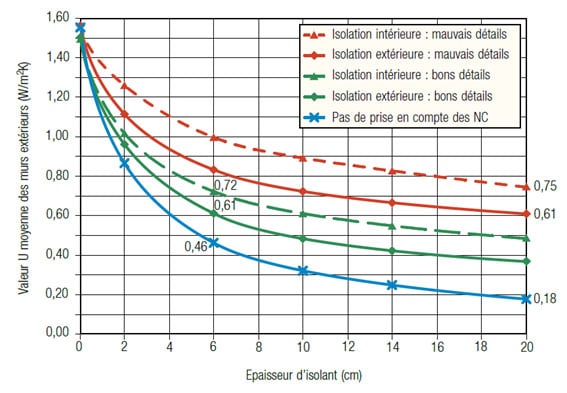
Pour en savoir plus sur les techniques de résolution des nœuds constructifs, consultez notre page : Résoudre les nœuds constructifs – isolation par l’intérieur.
Le mur doit être en bon état
Lorsqu’on isole un mur plein par l’intérieur, les variations de température hiver-été et au cours d’une même journée, deviennent plus importantes. Ce qui augmente les contraintes dans la maçonnerie et peut mener à des fissurations.
Si le mur est déjà fissuré, on peut s’attendre à des dégradations suite à l’apport d’une isolation par l’intérieur.
Le mur doit être sec et protégé contre toute pénétration d’eau
Comme mentionné plus haut, le mur doit être sec et protégé de toute pénétration d’eau de pluie, protégé contre les remontées capillaires et ne plus contenir d’humidité de construction.
L’étanchéité à l’eau de pluie d’un mur plein dépend de son type et de son état.
Lorsque le mur est isolé par l’intérieur, l’eau à l’intérieur de la maçonnerie engendre les 2 désagréments suivants :

En outre, lorsqu’une maçonnerie humide a fait l’objet d’une intervention pour la protéger, il y a lieu d’attendre son séchage (6 mois à plusieurs années selon le type et l’épaisseur du mur) avant d’entamer son isolation par l’intérieur.
La disposition doit permettre de traiter les ponts thermiques
Le climat intérieur doit être “normal”
Le climat intérieur doit correspondre au plus à la classe III.
Dans des bâtiments de classe de climat intérieur IV, le risque de condensation à l’interface maçonnerie-isolant est trop important. Dans ce cas des précautions lourdes doivent être prises : une étude approfondie du système et de chaque détail doit être réalisée par un bureau d’étude spécialisé; un soin particulier doit être apporté à la mise en œuvre; les matériaux devront être judicieusement choisis etc.
L’inertie thermique doit être suffisante
On vérifiera que la capacité thermique des locaux reste suffisante malgré l’apport de l’isolation du côté intérieur des murs de façade.
Voici des indices d’un risque important de surchauffe en été :
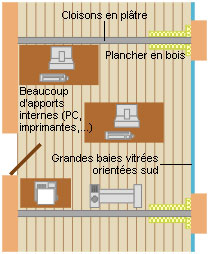
Voici des indices d’un risque faible de surchauffe en été :
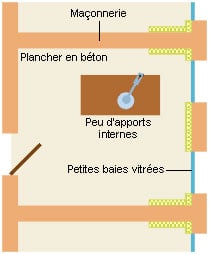
Le CSTC propose une démarche de diagnostic afin d’évaluer la faisabilité d’une isolation par l’intérieur. Elle se concentre sur 4 points d’attention qui se déclinent en différentes nuances, indiquant de la pertinence ou non d’une isolation de ce type.
| Technique applicable | Applicabilité inconnue (des contrôles ou études complémentaires peuvent confirmer l’applicabilité de la technique) | Technique déconseillée en l’état (des interventions visant à corriger les défauts constatés peuvent rendre la technique applicable) | |
| Dégâts visibles | Absence de dégâts visibles (traces d’humidité dans les finitions intérieures, écaillage superficiel des briques extérieures, fissures, …) et de sources d’humidité (procéder éventuellement à des mesures du taux d’humidité au moyen d’un humidimètre électrique, p. ex.) | Absence de dégâts visibles, mais présence de sources d’humidité (humidité ascensionnelle, éclaboussures, …) susceptibles d’en provoquer après la pose de l’isolation (procéder éventuellement à des mesures du taux d’humidité au moyen d’un humidimètre électrique, p. ex.) | Présence de taches d’humidité, front d’humidité, sels efflorescents, algues, fissures, écaillage superficiel des briques extérieures (sensibilité au gel) |
| Exposition à l’humidité et au gel | Typologie de la façade et exposition à la pluie | ||
| · Maçonnerie pleine dont l’épaisseur est constituée d’au moins deux briques ou d’une brique et demie, ou moins, en cas d’exposition limitée à la pluie
· Mur massif en béton coulé · Mur creux (isolé ou pas) · Mur intérieur |
Maçonnerie pleine dont l’épaisseur est constituée d’une brique et demie en cas d’exposition à la pluie moyenne à élevée | Maçonnerie pleine dont l’épaisseur est constituée d’une brique ou moins en cas d’exposition à la pluie moyenne à élevée | |
| Installations techniques | |||
| · Absence de conduites d’eau ou d’autres conduites sensibles à l’humidité ou au gel dans la façade.
· L’absence d’installations techniques nécessitant le percement de l’isolant facilitera la mise en œuvre |
· Présences de conduites d’eau ou d’autres conduites sensibles à l’humidité ou au gel dans la façade. | ||
| Planchers intermédiaires | |||
| Plancher en béton ou structure portante en bois non encastrée dans la façade à isoler | Structure portante en bois sans dégradation encastrée dans la façade à isoler | Structure portante en bois avec dégradations encastrée dans la façade à isoler | |
| Caractéristiques des matériaux | Finition extérieure | ||
| · Absence de finition extérieure
· Finition extérieure en bon état, imperméable à l’eau, mais perméable à la vapeur d’eau |
· Finition extérieure dégradée
· Finition extérieure imperméable à la vapeur d’eau (briques émaillées, carrelages, mosaïque, peinture inadaptée, …) |
||
| Matériaux constitutifs de la face extérieure de la maçonnerie (briques, mortier de pose et de jointoiement) | |||
| Matériaux aux performances connues présentant une résistance au gel suffisante | · Absence de dégâts dus au gel visibles
· Mortier à base de chaux
|
· Dégâts dus au gel visibles
· Eléments identifiés comme non résistants au gel |
|
| Finition intérieure | |||
| · Absence de finition intérieure
· Absence de dégâts visibles (fissures, peinture non adhérente, enduit intérieur dégradé, …) · Absence de parties instables |
· Parties instables
· Finition intérieure ne résistant pas à l’humidité ou imperméable à la vapeur d’eau |
Dégâts visibles (fissures, peinture non adhérente, enduit intérieur dégradé, …) | |
| Les caractéristiques et l’état de la finition intérieure influencent essentiellement le type de système d’isolation par l’intérieur (système collé, création d’une contre-cloison, …) pouvant être installé sur le mur considéré ainsi que la façon de dimensionner celui-ci. La technique d’isolation des murs existants par l’intérieur ne devrait dès lors pas être rejetée uniquement sur la base des critères associés à la finition intérieure. Ces différents éléments sont décrits dans la seconde partie de cet article traitant du choix des systèmes d’isolation par l’intérieur et de leur dimensionnement. | |||
| Climat intérieur et systèmes du bâtiment | Classe de climat intérieur | ||
| Classe de climat 2 | Classe de climat 3 | Classe de climat 4 | |
| Systèmes | |||
| Systèmes de ventilation et de chauffage efficaces et en état de fonctionnement | |||
Il existe de nombreux systèmes d’isolation par l’intérieur.
Choix du système à panneaux isolants collés
Lorsque le mur est sec et sain et présente une surface plane, on choisit le système des panneaux collés.
Les défauts de planéité ne peuvent pas dépasser 15 mm sur une règle de 2 m. Ce système ne peut être utilisé sur des supports ayant connu l’humidité car des sels peuvent apparaître.
Ce système est le moins onéreux et demande le moins d’espace.
Il demande le décapage complet du revêtement (papier-peint, peinture, …) ou du moins aux endroits des plots ou bandes de colle.
Choix d’un système à structure
Lorsque le mur n’est pas suffisamment plan, on choisit un des deux systèmes à structure.
Ceux-ci sont plus chers mais permettent de rattraper les défauts de planéité du mur. Ces systèmes peuvent aussi être choisis si l’on ne souhaite pas enlever le papier peint ou la peinture.
Le système à panneaux composites posés sur lattage possède l’avantage, par rapport au système à panneaux isolants entre lattes, d’apporter une isolation continue. En particulier, lorsque les profilés utilisés sont métalliques, il évite les ponts thermiques au droit de chaque profilé. Ce système permet également d’apposer une couche plus épaisse d’isolant.
Avec un système à panneaux isolant entre profilés métalliques, ces derniers doivent, dans certains cas, pour des raisons de résistance, être placés avec l’ouverture du “u” vers le mur. On doit veiller, dans ce cas, à ce que ceux-ci soient remplis d’isolant.

Choix du système avec isolation derrière contre-cloison maçonnée
L’isolation derrière contre-cloison maçonnée permet de rajouter un matériau lourd devant l’isolant et donc de remplacer, en partie du moins, l’inertie thermique perdue.
Il demande néanmoins un plancher pouvant le supporter. Il ne pourra pas, en principe, être choisi dans le cas d’un plancher entre étages en bois.
Le choix d’un isolant dépend principalement des performances à atteindre après isolation. Les caractéristiques des matériaux isolants à prendre en compte en cas d’isolation d’un mur par l’extérieur donc les suivantes :
Quand doit-on prévoir un pare-vapeur ?
Lorsqu’on utilise un isolant perméable à la vapeur (laine minérale, par exemple) celui-ci doit être précédé, côté intérieur, par un pare-vapeur de manière à éviter le risque de condensation interne.
L’utilisation d’un isolant peu ou pas perméable à la vapeur (EPS, XPS, PUR, CG) collé sur la maçonnerie, ne nécessite pas l’interposition d’un pare-vapeur pour autant que de l’air intérieur NE puisse PAS circuler entre isolant et maçonnerie.
Aussi, si ce type d’isolant est mis en œuvre entre lattes, la pose du pare-vapeur reste indispensable. Celui-ci couvre alors l’ensemble du système “isolant + lattes”.
Quel pare-vapeur choisir ?
L’évaluation du risque principal de condensation par modèle statique (comme celui de Glaser) entraîne presque systématiquement le choix d’une membrane très étanche à la vapeur du côté intérieur. On les appelle souvent les “pare-vapeurs”. Lorsque l’on affine l’analyse, il apparaît que le choix d’une membrane plus faiblement étanche à la vapeur est parfois suffisant. On parle alors de “freine-vapeur”. La valeur Sd des pare-vapeur n’est pas définie avec précision, mais en pratique, elle sera de plusieurs dizaines de mètres (par ex. 50 ou même 100 m) alors que la valeur Sd des freine-vapeur ne sera que de quelques mètres seulement (par ex. 2 m à 5 m, mais rarement plus de 10 m).
Le choix d’un freine-vapeur, plus ouvert au passage de la vapeur, permet souvent de se prémunir du risque, dit secondaire, de condensations internes en été ou au printemps, ou quand la pression de vapeur est plus importante à l’extérieur qu’à l’intérieur et que la vapeur a donc tendance à traverser la paroi de l’extérieur vers l’intérieur. En effet, le flux de vapeur n’est pas complètement bloqué vers l’intérieur ce qui facilite le séchage du mur.
D’autres membranes, dites intelligentes, sont de ce point de vue encore plus adaptées. En effet, leur perméabilité à la vapeur évolue avec l’humidité relative. Elles sont conçues pour être relativement fermées à la vapeur quand l’humidité relative est faible et pour s’ouvrir au passage de la vapeur quand l’humidité relative est plus élevée. Ce principe est illustré ici.
Outre les risques de condensations, il est important de faire remarquer que certains matériaux dits hygroscopiques, comme le bois et les matériaux dérivés du bois, mais aussi d’autres matériaux comme la terre crue, ont le pouvoir de réguler l’humidité de l’ambiance intérieure en captant l’humidité en excès pour la restituer plus tard, atténuant ainsi les effets désagréables d’ambiances trop sèches ou trop humides. On parle alors parfois d’inertie hydrique par analogie avec l’inertie thermique. Malheureusement, peu de valeurs sont disponibles. Ce domaine devrait faire l’objet de recherches complémentaires et dépasse le cadre d’Énergie+. Remarquons seulement que la présence d’une membrane atténue fortement l’effet hygroscopique des couches sous-jacentes, et notamment celui de l’isolant.
Remarquons enfin que la présence d’une membrane, en plus de permettre la régulation de la vapeur, permet aussi de bloquer le passage de l’air et donc d’éviter le risque de condensation par convection, pour autant bien sûr que la mise en œuvre soit d’une qualité irréprochable (notamment au niveau des nœuds constructifs).
Comment assurer la continuité de la fonction “pare-vapeur” :
Lorsque la fonction “pare-vapeur” est assurée par les panneaux, la continuité de la fonction “pare-vapeur” est assurée en fermant les joints entre panneaux ou entre panneaux et raccords au moyen :
Lorsque le système nécessite un pare-vapeur indépendant, celui-ci doit être placé avec recouvrements. Les recouvrements et les raccords doivent être fermés au moyen :
Il faut vérifier auprès des fabricants que le produit assurant la continuité du pare-vapeur proposé corresponde à la classe du pare-vapeur demandé.


Comme mentionné en introduction du dossier consacré à la rénovation des écoles, l’énergie de chauffage dans une école représente en moyenne 60 à 70% des consommations totales. Cette part importante du poste chauffage est liée d’une part à une faible performance énergétique des bâtiments.
Dans le cas de rénovations de bâtiments scolaires dans une démarche zéro carbone, il est prioritaire de réduire cette consommation excessive de carbone liée à l’énergie de chauffe. Pour cela, des solutions « classiques » peuvent être envisagées (changement combustible, remplacement de la chaudière…). Ou alors, dans une démarche plus innovante, nous proposons 3 pistes de réflexion afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone souhaité :
Face aux enjeux énergétiques auxquels nous faisons face aujourd’hui, il s’avère de plus en plus clairement qu’un changement radical de nos pratiques et de nos standards de confort thermique s’impose afin de réduire les émissions de carbone liées à notre consommation d’énergie.
Qui dit repenser les besoins thermiques, dit aussi repenser les attentes thermiques des occupants. Celles-ci reposent habituellement sur un modèle classique d’espaces chauffés à une température standard de 20°, par un système de chauffage centralisé alimentant en chaleur l’ensemble du bâtiment. Cependant, dans une optique zéro-carbone, il est intéressant de retourner le modèle en se basant sur un principe visant à “chauffer les personnes, pas le bâtiment”. Ou encore, en poussant cette réflexion à l’extrême, il serait également envisageable de ne plus avoir recours à un contrôle permanent sur l’ambiance, mais uniquement à un apport ponctuel à certains moments critiques (relance…). Ceci est particulièrement vrai dans les école où la densité d’occupants constitue un apport thermique significatif.

Effet du chauffage par air Ce dont nous avons besoin
Une vue de l’esprit ? Pas si sûr : la théorie du confort adaptatif met en évidence l’existence, moyennant la présence d’opportunités adaptatives dans le bâtiment, de plages de températures dites “confortables” plus larges que celles dont nous avons l’habitude. Cette théorie est généralement appliquée uniquement pour la réponse aux surchauffe, faute d’études suffisante en hiver. Mais elle mérite d’être explorée.
Selon cette théorie, il serait possible de réduire les besoins thermiques à l’école en offrant aux occupants des capacités d’adaptation pour corriger localement leur ressenti. On ne parle donc pas ici de simplement placer une vanne thermostatique, mais des mettre à dispositions des solutions individuelles et proches du corps, regroupées sous l’appellation “systèmes de confort personnels (PCS)”.
Comme mentionné plus haut, agir sur les flux de chaleur intérieur-extérieur passe par un travail accru sur les niveaux d’isolation et d’étanchéité de l’enveloppe. Néanmoins, dans une optique zéro-carbone, “isoler plus” rime inévitablement avec “plus de carbone”. En effet, ce qui peut paraître négligeable dans un contexte global de faible efficacité énergétique devient significatif, voire prépondérant au regard de l’objectif de sobriété et d’efficacité à atteindre.
Il en va ainsi de l’énergie grise. Négligeable dans une construction courante au regard de l’énergie utilisée pour l’exploitation du bâtiment tout au long de son cycle de vie, elle devient significative pour une construction performante énergétiquement. Bien que le choix de matériaux durables – excepté leurs performances d’isolation thermique – ne soit pas une obligation pour viser les normes QZen ou plus ambitieux, il y trouve un champ d’application tout à fait opportun.
Personne n’aura pu y échapper, aujourd’hui, la tendance en termes d’isolation tend vers “toujours plus”. En effet, au cours de ces dernières années, les réglementations concernant les niveaux U des parois ne cessent de se renforcer, visant des niveaux de conductibilité thermique toujours plus faibles.
Réduire les échanges de chaleur entre intérieur et extérieur dans une démarche zéro carbone nécessite donc de trouver un réel équilibre entre le coût en carbone des matériaux utilisés pour améliorer l’isolation et la consommation en carbone liée à l’énergie de chauffage.
L’idée vous intéresse ? Consultez notre article « améliorer l’enveloppe dans une démarche zéro-carbone« .
En poussant les deux pistes ci-dessus à l’extrême, pourrait-on envisager de se passer complètement de chauffage ? Nous avons étudié cela sur base de simulations thermiques dynamiques, en considérant une salle de classe typique. Celles-ci ont porté sur l’influence du changement d’orientation de la classe et sur le changement de position dans le bâtiment. Voici nos conclusions :
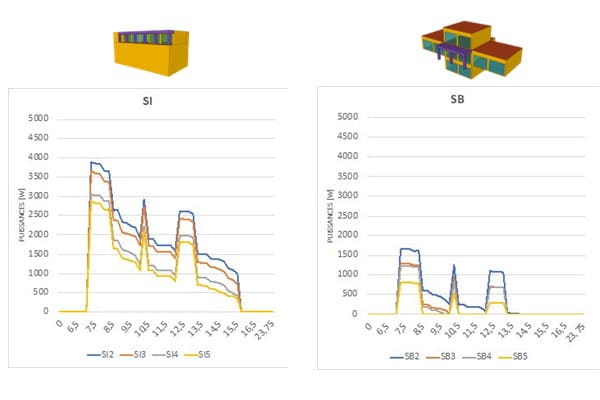
Classe non mitoyenne orientée « ouest » Classe mitoyenne orientée « ouest »
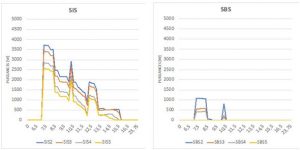
Classe non mitoyenne orientée « sud » Classe mitoyenne orientée « sud »
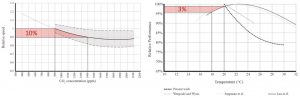
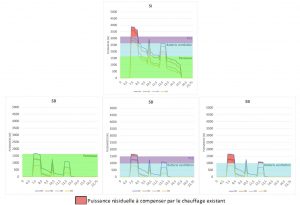
Supprimer le chauffage dans les écoles est une utopie qui permet de remettre en questions beaucoup de pratiques concernant les activités scolaires, l’organisation des espaces et les besoins thermiques. Se passer d’un contrôle permanent sur l’ambiance est une opportunité pour créer un programme scolaire en adéquation avec les activités pédagogiques et l’environnement naturel qui l’entoure. Agir sur le besoin de chauffage des occupants est un projet éducationnel intégrant des éléments d’architecture. Ces considérations poussent donc à concevoir nos écoles de manière différente, en réfléchissant aux usages, au degré d’ouverture, et aux besoins en chaleur de chaque espace((Siraut, Astrid. Vers une école sans chauffage : adaptabilité de la construction et des occupants. p.67, Faculté d’architecture, ingénierie architecturale, urbanisme, Université catholique de Louvain, 2020. Prom. : Geoffrey Van Moeseke – http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:24912 )).
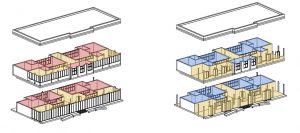
Stratégie hiver (fermé) Stratégie été (ouvert)
Imagination de composition architecturale selon les ambiances thermiques et les besoins scolaires
Une fois les deux pistes précédentes prises en compte et les besoins thermiques de l’école considérablement diminués, il est nécessaire de se focaliser sur les technologies. Aussi réduites soient-elles, les consommations en énergie de chauffage de l’école devront être assurées par des techniques cohérentes avec l’objectif zéro-carbone de l’école. A ce titre, toute combustion d’énergie fossile doit être proscrite. Cela laisse donc deux possibilités : la biomasse et l’électricité par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur, mais dans les deux cas, sous certaines conditions seulement. Quelles sont-elles ?
Pour la biomasse, il faut s’assurer que la ressource brûlée est effectivement “neutre en carbone”, ce qui n’est pas si évident. Pour en savoir plus, allez consulter la rubrique « impact environnemental et socio-économique » de cet article. En plus de cela, le mode de production d’énergie doit être soit très efficace en termes de rejet de carbone, soit avoir un très haut rendement (chaudière bois-énergie), soit être une cogénération. Attention toutefois à la complexité des systèmes de cogénération, qui rendent l’application en milieu scolaire difficile (à moins de passer via un tiers investisseur).
Dans le cas présent d’installations de chauffage dans des écoles à optique zéro-carbone, les technologies de biomasse s’y prêtent relativement bien. Au-delà des avantages et inconvénients évoqués ici, la biomasse offre un potentiel communautaire non négligeable par le développement de synergies territoriales autour de modes de chauffage. Pour en savoir plus sur les communautés d’énergies, consultez cet article.
Pour l’électricité, il faut s’assurer que celle-ci provienne le plus possible d’une source renouvelable. Idéalement, le besoin électrique sera compensé par une production sur site, pour obtenir un bilan annuel équilibré. On parlera alors de bâtiment zéro-énergie (ZEB). Cela nous amène à envisager des sources de production renouvelables , qui sont traitées plus loin dans ce dossier.Et bien sûr, pas question de se contenter de résistances thermiques pour alimenter un réseau de chauffage central. La pompe à chaleur est la condition sine qua non du recours à l’électricité pour le chauffage.
Les pompes à chaleur peuvent, en étant multipliées et fonctionnant par zone, offrir des gammes de puissance suffisantes afin de répondre aux besoins d’une école. Cependant, tout comme pour la biomasse, les systèmes peuvent prendre beaucoup de place et générer du bruit. Une étude préliminaire sur l’implantation des unités extérieures sur le site de l’école est donc impérative. En fonction du site de l’école, cette technologie permet également de tirer parti des techniques de géothermie afin de proposer une production d’énergie au bilan carbone neutre. La pompe à chaleur offre donc de nombreux avantages en termes de neutralité carbone de l’école, mais à quel prix ? Des études de faisabilité et de rentabilité sont indispensables avant de se lancer dans de tels projets pour une école.


La production d’énergie renouvelable sur le site par des technologies peu émettrices en carbone reste la meilleure manière pour des écoles d’atteindre le net zéro énergie et donc le net zéro carbone.
Une bonne utilisation de ces technologies renouvelables peut permettre de combattre les pics d’énergie de pointe, de compenser le talon de consommation de l’école, ou encore, dans les meilleurs cas, de couvrir l’ensemble des besoins en énergie de l’établissement. Il faut cependant éviter de tomber dans le travers d’un système renouvelable devant compenser des performances thermiques limitées d’un bâtiment ! Il est et sera toujours mieux de chercher à se passer d’un appoint d’énergie que de la produire de manière renouvelable.
De plus, la présence et la visibilité de sources de production d’énergie renouvelable sur le site de l’école s’accompagnent de potentiels pédagogiques non négligeables.
En moyenne, les écoles en Wallonie consomment en électricité 200 kWh/élève par an. Pour les écoles de taille moyenne, la consommation annuelle en électricité (sans ventilation) revient donc à 80 000 kWh.
Si l’on considère une réduction de 20% de celle-ci grâce à des actions comme celles proposées par le défi Génération 0 Watt, on peut considérer des consommations se situant autour des 160 kWh/élève par an comme base de travail.
Certains établissements ayant effectué un travail beaucoup plus important peuvent atteindre des consommations bien plus basses, de l’ordre de 50 kWh/élève par an. On peut majorer ces chiffres de 7 à 13 kWh/an par élève lorsqu’on ajoute un système de ventilation simple ou double flux.
Le tableau ci-dessous reprend les consommations électriques et thermiques théoriques moyennes en fonction du degré de rénovation. Ceci permet donc d’une part de se situer par rapport aux autres établissement et d’autre part d’évaluer le potentiel d’efficacité d’une production d’énergie renouvelable.
| Actuel | Actuel 0 Watt
(-20%) |
Rénovation presque passive | Rénovation passive | |
| Electrique (sans chauffage) | 200 kWh/élève.an
25kWh/m².an |
160 kWh/élève
20kWh/m².an |
50 kWh/élève
6kWh/m².an |
25 kWh/élève
3 kWh/m².an |
| Thermique | 1100 kWh/élève
138kWh/m².an |
Même que l’actuel car 0 Watt agit sur la consommation électrique surtout. | 240 kWh/élève
30 kWh/m².an |
120 kWh/élève
15 kWh/m².an |
| VMC | / | / | 10 kWh/élève | 7 kWh/élève |
Il existe plusieurs sources de production d’énergie renouvelable. Les panneaux photovoltaïques et l’éolien sont les plus propices à être utilisés dans des bâtiments scolaires. Dans ce type de bâtiment, il est impératif d’utiliser des technologies qui soient faciles en maintenance et en entretien afin qu’elles puissent faire profiter au mieux de leur plein potentiel. La cogénération est donc plus délicate, mais pas à exclure pour autant.
Bien que la dimension technique soit probablement la plus efficace dans la diminution des émissions de carbone, elle peut facilement entraîner l’effet inverse. En effet, il est nécessaire pour les écoles d’avoir des responsables énergie et des équipes pédagogiques formées en amont du passage à l’action, pour une mise en place efficiente des systèmes. Equiper les écoles d’installations très performantes mais complexes à gérer ne fonctionne pas. Les écoles ne possèdent actuellement pas de gestionnaires techniques capables d’assurer la gestion de ces systèmes. La rénovation zéro carbone de manière générale est donc une tâche très complexe qui fait appel à toute une série de technologies et qui nécessite une sensibilisation et un renforcement des compétences des parties prenantes.
Le photovoltaïque est la technologie la plus adaptée pour des écoles, elle demande peu de maintenance et offre un rendement efficace pour les consommations électriques d’une école. Mais attention que les panneaux photovoltaïques prennent énormément d’espace ! De grandes surfaces de toiture sont donc nécessaires pour une installation optimale.
A titre d’exemple :
Il faudra environ 600 m² de panneaux (plus de 300 panneaux) ((https://www.ef4.be/fr/pv/composants-dun-systeme/dimensionnement-projet-photovoltaique.html)).
Il faudra presque 200 m² de panneaux (une centaine de panneaux).

Pour plus d’informations sur la technologie photovoltaïque, consultez les pages suivantes :
Éolien
Une autre possibilité de production d’énergie verte pour l’école est le petit éolien. C’est une technologie qu’on rencontre moins mais qui n’est toutefois pas à négliger. Elle permet, avec relativement peu de moyens, de compenser des besoins électriques faibles. En effet, le petit éolien trouve sa place dans des écoles de petite taille ou dans des écoles ayant déjà réduit considérablement leurs besoins en électricité.
A titre d’exemple :
Cependant, la majorité du temps, l’éolienne ne fonctionne pas à puissance nominale, le vent n’étant généralement pas suffisant pour garantir cela. Du coup, il faudra une puissance installée supérieure avec des éoliennes qu’avec des centrales classiques pour atteindre une même production d’énergie annuelle. Il est possible recalculer le nombre d’heures que l’éolienne doit tourner à puissance nominale pour débiter la même production électrique annuelle (avec un vent dont la vitesse varie). Typiquement, la production annuelle électrique d’une petite éolienne en Wallonie correspond à 11 % du temps à puissance nominale.

Les petites éoliennes ((Images provenant de https://neonext.fr/eolienne-skystream/)) ne sont pas toujours à axe horizontal comme sur les images ci-dessus. On retrouve de plus en plus d’éoliennes à axe vertical, principalement en milieu urbain. Elles s’y adaptent particulièrement bien car elles peuvent fonctionner avec des vents venant de toutes les directions. De plus, elles sont relativement silencieuses, peuvent facilement s’intégrer à l’architecture des bâtiments, permettent de placer la génératrice au niveau du sol et ne nécessitent pas de mécanisme d’orientation((https://energie.wallonie.be/fr/vade-mecum-pour-l-implantation-d-eoliennes-de-faible-puissance-en-wallonie.html?IDD=77455&IDC=6170)).
Les projets de petit éolien permettent donc d’organiser son indépendance énergétique moyennant certaines formalités. Les démarches administratives, les contraintes urbanistiques ou encore les limites techniques sont autant d’obstacles qui peuvent freiner les porteurs de projets à s’orienter vers ce type de production d’énergie. Le vade-mecum de la Région Wallonne pour l’implantation d’éoliennes à faible puissance vous accompagnera dans toutes vos démarches et questions relatives à cette technologie. Vous pouvez également prendre connaissance de ce projet de construction d’éolienne par des élèves pour leur école à Verviers.
Pour encore plus d’informations sur la technologie éolienne, consultez les pages suivantes :
Elle permet de couvrir relativement aisément les besoins en électricité d’une école. Cependant, la cogénération n’est pas la technologie la plus adaptée dans ce contexte car elle demande trop de maintenance et de gestion. A ce jour, les écoles n’ont pas de personnel spécialisé ou de gestionnaire technique attitré pour gérer le fonctionnement d’installations comme celles-ci.
Toutefois, il peut être intéressant pour une école d’avoir recours à la cogénération par le biais d’un tiers investisseur. Celui-ci s’occupe des études préliminaires, de l’installation et de la maintenance, sans que l’école ne doive intervenir. Ou encore, l’école peut se greffer à des réseaux de chaleurs existants dans son quartier/sa commune, dont l’énergie partagée est produite via des technologies de cogénération.
La production d’énergie renouvelable au sein de l’école offre de nombreux avantages, dont celui d’offrir le potentiel de créer des communautés d’énergies. Les installations de production d’énergie dans les écoles produisent occasionnellement un grand surplus d’énergie, qu’il est bénéfique de faire profiter au plus grand nombre. Le regroupement autour d’un projet de communauté d’énergie permet ce partage.
Les écoles ont un rôle moteur au sein de ces communautés. Les établissements scolaires, par leur caractère éducatif, pédagogique, social et institutionnel, participent à stimuler et activer la société. En adoptant un comportement exemplaire en faveur de la transition énergétique, les écoles deviennent également des vitrines qui portent un rôle exemplatif auprès des pouvoirs publics (particulièrement les écoles du réseau officiel).
Par ailleurs, la communauté d’énergie permet à l’école un retour sur investissement plus rapide des installations de production d’énergie. En effet, l’école profite d’un bénéfice en revendant son surplus d’énergie à un prix supérieur au prix du kWh renvoyé sur le réseau.
Pour plus d’informations à ce sujet n’hésitez pas à consulter la page consacrée aux communautés d’énergie.

Depuis 2020, une école de la commune de Ganshoren à Bruxelles a établi un projet de communauté d’énergie renouvelable autour de partage d’électricité. Celle-ci est produite tant par des panneaux disposés sur le toit de l’école (34,77 kWc) ainsi que chez un particulier (2,4 kWc) habitant dans le quartier de l’école.
Les surplus d’électricité venant de ces deux sources de production permettent d’alimenter en électricité verte une quinzaine de résidents du quartier ayant été équipés de compteurs intelligents.
Le surplus d’énergie autoconsommée est actuellement en grande partie complété par de l’électricité complémentaire venant de fournisseurs.
L’autoconsommation du surplus est vouée à de nombreuses améliorations, au fur et à mesure que les membres de la communauté s’habituent à une nouvelle gestion de leurs consommations électriques.
Pour plus d’informations sur le projet : https://nosbambins.be/

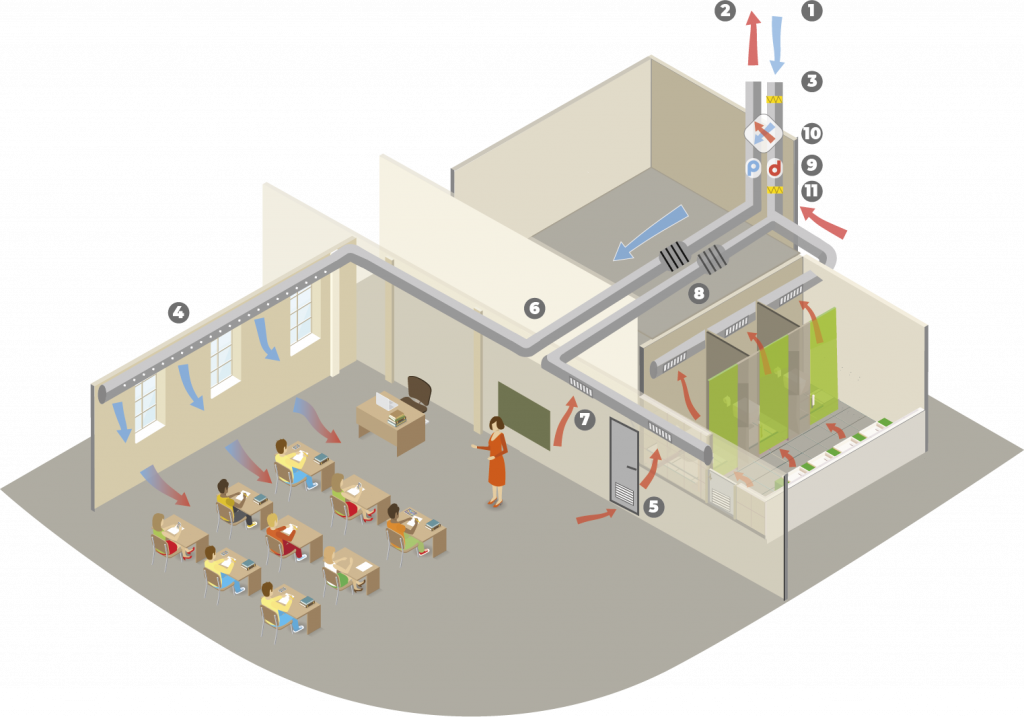
© Architecture et climat 2023.
L’objectif principal de la ventilation des salles de classe est de créer des conditions environnementales intérieures qui réduisent le risque de problèmes de santé chez les élèves et minimisent leur inconfort, afin d’éliminer tout effet négatif sur l’apprentissage.
Des expériences récentes montrent que des taux de ventilation inadéquats dans les salles de classe peuvent entraîner une prévalence élevée de symptômes de santé aigus, réduire la vitesse à laquelle les tâches linguistiques et mathématiques typiques du travail scolaire sont exécutées par les élèves, et peut réduire les progrès de l’apprentissage tels que mesurés par le nombre d’élèves qui réussissent les tests standard de mathématiques et de langues. Elle peut également accroître l’absentéisme, ce qui est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur l’apprentissage. Ces effets donnent lieu à des coûts socio-économiques importants.
Malgré cet ensemble croissant de preuves, la plupart des données publiées dans la littérature scientifique indiquent que la ventilation des salles de classe dans de nombreuses écoles est encore inadéquate et que les taux d’apport d’air extérieur dans les écoles sont considérablement plus faibles que dans les bureaux, voire dans de nombreux cas plus faibles que ceux observés dans les habitations.
Les taux de ventilation sont réglementés par le code de bien-être au travail et par des arrêtés royaux. Le minimum régional imposé par la PEB est clair, il vise un débit de 22 m3/h par personne. Le code du bien-être au travail demande quant à lui minimum 40 m3/h par personne, ce qui permet d’atteindre moins de 800 PPM dans une classe de taille moyenne (24 enfants). Cependant, le deuxième chiffre clé de la directive est le seuil limite de 900 PPM. Assurer un débit de 32m3/h par personne permet de supposer celui-ci respecté.
La directive du code du bien-être au travail propose également une dérogation pour pouvoir se limiter à un débit de 25 m3/h ou 1200 PPM. Cette dérogation demande une analyse de risques des polluants dans la classe et un plan d’action sur quelques années. Les sources de polluants sont nombreuses dans les classes (colles, revêtements, peintures, produits d’entretien…), rendant cette dérogation difficilement applicable. Si toutefois, vous envisagez une telle dérogation, adressez-vous au conseiller en prévention compétent.
Seul des systèmes de ventilation mécanique à double flux permettent de respecter ces débits réglementaires. Grâce à une récupération de la chaleur des flux sortants, le système D limite l’inconfort et les besoins de chauffe dans les classes, le rendant particulièrement adapté à la démarche zéro-carbone.
Le système de ventilation double flux, c’est-à-dire équipé d’une pulsion et d’une extraction mécanique ainsi qu’un échangeur de chaleur, est le meilleur en terme de maîtrise des débits dans les locaux.
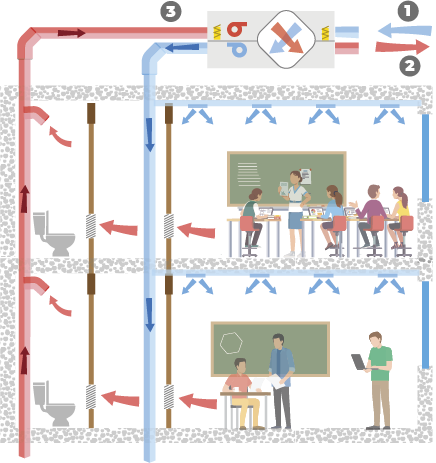
© Architecture et climat 2023.
Ce système est pratiquement indispensable dans les écoles en site urbain.
La distribution de l’air neuf est assurée par un réseau de conduits placé par exemple dans les faux plafonds des zones de circulation.
La diffusion de l’air neuf à l’intérieur de chaque classe est obtenue par une ou plusieurs bouches, soit murales, soit plafonnières.
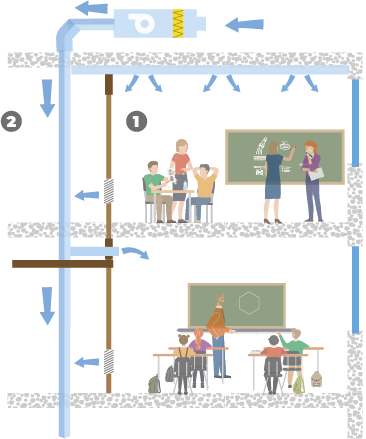
© Architecture et climat 2023.
L’extraction et le transfert se font comme pour le système simple flux. Vu l’importance des débits mis en jeu, l’extraction peut ne pas se limiter aux seuls sanitaires et se distribuer sur une partie des espaces de circulation, ceci pour éviter des courants d’air dans les sanitaires. Dans certains cas, l’extraction (ou une partie de celle-ci) pourra se faire directement dans les classes.
Concrètement, le choix du double flux par rapport au simple flux sera guidé par :
le besoin d’augmenter la température de l’air neuf.
Comme dit précédemment, la principale difficulté réside en l’encombrement des réseaux, qu’il n’est pas toujours possible d’intégrer dans un bâtiment existant. Dans certain cas, une décomposition du bâtiment en différentes zones équipées chacune de leur propre groupe et réseau de ventilation peut simplifier le problème : une ventilation avec pulsion et extraction mécanique là où c’est possible, une simple extraction ailleurs.Il peut aussi être préférable d’opter pour des systèmes D de ventilation décentralisés, limitant l’encombrement causé par les gaines et les consommations électriques.
Pour les principes généraux sur les systèmes centralisés/décentralisés, consultez la page suivante: Choisir un système de ventilation centralisé ou décentralisé
Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de la ventilation afin de prévenir la dispersion d’agents pathogènes, n’hésitez à consulter l’article réalisé en juillet 2020 durant la pandémie du COVID-19.
| Avantages |
Ventilation décentralisée
|
Ventilation centralisée
|
| Inconvénients |
|
|
A ne pas oublier : les classes sont souvent sujettes à la surchauffe en fin de printemps et dans les premières semaines de l’année. Le décalage du calendrier scolaire vers le mois d’août va renforcer ce risque. Pour limiter cela, il faut pouvoir combiner des protections solaires et l’ouverture des fenêtres, ce qui n’est pas toujours évident. Dès lors, une fonction « Free-Cooling » sur la VMC est utile : un enclenchement de la ventilation au débit correspondant à une classe occupée lorsque la température intérieure monte (25 … 26°C°) alors que la température extérieure reste agréable.
Enfin, pensez à exiger un système qui vous permette un suivi à distance : visualisation des courbes de débits brassés, de qualité d’air, température et humidité dans les classes, avec des alarmes programmables et, si possible, une possibilité de modification des paramètres de régulation à distance
Si la réalisation d’un système D n’est pas envisageable dans le projet de rénovation, il existe d’autres moyens pour ventiler la classe. Toutefois, ces stratégies sont nettement moins efficaces et ne permettront pas d’atteindre les débits réglementaires. De plus, sans système D, il n’y a pas de récupération de chaleur possible, ce qui accentuera sensiblement les besoins de chaleur de l’école et donc indirectement les factures liées à la consommation énergétique de chauffage.
La ventilation par ouverture des fenêtres est bien souvent l’unique moyen de ventilation utilisé dans la majorité des écoles actuelles, malgré qu’elle réponde difficilement aux critères d’hygiène et de confort exigés :
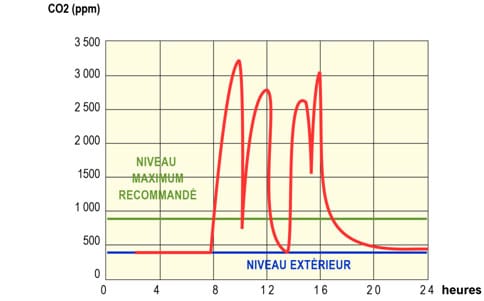
Lorsque l’ambiance extérieure (bruit et pollution limités) le permet, la solution la plus simple à mettre en œuvre est le système simple flux avec extraction sanitaire.
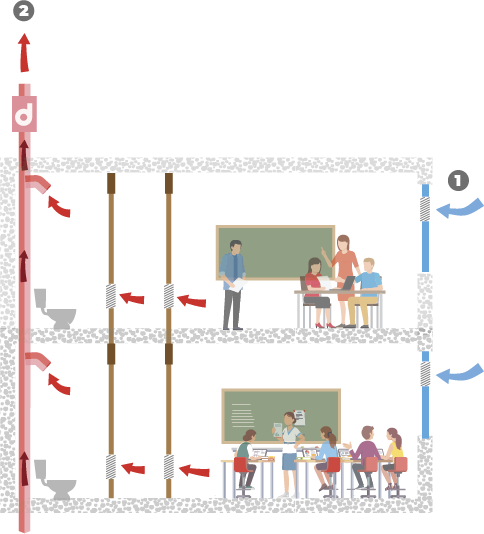
© Architecture et climat 2023.

Grille intégrée entre le vitrage et la menuiserie Grille verticale intégrée dans la menuiserie

Grille de transfert d’air
Exemple
Dans une école du Brabant wallon, l’air neuf est introduit dans les classes par des ouvertures auto réglables et transféré sous les portes vers les sanitaires.

Les circuits d’extraction (conduits et ventilateurs) sont, dans la plupart des cas, communs à plusieurs niveaux. Ils sont généralement conçus suivant le principe du “parapluie”. Les conduits verticaux empruntent les gaines techniques également verticales et les conduits horizontaux passent dans l’épaisseur des faux plafonds. Ces ensembles desservent à chaque niveau une ou plusieurs zones sanitaires.
Étant donné l’absence de conduit de distribution vers chaque classe, l’espace nécessaire aux locaux techniques et aux conduits d’air est peu important. Ceci prend toute son importance en regard des hauteurs de faux plafonds qui n’ont pas à tenir compte du passage de conduits d’air.
Ce système appliqué aux écoles présente comme inconvénients :
A lire également afin d’aller plus loin sur cette thématique : Les différents systèmes de ventilation expliqué aux responsables énergie


Selon les derniers chiffres publiés par la Région, le parc immobilier des bâtiments scolaires est, tout comme la majorité du parc tertiaire, vétuste et très hétéroclite. Concrètement, 74 % des bâtiments destinés à l’enseignement en 2008 dataient d’avant 1945. Par la suite, 8 % ont été construits ou rénovés en profondeur entre 1945 et 1995. Depuis lors, la tendance et/ou la nécessité de rénovation de ces bâtiments augmente et 15% de ceux-ci ont donc subi une grosse rénovation((SPW Wallonie – STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT (p.28) )).
Pour continuer sur cette lancée et pour diminuer davantage ses émissions de GES, la Wallonie a établi une stratégie ambitieuse de rénovation à l’échelle des bâtiments tertiaires. L’objectif de celle-ci est de “tendre en 2040 vers un parc de bâtiments à bilan énergétique annuel nul pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement et l’éclairage. Ces bâtiments produiront autant d’énergie qu’ils en consomment, en tenant compte qu’une partie de la production d’énergie d’origine renouvelable pourra être décentralisée” ((SPW Wallonie – STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT (p.33) )). Cette stratégie de rénovation wallonne s’oriente selon 3 axes principaux ((SPW Wallonie – STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT (p.100) )):
Depuis lors, d’autres politiques se sont mises en place pour tendre au mieux vers cette ambition. C’est le cas de la Déclaration de Politique Régionale (DPR) qui renforce cet objectif en formulant une étape intermédiaire à 2030. “La Wallonie vise la neutralité carbone au plus tard en 2050, avec une étape intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % par rapport à 1990 d’ici 2030 ».
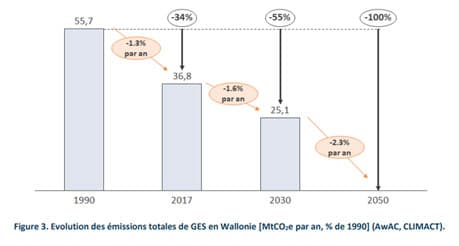
Schéma provenant du rapport « Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment »((SPW Wallonie – STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT (p.19) )).
Ces échéances légales permettent d’établir des visions à court et long terme quant à l’ampleur des travaux à effectuer. Ces plans d’action, tel que celui proposé par Climact, décomposent la tâche en 3 phases.
Premièrement, il est primordial de développer un modèle qui soit viable en mobilisant les différents acteurs, en identifiant les barrières, les possibilités de financement etc… Par la suite, ce modèle sera testé à travers une série de projets pilotes. En fonction des résultats observés, celui-ci pourra être adapté pour être déployé à grande échelle dans les années à venir.
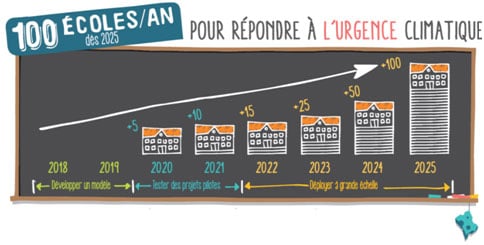
CLIMACT, Bridging the gap between schools and market players for performance – based renovations
Ces politiques et stratégies ambitieuses à l’échelle du bâtiment nécessitent donc un suivi et une mise en œuvre efficace permettant d’atteindre les objectifs visés en termes de bâtiments efficaces et performants énergiquement. Pour cela, une réflexion à une échelle plus large s’impose en amont des travaux quant aux enjeux de la rénovation zéro carbone.
Attention ! Ne pas s’y prendre trop vite…
Le schéma ci-dessous illustre bien le déroulement de travaux en général et le contexte difficile qui caractérise les bâtiments scolaires. Souvent portés par de multiples motivations et/ou besoins, les travaux envisagés dans les écoles se voient toujours limités à cause d’une série de contraintes, aboutissant à un résultat moins efficace qu’imaginé au départ. Il existe en effet un décalage énorme et certain entre la réalité et l’école exemplaire durable.
La suite de cet article vous aidera à cadrer, dès le départ, les possibilités et les contraintes liées à la réalisation de travaux dans votre école. L’objectif étant de prévoir les travaux les plus efficaces pour atteindre les meilleures performances énergétiques.
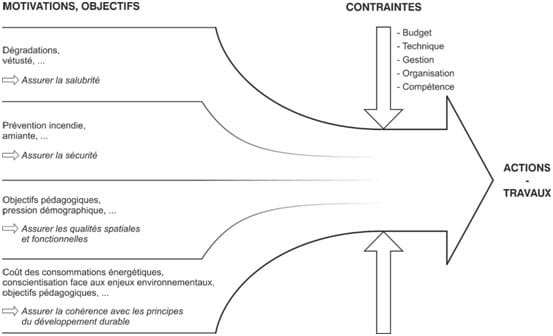
Schéma réalisé par Catherine Massart (Architecture et Climat) pour le site rénovermonecole.be
Avant toute chose, quatre réflexions générales nécessitent d’être abordées :
Avant de se lancer dans des travaux généraux sur la totalité du bâtiment, il est utile de faire un diagnostic de la situation actuelle afin de mieux visualiser où sont les faiblesses qui nécessiteront donc une intervention prioritaire par rapport à d’autres. Pour vous aider dans ces démarches, vous pouvez consulter ces deux outils ou bien déléguer le diagnostic à un bureau spécialisé :
Beaucoup de travaux peuvent être fait sans l’intervention d’un bureau d’étude, mais ce n’est pas le cas pour tous. Si vous n’êtes pas certain de l’état de votre bâtiment, que vous avez un projet général d’agrandissement ou d’adaptation aux normes PMR et incendie ou que vous ne savez pas comment interpréter les recommandations du gouvernement, il sera préférable d’être assisté par un bureau spécialisé, dès les prémisses du projet.
Le budget n’est pas la seule contrainte qui peut vous occuper. Si votre bâtiment fait partie du patrimoine protégé, qu’il y a peu de place à disposition pour l’installation des techniques ou que les locaux sont occupés en permanence, cela devra être pris en compte dès les premières réflexions.
Entreprendre des travaux demande un grand engagement et une bonne organisation afin de limiter les nuisances du chantier. Le zéro carbone est rarement le seul objectif d’une rénovation d’école, mais peut souvent être regroupé avec d’autres travaux (agrandissement, mise aux normes…), afin de limiter les dépenses et nuisances. En fonction de l’ampleur des travaux à entreprendre, vous devrez peut-être faire appel à un bureau spécialisé pour la gestion de ceux-ci.
Une fois ces réflexions prises en compte, il est nécessaire de se poser la question de l’échelle d’intervention. En fonction des travaux à entreprendre, on pourra envisager divers scénarios pour la mise en œuvre de ceux-ci.
Dans le cas d’un bâtiment vétuste et peu performant, il est souvent préférable de ne pas démolir et de partir au plus possible de l’existant en agissant sous forme de rénovations plus ou moins profondes. L’échelle d’intervention des travaux de rénovation peut varier. Il n’est pas toujours nécessaire de rénover l’entièreté du bâtiment. Si un diagnostic précis a été fait au préalable, il est alors plus facile d’agir efficacement grâce à des interventions localisées et ponctuelles. Celles-ci peuvent se limiter sur une partie du bâtiment ou bien sur une technique particulière posant problème. La question du budget est aussi primordiale dans le choix de l’échelle d’intervention. Une rénovation profonde de l’ensemble du bâtiment nécessite des frais importants, qui ne sont pas toujours possible pour des écoles. Cependant, il est toujours envisageable de répartir les travaux dans le temps afin d’étaler les frais sur plusieurs années.
Le tableau ci-dessous permet de donner une idée de l’investissement que représente les travaux selon le degré de rénovation envisagé. Rénover un bâtiment scolaire est souvent une action pertinente en vue d’atteindre les objectifs environnementaux. Cependant, cela peut ne pas toujours être rentable. En fonction de l’échelle d’intervention, les coûts cumulés des différents travaux entraineront inévitablement des temps de retour sur investissement plus ou moins longs. Il est primordial dès le départ de se poser la question de la rentabilité à long terme de ces travaux. Toutefois, cela ne doit en aucun cas être la raison unique pour ne pas réaliser de travaux de rénovation.
“Pour atteindre des objectifs ambitieux et éviter l’effet « lock-in »(effet de verrouillage) de la performance énergétique des bâtiments, les temps de retour sur investissement ne peuvent pas être les seuls moteurs de la rénovation énergétique. En effet, bien que la rénovation soit généralement rentable sur le long terme, les choix d’investissement se portent généralement sur des mesures dont les temps de retour sont inférieurs à 5 ans. Un changement de paradigme est nécessaire pour que des investissements à temps de retour de l’ordre de 20 ans soient réellement envisagés” ((SPW Wallonie – STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT (p.64) )). Il peut être intéressant de rappeler que les temps de retour sont toujours calculés « a priori », alors qu’en réalité, ils dépendent directement des prix de l’énergie. Une hausse durable des prix est donc favorable à la rentabilité des travaux.
| Jusqu’à -35% | Jusqu’à -50% | Jusqu’à -75% | Neutre en carbone | |
| Temps de retour | 10 ans | 15 à 20 ans | > 25 ans | > 25 ans |
| Mesures de rénovation | Remplacement des installations techniques
+ EMS* |
Remplacement des installations techniques
+ Isolation de l’enveloppe + SER* + EMS* |
Rénovation énergétique profonde | Rénovation énergétique profonde
+ Production via SER* |
| Coût typique de la rénovation | < 50€/m² | < 200 €/m² | De 800 €/m² à plus de 1500 €/m² | Idem
+ Production SER* (200-250€/m²) |
| Modèles de financement | ESCo*
Tiers-investisseurs |
CPE* via ESCo*
Tiers-investisseurs |
Mix de solutions de financement | Mix de solutions de financement |
EMS : Energy Management System – système de gestion de l’énergie
SER : Sytème d’énergie renouvelable
ESCo : Energy service company – société de services énergétiques
CPE : Contrat de Performance Énergétique
Si les travaux sont vraiment conséquents, la question de la démolition peut alors se poser. Faire des travaux de rénovation exhaustifs n’a pas toujours du sens. Parfois il est préférable de déplacer l’activité scolaire, démolir le bâtiment existant et reconstruire à neuf, aux meilleurs standards énergétiques. Toutefois, cette décision doit être justifiée et supportée par des analyses précises de l’impact environnemental de la rénovation par rapport à celui d’une reconstruction par exemple. Pour aborder la question de la démolition, plusieurs questions peuvent diriger les décisions, les deux principales étant les suivantes :
La réponse à ces questions peut demander une expertise particulière. Si la réponse aux deux questions ci-dessus est favorable, alors une rénovation sera préférable à une démolition. Ensuite, d’autres éléments secondaires peuvent être pris en compte dans cette décision :
Un chantier dans une école n’est pas du tout quelque chose de négligeable. En effet, dépendant de l’échelle des travaux à réaliser, le chantier peut s’étirer sur plusieurs mois voir années. Il est rare que les écoles possèdent de longues périodes d’inoccupation pour des travaux de grande envergure, à l’exception des vacances d’été.
Divers scénarios sont alors possibles :
Aucune période d’inoccupation n’est disponible et les nuisances sont trop importantes que pour être acceptables en période d’occupation, un déménagement est donc inévitable.
Si le déménagement est la seule solution, est-il possible de déménager dans un bâtiment existant ? Si vous prévoyez de construire une extension à votre école, c’est peut-être l’occasion de déménager vers cette extension, à condition qu’elle soit construite à l’avance. Cependant, si aucune autre possibilité de déménagement n’est réalisable, il reste la solution d’organiser l’école dans des classes préfabriquées à placer temporairement sur le site de l’école, sans déranger le déroulement du chantier. A titre d’exemple, le projet pilote MODUL-R propose un concept de classes préfabriquées en bois reproductibles, économiques et soutenables qui pourraient, à terme, servir d’hébergement temporaire pour les écoles en travaux.
En amont des travaux, il est aussi utile et nécessaire de réfléchir à l’implication des utilisateurs du bâtiment dans le processus de conception et dans la vie du bâtiment à la fin des travaux. Une école est surtout un lieu d’apprentissage. Un projet de rénovation zéro carbone est l’occasion parfaite pour modifier le projet pédagogique en expliquant l’impact de la construction et de la mobilité sur le changement climatique et en travaillant l’éveil environnemental des élèves dès leur plus jeune âge (pour en savoir plus, consultez la page consacrée à la démarche bâtiment zéro carbone) .
Ceci signifie que dès les prémisses du projet, il est utile d’intégrer les élèves, parents ou enseignants à la conception du projet de rénovation. Avec les élèves, des visites des différentes étapes du chantier et des activités autour du zéro-carbone pourront être organisées afin de participer à leur éducation environnementale.
Il est aussi intéressant de concevoir le projet avec les personnes qui seront responsables de l’entretien et de la régulation des différentes techniques qui seront installées dans l’école. Afin d’assurer sa durabilité, une nouvelle installation doit être entretenue à des intervalles réguliers. Il est donc utile de désigner dès le départ une personne ou un groupe de personnes chargé de cette mission. Cette personne/ce groupe peut être le même pour plusieurs écoles dans votre structure ou commune. Intégrer ces personnes dès la conception du projet permet une meilleure compréhension du fonctionnement pour les autres parties participant à la conception mais aussi de garantir une installation qui sera plus facile à prendre en main et plus adaptée à l’école en question.
Si votre école a le projet de se lancer dans une rénovation complète du bâtiment, vous pouvez consulter la page suivante de notre dossier qui vous donnera des éléments de réflexion pour intégrer au mieux vos travaux dans une démarche zéro-carbone.
Si votre école a le projet de se lancer dans une rénovation partielle, vous pouvez consulter l’ensemble de ce dossier thématique qui vise à créer une hiérarchie dans les travaux à entreprendre.


Les principes, avantages, inconvénients et fonctionnements des techniques d’isolation par l’intérieur et par l’extérieur sont déjà exposés sur Energie + et sur le site du CSTC.Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes :
Si de gros travaux sont prévus et que l’école bénéficie d’un budget important, l’isolation par l’extérieur reste la solution la plus efficace. Elle offre une meilleure uniformité à l’enveloppe et permet donc plus facilement de limiter les déperditions de chaleur ((Dobbels F. RenoFase WP4 – Detaillering van binnenisolatie, WTCB, 2017)).
L’isolation par l’intérieur, quant à elle, est une solution intéressante dans le cas de rénovations de bâtiments scolaires où il n’est pas possible de prévoir une isolation par l’extérieur (généralement pour des raisons urbanistiques). Cependant, c’est une technique à exécuter avec beaucoup de prudence car les risques causés par sa mauvaise exécution peuvent être dévastateurs pour le bâtiment.
L’isolation par l’intérieur possède quelques avantages par rapport à l’isolation classique par l’extérieur. Premièrement,elle ne requiert pas de permis pour la réaliser. Ce sont donc des travaux qui peuvent être rapides à exécuter. Deuxièmement, cette technique permet des interventions plus localisées, local par local. Le phasage ou l’étalement des travaux d’isolation dans le temps permet donc une plus grande flexibilité pour les projets de rénovation de bâtiments scolaires. Une attention mérite d’être portée sur l’isolation par l’intérieur lorsque des travaux sont déjà prévus dans des locaux de l’école. Que ce soit un changement des châssis, une amélioration de l’acoustique ou encore une réparation importante suite à un dégât des eaux, l’isolation par l’intérieur se combine facilement avec ce genre d’interventions. Attention toutefois qu’une réflexion sur l’isolation par l’intérieur ne peut avoir lieu sans une bonne gestion des débits de ventilation des locaux en question.
L’isolation par l’intérieur s’accompagne de quelques conséquences ayant un impact plus direct sur les locaux de l’école que l’isolation par l’extérieur.
A titre d’exemple, dans une classe de 56 m², accueillant 25 enfants, on décide d’ajouter20 cm de laine minérale à des murs en maçonnerie non isolés pour passer d’un U de 1,73 W/m²K à un U de 0,2 W/m²K.
Ceci provoque une perte de 3 m², engendrant donc une diminution de la capacité d’accueil de la classe, correspondant à .
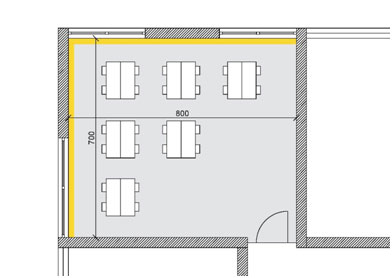
Malgré ces conséquences, isoler par l’intérieur peut vraiment améliorer la situation. Cela peut valoir la peine dans pas mal de cas. Pour se lancer dans l’isolation par l’intérieur, deux critères peuvent rentrer en compte.
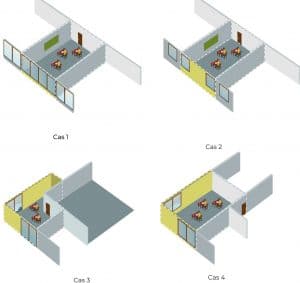
Cas 1 : classe mitoyenne avec larges fenêtres
Cas 2 : classe mitoyenne avec petites fenêtres
Cas 3 : classe avec 3 façades extérieures
Cas 4 : classe avec 2 façades extérieures
Isoler uniquement certains murs ne sert à rien car, après isolation, toute la chaleur passera par les murs non isolés.
Ce n’est pas parce qu’un mur est isolé qu’un autre verra plus de chaleur le traverser. Le flux traversant le mur non isolé ne change pas. Il reste dépendant de sa valeur U et de la différence de température entre les ambiances de part et d’autre de la paroi. Néanmoins, isoler l’ensemble reste toujours la solution idéale.
Isoler certains murs et d’autres non va concentrer toute la condensation sur les parties non isolées.
En effet, si de la condensation apparaît sur les surfaces, elle prendra place uniquement sur les murs froids (non isolés). Cette condensation peut provoquer des problèmes si l’humidité relative de l’air dépasse un certain seuil. Cependant, la priorité avant d’isoler des murs est de maîtriser l’ambiance intérieure en ventilant correctement les locaux. Dès lors, grâce à cette ventilation, l’ambiance ne pourra plus atteindre ces seuils d’humidité, le risque de condensation est donc supprimé.
Attention toutefois car l’isolation par l’intérieur ne vaut la peine que si certains principes sont respectés. De manière générale, on peut rappeler 3 grands principes.
Avant toute chose, il est impératif de traiter tout type de problème d’humidité! Comme l’expliquent les articles mentionnés plus haut, rajouter une couche isolante sur la face intérieure d’un mur a des conséquences importantes sur son comportement hygrothermique. Dès lors, il est impératif de démarrer sur une bonne base, avec un mur sain. Les dommages liés à l’humidité se produisent généralement lorsque des matériaux sensibles à l’humidité sont en contact direct avec celle-ci. La présence de tâches, d’efflorescences, de fissures ou encore d’écaillages sur les murs existants sont autant de signaux révélateurs d’humidité. Le mur doit être complètement sec et exempt de toute trace d’humidité lorsqu’on pose l’isolation par l’intérieur.

Photo de gauche : Humidité ascensionnelle.
Photo de droite : Tache d’humidité dans l’enduit intérieur.
Source : rapport CSTC – « Isolation des murs existants par l’intérieur – diagnostic »((Isolation des murs existants par l’intérieur – diagnostic – les dossiers du CSTC 2012/4.16, 2013))
Une bonne gestion du climat intérieur a toute son importance dans l’apparition ou non de dommages au niveau des zones sous-isolées. L’ampleur des dégâts est caractérisée par la température ambiante et par l’humidité relative de l’air intérieur. Pour éviter tout risque lié à une isolation par l’intérieur, le bâtiment doit appartenir à la classe de climat intérieur 1 ou 2. Ces classes de confort sont facilement atteintes grâce à des systèmes de ventilation mécanique.
Les ponts thermiques sont les principales failles des systèmes d’isolation par l’intérieur. Ils sont parfois complexes à éliminer mais de nombreuses solutions existent pour les combattre. Une mauvaise gestion des ponts thermiques peut entraîner des moisissures dues à la condensation ainsi que d’importantes pertes d’énergie. Attention cependant que tous les ponts thermiques ne doivent pas nécessairement être réglés.Si l’école bénéficie d’un système de ventilation efficace atteignant les débits réglementaires, les risques liés aux ponts thermiques peuvent être amoindris.
Les principales situations à risques auxquelles il faut faire attention sont les pourtours des menuiseries extérieures, les pieds de murs et fondations ou encore la jonction des planchers des étages avec les murs extérieurs.Des pistes de résolution de ces situations à risque sont proposées sur cette page.
Pour éviter tout risque de condensation interne, les systèmes d’isolation par l’intérieur doivent garantir une parfaite étanchéité à l’air. La ruine des parois peut avoir lieu lorsque de l’air chargé en humidité pénètre derrière la couche d’isolation et condense sur l’arrière de celle-ci.
Dans la réalisation d’une enveloppe étanche à l’air, les situations à risque sont les suivantes: le passage des techniques à travers l’enveloppe et les joints entre différents éléments ou matériaux. Des pistes de résolution de ces situations à risque sont proposées sur cette page.
L’isolation par l’intérieur est donc une technique à envisager pour la rénovation de l’enveloppe des écoles lorsqu’il n’est pas possible d’isoler par l’extérieur. Certes, elle propose plus de faiblesses que la technique d’isolation par l’extérieur et nécessite le respect strict de certains principes, mais si un diagnostic adéquat préalable est effectué sur l’enveloppe, l’isolation par l’intérieur peut permettre de réduire sensiblement les besoins en chaleur dans l’école. Le diagnostic de la situation existante est la première étape à réaliser en vue de l’isolation d’un mur existant par l’intérieur((Isolation thermique par l’intérieur des murs existants en briques pleines – Isolin – SPW – Wallonie et Architecture et Climat – 2010)).
Pour en savoir plus sur le traitement de certains nœuds constructifs à régler dans votre école, consultez la page suivante.