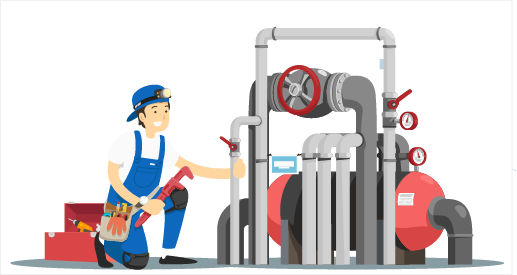Coefficient de transmission thermique d’une fenêtre (Uw) ou d’une porte
Le coefficient de transmission thermique d’une fenêtre ou d’une porte simple N.B.: la méthode présentée ci-dessous n’est valable que pour les fenêtres ou portes considérées comme simples, cas le plus courant dans nos régions. Elle ne s’applique pas à une double fenêtre ou à une fenêtre à vantaux dédoublés. Fenêtre simple. Double fenêtre. Fenêtre à … Lire la suite