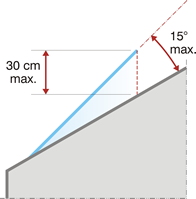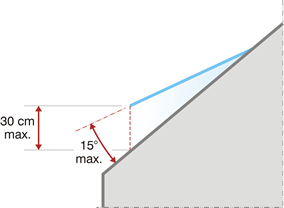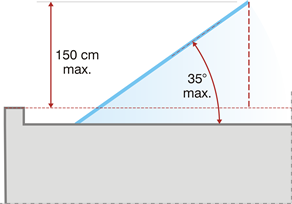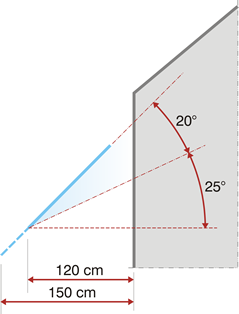Réglementation – Les communautés d’énergie en Wallonie

L’Union européenne a adopté son projet de « clean energy package », ou pacte vert pour l’Europe, il concerne notamment l’implantation de nouvelles formes de partage d’énergie. Pour appliquer ces nouvelles directives sur le sol wallon, le Gouvernement a approuvé un avant-projet de décret le 16 décembre 2020. Le but de ces directives est de donner un nouvel élan à la transition énergétique en misant sur l’action des consommateurs et sur la décentralisation de la production d’électricité. Sont ici concernées, la directive « marché » 2019/944 et la directive « renouvelable » 2018/2001. Elles encadrent la mise en place des communautés d’énergie renouvelable (CER) qui avaient déjà été inscrites au droit wallon par un décret du 2 mai 2019. Les CER sont définies comme des personnes morales, qui réunissent un certain nombre de participants dans l’objectif de partager de l’électricité. Cette électricité provient de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération de qualité et transite via le réseau public. Le nouveau décret modifie l’organisation régionale des marchés du gaz et de l’électricité ainsi que les méthodologies tarifaires applicables aux gestionnaires de ces réseaux. Priorité est donnée aux bénéfices environnementaux, économiques et sociaux avant le profit.
Les grands principes du décret
Conditions s’appliquant à toutes les formes de communautés d’énergie :
- Bien que l’énergie soit consommée localement, il est interdit de créer des micro-réseaux privés. Toute l’énergie doit transiter par le réseau.
- La compensation entre la production et la consommation d’électricité doit se faire au quart-horaire, le régime de compensation annuelle (compteur qui tourne à l’envers) n’est donc pas applicable.
- Même si l’on revend une partie de sa production, il n’est pas nécessaire d’avoir une licence de fourniture. Le décompte entre production et consommation se fera grâce à un compteur double flux ou un compteur intelligent dont il est, par contre, nécessaire d’être équipé.
- Seules les nouvelles installations de production d’électricité sont concernées.
- Une convention et des statuts doivent être définis dans la communauté d’énergie afin d’établir les règles d’échange et la tarification. Certains points doivent obligatoirement apparaître dans les statuts : l’organisation du contrôle effectif de la communauté ainsi que son indépendance et son autonomie.
- Les objectifs environnementaux, sociaux ou économiques doivent être explicités dans les statuts de la communauté d’énergie.
Conditions s’appliquant aux CER et CEC :
- La communauté d’énergie doit être représentée par une personne morale, de plus, elle doit être propriétaire des unités de production et de stockage.
- Il sera possible de mettre à disposition des points de recharge de véhicules électriques sans contrat avec le fournisseur d’électricité ou l’exploitant.
- Chaque communauté d’énergie doit demander une autorisation individuelle auprès du gestionnaire du réseau concerné qui sera délivrée par la CWaPE. Cette autorisation est accordée pour un temps déterminé, correspondant à l’amortissement des frais d’installation investis par la communauté d’énergie. Il sera possible de la renouveler.
- Le Gouvernement fixe les droits et les obligations de chaque CER, notamment les seuils d’autoconsommation collective.
- Les entreprises participant à des communautés d’énergie ne doivent pas faire de leur production d’électricité leur activité principale((https://macer.clustertweed.be/)).
Conditions s’appliquant à l’autoconsommation :
- À la place d’une autorisation individuelle, seule une notification est requise.
- Il n’y a pas de nécessité de créer une personne morale, il faudra en revanche désigner un représentant parmi les participants.
En application
Le principe d’autoconsommation collective
Les installations autorisées dans le cadre des communautés d’énergie visent uniquement la production d’électricité ainsi que son stockage. L’autoconsommation collective prévoit un seuil minimal et un seuil optimal. Le seuil minimal est défini par le Gouvernement en même temps que le périmètre local. Le seuil optimal est défini dans l’autorisation individuelle accordée préalablement. L’objectif de l’autoconsommation collective est de tendre vers ce seuil optimal qui peut aller jusqu’à 100% de l’énergie produite, autoconsommée collectivement. Pour rappel, l’autoconsommation est calculée par quart-horaire et correspond à l’équilibre entre électricité produite et électricité consommée lors de ce quart-horaire. Dans l’électricité produite, est incluse celle provenant des installations de stockage.
Le rôle des gestionnaires de réseaux
Ce sont eux qui gèrent la mise en place technique et les contrats en faveur du comptage de l’électricité. Ils collectent les informations concernant les quantités d’électricité autoconsommées et transmettent ces données aux fournisseurs des participants ainsi qu’à la communauté d’énergie. Ils sont les garants de la bonne fonction des communautés d’énergie, en toute transparence et de manière égalitaire.
Les tarifs
Appliqués par les gestionnaires de réseaux, ils sont calculés en fonction du seuil d’autoconsommation collective. Ils incluent les frais de fonctionnement et d’entretien du réseau ainsi que les taxes. Cependant, le décret précise que la couverture de ces coûts doit être mesurée à l’aune de la solidarité. Pour rester attractives, les communautés d’énergie doivent profiter de tarifs avantageux. Des tarifs trop bas rendraient la CER non rentable, tandis que des tarifs trop hauts rendraient la CER inabordable. L’apparition de nouveaux tarifs n’est pas envisageable avant 2022 voire pas avant la nouvelle période tarifaire 2024-2028. Les projets pilotes en cours n’ont pas non plus apporté de réponse sur le sujet des tarifs. Encore une fois, l’Union européenne et la Wallonie insistent pour que les avantages restent environnementaux, économiques et sociaux et ne servent pas le profit((https://www.cwape.be/node/158)).
Les objectifs du décret
En favorisant les installations de production d’énergies renouvelables et leur intégration au réseau, la Wallonie fait un pas en avant dans la transition écologique. Avec ces nouvelles directives, le réseau pourra être libéré de l’énergie autoconsommée, car bien qu’elle transite par le réseau, elle ne l’occupe que peu de temps puisque le principe est de produire et de consommer simultanément. Il y aura donc plus de place pour l’énergie non consommée localement, ce qui va donner du souffle à la compétitivité écologique de la Wallonie.
C’est aussi un moyen de mieux intégrer les énergies renouvelables dans la consommation. Par définition, ces énergies sont intermittentes et nécessitent plus de stockage que les autres. En synchronisant consommation et production d’électricité, on réduit les besoins de stockage.
De plus, il est possible que les acteurs des communautés d’énergie développent une plus grande conscience de leur consommation qui pourra déboucher sur une gestion intelligente des ressources énergétiques. Enfin, il s’agit d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation wallonne qui est aujourd’hui de quasiment 25%.
En réduisant les coûts de développement et de renforcement du réseau de distribution, les prix de l’énergie devraient diminuer. Concrètement, l’autoconsommation permet de réduire les pertes d’énergie dues au transport sur le réseau, et diminue la charge d’investissement puisqu’elle est assumée par les communautés d’énergie. En contrepartie, les conditions tarifaires de l’énergie devront être avantageuses pour les participants.
La Wallonie et l’Union européenne souhaitent encourager l’accès des ménages modestes et des locataires aux communautés d’énergie car elles réduisent la charge financière due à la consommation électrique.
Exemples d’application
Des projets pilotes de communautés d’énergie ont déjà vu le jour. L’université de Liège, par exemple, a créé une communauté avec la commune de Crisnée qui prévoit trois points d’action :
- l’investissement dans des éoliennes,
- l’installation de panneaux photovoltaïques sur des logements sociaux,
- le partage d’énergie entre des entreprises.
Le projet de la CER d’Hospigreen a mis en place un parc éolien et des panneaux photovoltaïques sur les toits de deux entreprises. Il réunit des consommateurs publics du secteur hospitalier.
Une entreprise qui produirait plus d’énergie qu’elle n’en consomme pourrait vendre son surplus à une ou plusieurs autres entreprises d’une même communauté d’énergie à des tarifs avantageux. L’énergie resterait donc consommée localement. L’organisation des pics de consommation en fonction des pics de production permettrait aussi d’optimiser la production locale et de faire appel, le moins possible, aux énergies produites plus loin.
Les immeubles de logements sont particulièrement adaptés à ces installations communes qui peuvent profiter à tous les habitants de manière égalitaire. C’est pourquoi le décret encourage l’adhésion de logements sociaux aux communautés d’énergie.
Les prochaines étapes du projet
Avant que le décret soit pleinement ratifié et après son approbation en première lecture par le Gouvernement le 16 décembre 2020, il doit encore être soumis à différentes instances consultatives:
- laCWaPE
- le Pôle énergie
- l’autorité de protection des données
Une approbation par le Gouvernement lors d’une deuxième lecture sera ensuite nécessaire avant que le décret ne soit soumis à la section législation du Conseil d’Etat. Le Gouvernement pourra alors adopter le décret qui sera examiné en Commission du Parlement avant d’être finalement voté en séance plénière.
Conclusion
Les premières communautés d’énergie sont attendues en 2022 si l’appareil législatif le permet. Les nombreuses instances qui vont réviser le texte risquent d’y apporter des modifications. Cependant nous avons déjà une vision des possibilités d’application de ce décret : habitats collectifs, quartiers résidentiels, quartiers mixtes incluant habitats et PME et même de petites villes. Rappelons que les candidats à ce type de projets devront attendre la promulgation du décret avant de commencer leurs investissements car seules les nouvelles installations sont éligibles et que les CER doivent en être propriétaires. La création des CER ne concerne pas que la Wallonie, mais toute l’Europe, les directives européennes étant relativement précises sur le sujet, les transpositions dans les différentes législations nationales de l’Union devraient peu différer((Communautés d’énergie et autoconsommation collective : partageons nos énergies ! (2020, 18 décembre). SPW Wallonie. https://energie.wallonie.be/fr/18-12-2020-communautes-d-energie-et-autoconsommation-collective-partageons-nos-energies.html?IDD=146181&IDC=8187)).