Marquage CE : sécurité des appareils au gaz
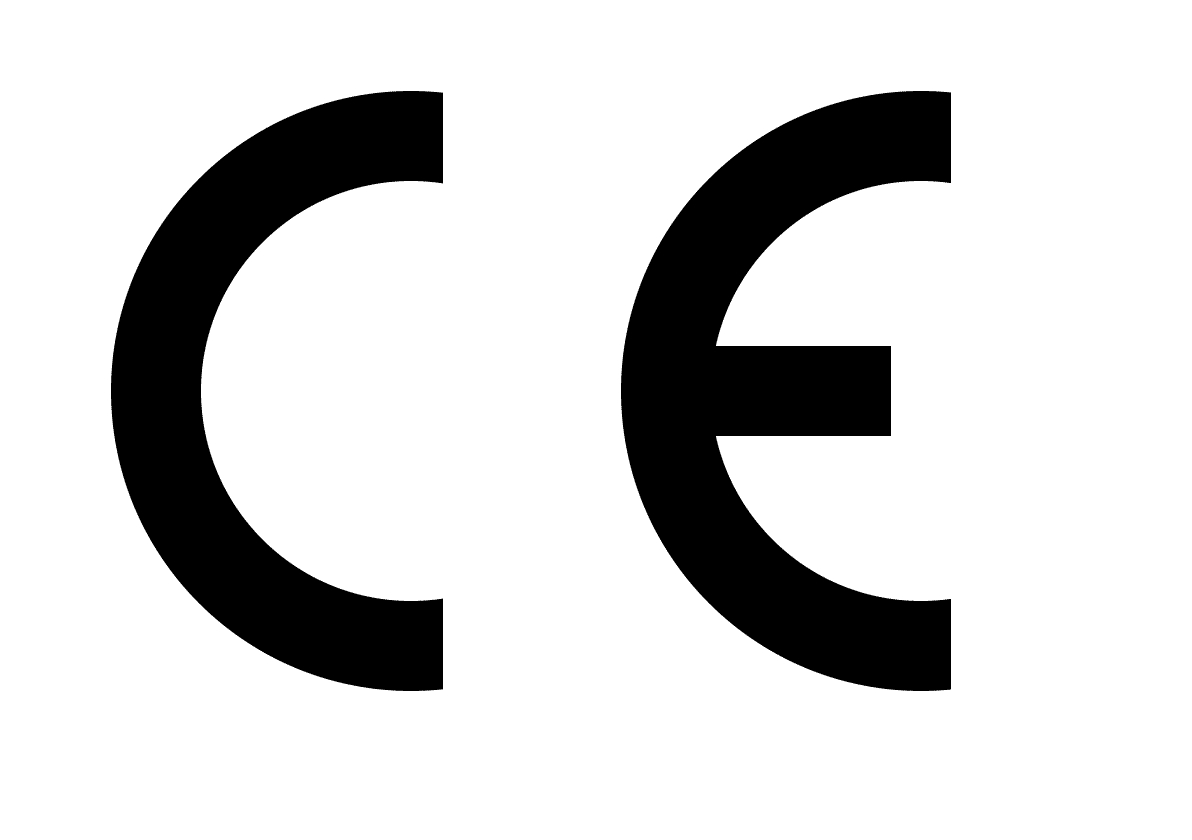
Depuis le 1er janvier 1997, les appareils de cuisson professionnels au gaz doivent porter le marquage CE.
Pour obtenir ce marquage, ces appareils doivent répondre aux « exigences essentielles » des différentes directives européennes les concernant.
Officiellement, les normes ne sont pas obligatoires, mais en pratique pour répondre aux exigences essentielles, une des voies possibles pour le fabricant est de satisfaire à l’ensemble des dispositions décrites dans les normes applicables au produit.
Ainsi, le respect des normes NBN EN 203-1 (Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux. – Partie 1 : Règles générales de sécurité) et NBN EN 203-2 (Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustible gazeux. – Partie 2 : Utilisation rationnelle de l’énergie) est un moyen de satisfaire aux exigences essentielles de la directive européenne sur la sécurité des appareils à gaz. Outre, les aspects » sécurité », cette directive prend en compte les aspects « utilisation rationnelle de l’énergie ». En effet, le point 3.5 des exigences essentielles dit : « Tout appareil doit être construit de telle sorte qu’une utilisation rationnelle de l’énergie soit assurée, répondant à l’état des connaissances et des techniques et en tenant compte des aspects de sécurité ».
D’autres directives peuvent être d’application pour un appareil de cuisson au gaz. Les directives dites « Basses tension » et/ou « Compatibilité Électromagnétique » sont applicables au produit dans la mesure où l’appareil de cuisson est connecté au réseau électrique d’alimentation et/ou comprend des parties électriques susceptibles d’entrer en interaction de type électromagnétique avec d’autres appareils.
