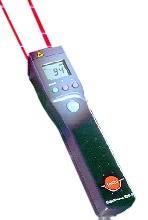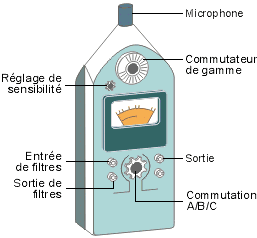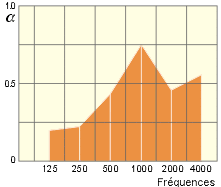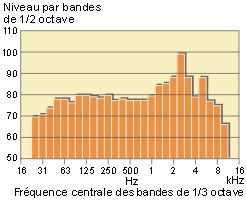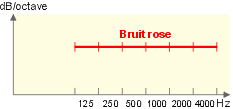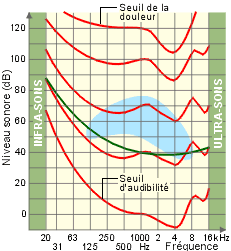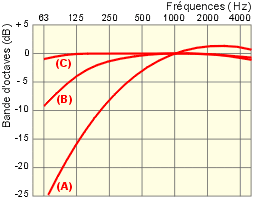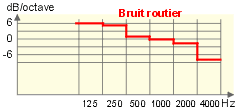Mesurer le niveau d’éclairement

Appareil de mesure : le luxmètre


Les niveaux d’éclairement se mesurent grâce à un luxmètre.
Le prix d’un tel appareil varie en fonction de son degré de précision, de sa plage de mesure, de la possibilité de raccorder une cellule photoélectrique séparée, de la possibilité d’enregistrer des valeurs et d’en calculer la moyenne, de mesurer un éclairement discontinu ou d’intégrer dans le temps un éclairement variable, …
Un luxmètre bon marché est généralement suffisant pour évaluer la qualité d’une d’installation.
Calcul de l’éclairement moyen intérieur
Pour déterminer le niveau d’éclairement moyen d’un local à l’aide d’un luxmètre, il faut effectuer diverses mesures d’éclairement ponctuel selon la méthodologie définie par la norme NBN L 14 – 002, et en établir une moyenne arithmétique.
- La surface du local est divisée en un certain nombre de rectangles élémentaires de dimensions égales.
- Les éclairements ponctuels sont mesurés au centre de chaque rectangle.
- L’éclairement moyen sur l’ensemble de la surface considérée est la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.
Emoy = (E1 + E2 + … + En) / n
indice du local K :
K = (a x b) /h (a + b)
avec,
- a et b = largeur et longueur du local,
- h = hauteur utile de l’installation.
| K | Nbre minimum de points de mesure |
|---|---|
| moins de 1
1 .. 1,9 2 .. 2,9 3 et plus |
4
9 16 25 |
Calcul de l’éclairement moyen extérieur
Pour déterminer, à l’aide d’un luxmètre, le niveau d’éclairement moyen d’un espace extérieur, il faut effectuer, sur une zone reproductible, diverses mesures d’éclairement ponctuel et en établir une moyenne arithmétique.
L’emplacement et le nombre de points de mesure sont déterminés suivant un quadrillage régulier dont la taille des mailles est obligatoirement inférieure ou égale à la hauteur de feu des luminaires divisée par 2.
Conditions impératives de mesure :
- la cellule de mesure doit être parfaitement horizontale,
- la cellule de mesure doit être à l’abri de toute ombre portée,
- le temps doit être sec (les gouttelettes peuvent fausser la mesure).