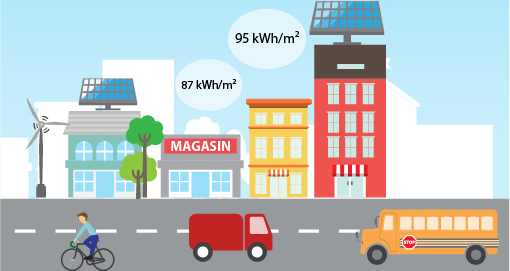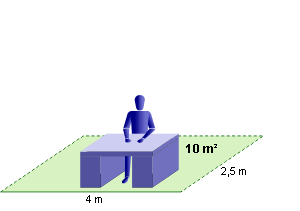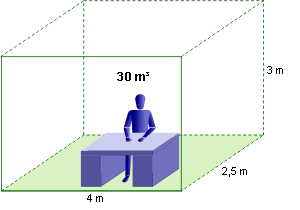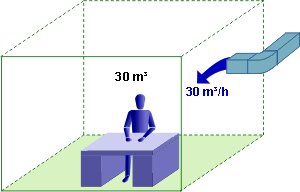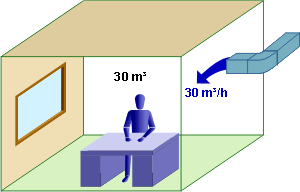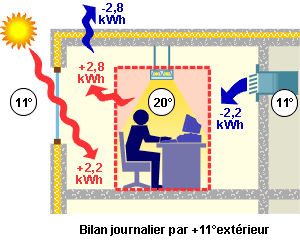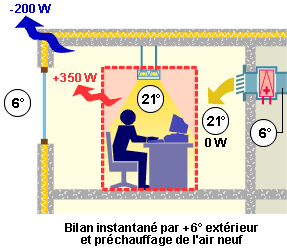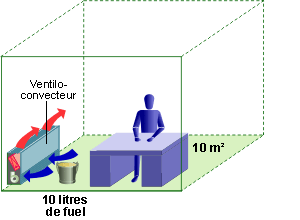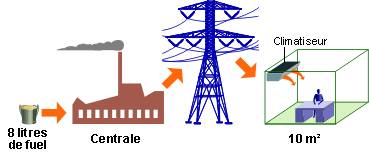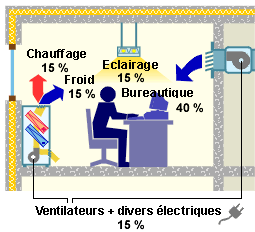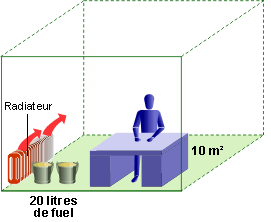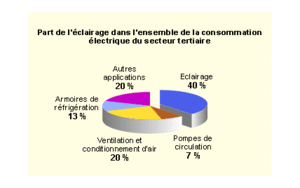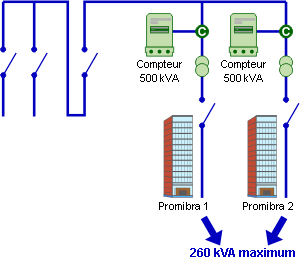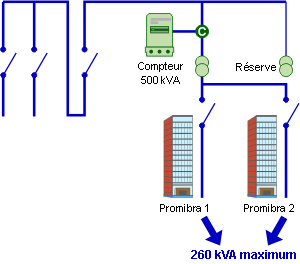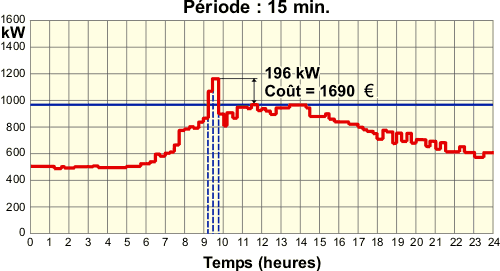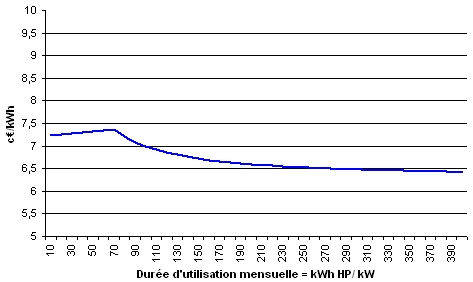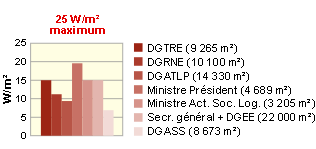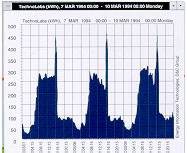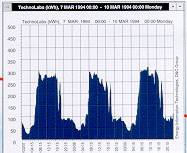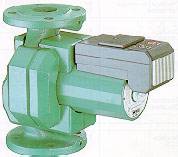Pompes de transport d’eau de chauffage d’eau glacée
Une consommation forfaitaire de l’ordre de 4 kWh/m²an est généralement rencontrée.
Transport de l’air neuf de ventilation
On peut tabler sur 1,4 kWh par m³/h transporté durant les 2 500 heures d’une année.
Pour assurer les 30 m³/h à l’occupant, 42 kWh/an ou encore 4,2 kWh/m²an seront nécessaires.
Conditionnement d’air du type « tout air » à débit constant
Ce débit sera calculé sur base de la puissance maximale, donc sur base de la puissance frigorifique d’été de 100 W/m². L’occupant demande donc 1 000 Watts de refroidissement pour ses 10 m². Le débit d’air nécessaire pour refroidir son ambiance, partant de l’idée que l’on pulse un air 10 K plus froid que l’ambiance, est donné par :
1 000 W / (0,34 Wh/m³.K x 10 K) = 294 m³/h
À noter que le taux de brassage de l’air est alors de 294 m³/h / 30 m³ = 10 !
Tout le volume d’air de l’occupant est brassé 10 fois par heure. Les ventilateurs de pulsion et d’extraction (pour assurer le chaud et le froid) auront une consommation totale de :
294 m³/h x 1,8 kWh/(m³/h) = 529 kWh, soit 53 kWh/m² !!
(La valeur de 1,8 kWh par m³/h transporté durant les 2 500 heures d’une année est choisie plus élevée qu’en ventilation pour tenir compte des pertes de charge liées à la présence des batteries de chauffe et de refroidissement).
Une telle consommation est probablement ramenée de plus de moitié si l’on travaille « à débit variable ».
Conditionnement d’air par ventilo-convecteurs
Le ventilateur du ventilo-convecteur aura une puissance de l’ordre de 80 W, soit 0,08 kW. S’il fonctionne 80 % des 2 500 heures de travail annuelles, on obtient :
0,8 x 0,08 kW x 2 500 h/an = 160 kWh/an
Mais l’appareil est capable de gérer un volume double de celui de l’occupant. Dès lors, cette consommation doit être rapportée sur 20 m², soit 8 kWh/m²an
Conditionnement d’air par plafonds froids et radiateurs
La consommation des pompes qui transportent l’eau glacée est augmentée, probablement de 50 %.
La consommation des ventilo-convecteurs disparaît. mais une consommation plus insidieuse apparaît : celle liée à la déshumidification de l’air neuf pour éviter le risque de condensation, voire de son post-chauffage pour éviter de pulser un air trop froid dans les locaux. L’évaluation dépasse le cadre de la présente approximation.
Refroidissement par free cooling mécanique
De l’air extérieur frais est pulsé dans les locaux durant la nuit. On suppose que l’installation est enclenchée lorsque l’air extérieur est en moyenne 10°C plus froid que l’ambiance. Les 838 kWh d’apport de chaleur doivent être évacués par :
838 kWh / (0,34 Wh/m³.K x 10 K) x 1 000 Wh/kWh = 246 470 m³
Si l’installation est réalisée sur base de 4 renouvellements horaires, le débit d’air sera de 4 x 30 = 120 m³/h.
Le nombre d’heures de fonctionnement sera de :
246.470 m³ / 120 m³/h = 2 054 heures
L’installation devra fonctionner 2 054 heures sur 165 jours de fonctionnement en mode refroidissement, soit 12,5 h par jour en moyenne.
La consommation liée aux ventilateurs sera de
120 m³/h x 1.8 kWh/(m³/h) x 2 054 h / 2 500 h = 177 kWh, soit 18 kWh/m².
Si les 28 kWh/m² de la machine frigorifique ne sont plus nécessaires, une bonne part de l’économie est mangée par les ventilateurs eux-mêmes.
Remarque : il n’est pas certain qu’un tel écart de température soit disponible durant autant d’heures.
(Le coefficient 1.8 kWh/(m³/h) a été choisi parce qu’en pratique une batterie de refroidissement est souvent greffée sur le circuit de pulsion afin de vaincre les températures les plus élevées).