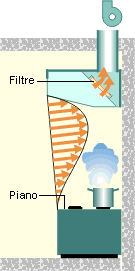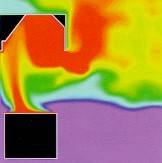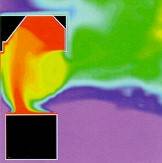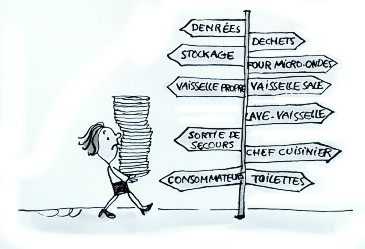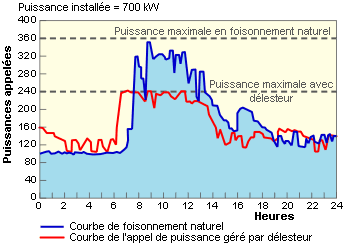Évaluer l’efficacité énergétique du poste de cuisson

Analyse quantitative
Cette analyse est purement indicative, elle ne peut constituer à elle seule un critère de décision.
En effet, il est très difficile de donner des valeurs de consommation de référence car elles varient très fort en fonction de facteurs indépendants de l’énergie (hygiène, organisation, choix culinaires, etc).
Ainsi, si on compare, du point de vue énergétique, sa cuisine avec d’autres cuisines, on ne peut valablement porter de jugement de valeur que si les concepts de base choisis sont identiques.
L’analyse quantitative doit donc être complétée par l’analyse qualitative.
Ainsi, supposons par exemple, pour une cuisine, que l’on aboutisse aux deux conclusions suivantes :
- Analyse quantitative : le poste cuisson est globalement peu performant (en Wh/repas).
- Analyse qualitative : la cuisson à haute température, avec évaporation d’eau (sauter, griller ou frire) est prépondérante.
Ces deux conclusions se recoupent : si le poste cuisson est peu performant, c’est justement, dans l’exemple, parce que la cuisson avec évaporation est prépondérante. La conclusion de l’analyse qualitative vient justifier la conclusion de l’analyse quantitative.
L’analyse quantitative peut aussi venir trouver sa justification dans les concepts de base influençant les consommations.
En revanche, l’évaluation de sa propre situation (mesure ou estimation) permet de mieux comprendre où passe l’énergie de sa cuisine et donc de concevoir une stratégie d’amélioration fondée sur l’analyse des facteurs de consommation (et non pas sur la comparaison avec un modèle moyen et irréel).
Une valeur de référence
Nous avons relevé les ratios suivants, dans des cuisines considérées comme correctes. Ces valeurs peuvent encore être améliorées (parfois de 20 à 30 %) mais certaines autres cuisines les dépassent largement (parfois d’un facteur 2 ou plus). Ces valeurs sont valables pour une gamme de cuisines collectives allant de 50 à 400 repas par service. Au-delà ces ratios peuvent diminuer.
| Cuisson | 450 Wh/repas |
| Remise en température |
|
| Maintien en température | 20 Wh/repas |
Le maintien en température peut, dans certaines cuisine atteindre 80 Wh/repas et plus, comme être nul (distribution tendue).
Évaluer sa propre situation
Les appareils électriques
> À partir de mesures :
On peut mesurer la consommation des appareils utilisés lors de la cuisson. Pour être représentative d’une moyenne, il faut répéter l’opération plusieurs jours de suite. Les mesures peuvent être réalisées sur chaque appareil mais nécessite alors l’intervention d’un électricien vu que les appareils ne sont pas raccordés à une prise mais de façon fixe. Elles peuvent aussi être réalisées à partir du tableau électrique où l’on trouve un départ par appareil de cuisson.
S’il existe un compteur électrique spécifique à la cuisine, on peut tenter d’isoler l’utilisation des appareils de cuisson.
Les appareils au gaz
> À partir de mesures :
Contrairement à l’électricité (les compteurs électriques sont petits et facilement déplaçables), on exclut la pose de compteurs gaz temporaires. En effet, on manque de place, et il y a des problèmes de sécurité et de prix.
Par contre, il existe en général un compteur gaz pour la cuisine du bâtiment. Dans ce cas, un relevé avant et après la cuisson suffit. Pour être représentatif d’une moyenne, il faut répéter l’opération plusieurs jours de suite.
S’il n’existe pas de compteur spécifique à la cuisine, il faut isoler le poste cuisson. Si le chauffage est au gaz, on fait les mesures en dehors de la période de chauffe. Si l’eau est chauffée au gaz dans un boiler à accumulation, on coupe temporairement celui-ci. Si le boiler est à chauffe directe, on peut calculer l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau utilisée.
> A partir d’estimation :
Pour les appareils avec brûleur séquentiel, l’allumage s’effectue toujours à plein débit. La diminution de l’apport de chaleur est obtenue par une série d’arrêts et de remises en marche du brûleur.
Pour certains appareils, la flamme est directement visible ou le devient facilement en enlevant une plaque de l’appareil. On peut calculer la proportion de temps (f) durant lequel il y a une flamme et calculer l’énergie consommée par la formule :
E = P x T x f,
Où :
- P : puissance de l’appareil,
- T : temps de la cuisson.
Analyse qualitative
Nous avons une surconsommation d’énergie, par rapport au service rendu, quand la quantité d’énergie consommée dépasse nettement la quantité intrinsèquement nécessaire au processus physico-chimique de cuisson des denrées.
Il y a toujours une partie de l’énergie qui n’est pas utilisée à la cuisson proprement dite : ainsi, une partie de la chaleur sert à élever la température du récipient, une autre partie s’échappe éventuellement avec les gaz brûlés évacués, etc .
Les indices permettant de repérer des anomalies sont expliqués un à un. Ils servent à remplir une grille d’évaluation.
L’analyse qualitative de l’efficacité énergétique du poste « cuisson » se fait en passant en revue chacun des appareils de cuisson utilisés. La conclusion globale dépend de la proportion de « bons » et de « mauvais » appareils utilisés pour ce poste.
Par exemple, l’utilisation fréquente d’un auto-cuiseur de bonne qualité est un indice d’un poste cuisson à haute efficacité énergétique.
Repérer les indices d’un bon/mauvais appareil

L’efficacité énergétique d’un appareil de cuisson dépend des paramètres ci-dessous. Les premiers concernent l’appareil proprement dit, les suivants concernent la façon de l’utiliser.
La source de chaleur
Les appareils qui produisent la chaleur à l’intérieur du volume de cuisson (certains fours ou marmites) ont une efficacité supérieure à ceux qui produisent la chaleur à l’extérieur. Ainsi, une marmite à chauffe directe perd moins d’énergie qu’une marmite à réchauffeur externe, tout autre paramètre restant égal.
Le transfert de chaleur
Les appareils qui accélèrent le transfert de la chaleur aux denrées ont une plus grande efficacité. Ainsi les fours à convection forcée sont plus efficaces que les fours statiques, et la cuisson par la vapeur (fours avec vapeur, autocuiseurs, etc.) facilite la répartition de la chaleur.
Le confinement
Les appareils fermés perdent nettement moins d’énergie que les appareils ouverts. Les moins efficaces sont les feux vifs (à gaz ou électriques), les sauteuses ouvertes, les salamandres, grilloirs, plaques à snacker. L’efficacité d’une marmite peut être augmentée en la fermant par un couvercle.
La fuite d’énergie
Les appareils bien calorifugés sont plus efficaces.
La question concerne principalement les appareils fermés (fours, marmites, bain-marie).
Des appareils ouverts (plaques, etc.) se font encore en version non isolée, mais ces appareils sont surtout caractérisés « sans confinement » et la question de l’isolation est relativement secondaire. Quand elle existe, l’isolation protège surtout des brûlures et protège les circuits ainsi que les boutons de commande.
Les friteuses à zone froide sont mal isolées au fond mais ont l’avantage de mieux refroidir les débris solides et donc d’économiser l’huile et d’améliorer le goût.
Pour les appareils fermés, le calorifuge existe depuis longtemps mais il a bien évolué : isolant plus épais, isolant mieux protégé, ponts thermiques traités, meilleure fixation, meilleure tenue.
On peut vérifier que l’isolant est bien réparti et bien fixé au niveau des parties de l’appareil où il est visible (en général dans les parties cachées. Ex. : dessous de l’appareil, etc.). Il suffit parfois de dévisser une plaque. De même, on peut contrôler si l’appareil présente des zones chaudes (à l’arrière, par dessous, …). Un appareil bien isolé peut être touché sans se brûler.
Vu l’intérêt économique différent, les appareils au gaz sont, en général, moins bien calorifugés. Les fours électriques sont plus fermés (pas de gaz à évacuer).
Certains appareils chauffés par de la vapeur perdent de l’énergie par les fuites, ou par la mauvaise récupération de l’eau condensée.
La masse inerte
Moins on aura à chauffer de matière non consommable (le récipient), moins on consommera de chaleur.
La masse inerte est à comparer à la masse utile (denrée + bain alimentaire). L’eau de cuisson des légumes et l’huile des frites sont des bains alimentaires. L’eau des bain-marie et la vapeur des fours sont des bains non alimentaires.
Un rapport de la masse inerte à la masse utile faible est un indice d’une bonne efficacité énergétique de l’appareil.
Ce rapport est souvent bon dans les marmites, les fours à rôtir et les autocuiseurs, parfois dans les grills et les plaques vitrocéramiques (gaz ou électricité).
Il est souvent médiocre dans les sauteuses, les plaques traditionnelles et les fours pâtissiers.
Remarque : une plaque à induction a une meilleure efficacité énergétique qu’une plaque classique. Néanmoins, pour que la différence soit réellement effective, il faut que la plaque soit de bonne qualité : la vitrocéramique doit être transparente aux ondes électromagnétiques. Si votre plaque reste froide lors de la cuisson, cela signifie qu’elle l’est suffisamment.
Le dimensionnement
- Le surdimensionnement : un matériel trop grand par rapport aux quantités à cuire perd plus d’énergie, pour un ensemble de raisons : plus de fuites d’énergie, masse inerte proportionnellement plus importante, etc.
- Le sous-dimensionnement : paradoxalement, un matériel trop petit par rapport aux masses de produits à cuire pourra être une cause de sur-consommation d’énergie. Ainsi, un four trop petit nécessite deux cuissons au lieu d’une seule (chacune consommant plus de la moitié de l’énergie d’une cuisson unique). De plus, il faudra probablement stocker la première fournée dans une armoire chaude en attendant la fin de la deuxième cuisson.
Le rendement des appareils au gaz
Il y a eu beaucoup d’améliorations concernant le rendement des appareils au gaz ces dernières années.
Outre un bon calorifugeage, ce rendement est obtenu par le brûleur séquentiel, par l’optimisation du transfert de chaleur et par l’allumeur électronique.
Avec un brûleur séquentiel, la diminution de l’apport de chaleur est obtenue par une série d’arrêts et de remises en marche du brûleur selon un cycle pré-établi. L’allumage s’effectue toujours à plein débit et donc la flamme a toujours la même hauteur. Il permet d’augmenter le rendement de l’appareil de 20 points.
Le meilleur transfert de chaleur fait gagner quelques points de rendement (parfois près de 10 points).
Il s’obtient par le choix du matériau pour l’échangeur (cuivre bon conducteur) et par le choix de la géométrie des parois d’échange thermique : trajet des gaz chauds plus long, plus turbulent (ailettes, tétons).
L’allumeur électronique est plus facile à manipuler que le piezzo. On arrêtera donc plus volontiers l’appareil.
Grâce à ces techniques, il existe une friteuse au gaz à haut rendement (88 %) fabriquée en Hollande. Ce rendement est à comparer aux 45 % d’une friteuse au gaz classique.
La qualité de combustion (installations au gaz)
Remarque : ce paramètre n’est pas intégré dans les grilles d’évaluation pour plusieurs raisons : parce que son incidence est relativement plus faible que celle des autres paramètres et parce que son amélioration relève seulement d’une bonne maintenance technique qui sera de toute façon à programmer, quelles que soient les conclusions de l’évaluation énergétique, au moins pour des raisons de sécurité.
Le binôme temps/température :
Il s’agit de conduire la cuisson au bon moment, à la bonne température, et sur la bonne durée.
La durée excessive
La durée excessive est surconsommatrice. Ainsi, pour préparer une soupe, mieux vaut introduire ensemble les produits à temps de cuisson égal, que de les introduire peu à peu toutes les dix minutes, à mesure de leur disponibilité à la sortie de la légumerie.
Le préchauffage
Il doit être limité au temps strictement nécessaire (fours, armoires chaudes, etc.).
Quand un produit doit être jeté dans une eau portée à l’ébullition, ou dans un bain de friture, il est primordial de ne plus attendre à partir du moment où la température est atteinte : la contrainte est souvent celle de l’organisation des tâches des différents personnels disponibles.
L’allumage des appareils ne doit pas être systématique au petit matin, mais sera différé jusqu’au moment opportun.
Le choix des horaires
Un horaire de cuisson bien choisi permet d’éviter de recourir aux armoires chaudes pour le stockage après cuisson.
Le refroidissement d’un appareil
Le refroidissement d’un appareil, le plus souvent un four, entre deux cuissons successives fait croître la consommation d’énergie. Il vaut mieux démarrer le second cycle dès la fin du premier.
Parfois, il est possible de cuire ensemble deux plats compatibles . Dans le cas des marmites, le refroidissement a moins d’incidence sur la consommation (températures plus basses) et reste souvent inéluctable, pour le nettoyage entre deux cuissons.
Les excès de température
Les excès de température entraînent le plus souvent une surconsommation d’énergie : température des bains, température des fours, température des denrées. En fait, il s’agit d’adapter le binôme temps/température : un auto-cuiseur pourra monter plus haut en température, mais sur une durée plus courte, et avec un meilleur confinement : il y aura économie d’énergie.
Les automatismes (régulateurs/programmateurs)
Les automatismes sont des auxiliaires très efficaces pour réduire la consommation d’énergie, tout en améliorant le plus souvent les qualités gustatives et en diminuant les pertes de masse. Les sondes de température à cour sont particulièrement appréciables.
Citons :
- la possibilité de réguler finement les brûleurs à gaz grâce au pilote séquentiel,
- les appareils polyvalents à programmes intégrés,
- les sondes à cour, suivant fidèlement l’évolution du produit et pilotant un régulateur de température (du type séquentiel dans le cas du gaz),
- les plaques à sonde (testant la présence et la température du produit),
- les automates de cuisson sous vide (fonctionnant sans présence humaine, la nuit),
- les programmes faciles à entrer (clavier écran , etc.)
Les automatismes n’apportent pas beaucoup par rapport à une conduite manuelle expérimentée et très au fait des appareils. Leur gain n’est pas quantifiable en soi, mais seulement par rapport à un comportement humain auquel il se substitue : tout dépend de la qualification des personnes, de leur disponibilité (effectifs, horaires), de l’organisation du travail, et de l’effort d’adaptation nécessité par l’évolution des produits et une carte culinaire qui serait trop complexe à assimiler techniquement. Les automatismes rendent aussi des services aux personnes expérimentées, en allégeant leur tâche et en leur permettant de plus diversifier les menus, voire de gagner sur les durées.
D’autre part, les automatismes des appareils nouveaux, moins énergivores par ailleurs, permettent d’en assimiler rapidement la maîtrise et d’en tirer les avantages prévus, sans risque de se tromper (avec des conséquences énergétiques).
Remplacer un vieux matériel (trop gros ou trop petit, mal isolé) fait souvent économiser l’énergie, et l’automatisme est acheté par la même occasion : il ne crée pas l’économie d’énergie, mais la facilite sur un matériel non encore maîtrisé.
Grille d’évaluation – Exemple
Dans les grilles d’évaluation chacun des paramètres cités ci-dessus a été affecté d’une pondération (incidence quantitative) sous la forme d’un nombre d’étoiles.
Une grille d’évaluation est complétée pour chaque appareil de cuisson. L’utilisateur remplit les cases blanches.
| APPAREIL DE CUISSON | Type : | sauteuse basculante | ||
| Capacité : | 200 litres gaz | |||
| Puissance : | 25 kW | |||
| % du temps : | 10 % | |||
| Efficacité énergétique / Paramètres | Incidence | Note (0 à +/- 3)* | Bilan | Décision |
| Source de chaleur | * | – 1 | – 10 | non |
| Transfert de chaleur | ** | + 1 | + 20 | |
| Confinement | ***** | – 1 | – 50 | non |
| Fuite d’énergie | * | 0 | / | |
| Spécifique vapeur | *** | 0 | / | |
| Masse inerte | ** | 0 | / | |
| Sur dimensionnement | ** | – 2 | – 40 | A voir |
| Sous dimensionnement | * | 0 | / | |
| Rendement app. gaz | ** | – 2 | – 40 | A voir |
| BINÔME TEMPS/TEMPÉRATURE | ||||
| Durée excessive | *** | 0 | / | |
| Pré-chauffage | *** | – 1 | – 30 | oui |
| Horaires | ** | – 1 | – 20 | non |
| Refroidissement | * | 0 | / | |
| Excès de température | ** | 0 | / | |
| Automatisme | ** | 0 | / | |
* La note résulte d’un examen de l’appareil concerné et de son utilisation.
Exemple : si une marmite fonctionne toujours avec couverte, le confinement est noté + 3.
0 signifie « sans objet » par rapport aux critiques écrits dans le texte correspondant.
Concepts de base ayant une influence sur les consommations
Outre l’efficacité énergétique des appareils de cuisson et la façon de les utiliser, bien d’autres facteurs influencent les consommations du poste.
Ce sont d’autres considérations que l’énergie qui conduisent au choix de ces concepts.
Nous avons relevé les points suivants :
L’hygiène
Une cuisine ne respectant pas l’hygiène risque de consommer moins qu’une cuisine la respectant : interruption dans la chaîne du chaud, etc.
Le nombre de plats nécessitant cuisson – Les produits non cuits
Il est certain qu’une institution où l’on propose une entrée chaude, un potage et un plat consistant aura un poste cuisson bien plus énergivore que celle qui se contente de servir un plat consistant.
Dans le même ordre d’idée, il est trivial de constater que certains cuisines consomment beaucoup moins en été, du fait des changements de menus (salades, fruits frais et crèmes glacées, au lieu des entrées chaudes, choucroutes et pâtisseries).
La gamme des produits
Les produits précuits (4ième gamme) permettent évidemment de réduire la consommation d’énergie en cuisine, mais pas nécessairement dans le bilan global de la chaîne intégrant la cuisson industrielle.
Sur la chaîne globale, il est intéressant d’utiliser un précuit pour les quantités de produits pour lesquelles on ne dispose pas des conditions optimales de cuisson économe (quantité trop faibles, par exemple : sauces, fonds de tarte).
L’évaporation de l’eau des denrées
La cuisine mijotée est grosse consommatrice d’énergie.