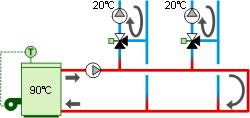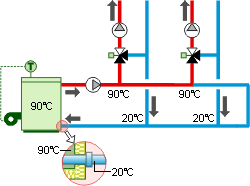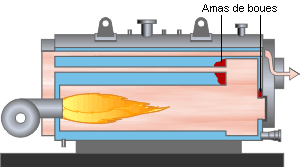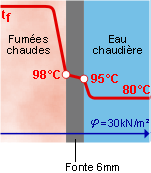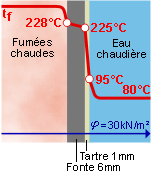Diagnostiquer les causes de rupture d’une chaudière

Fissuration d’éléments côté « retour »
Cause
L’eau des circuits revient trop froide vers la chaudière qui elle est chaude. Il en résulte un choc thermique dans la fonte qui casse.
Exemple.
Durant la nuit.
A la relance.
|
Solutions
Il faut contrôler la température minimale de retour et ralentir l’abaissement de cette température.
> Solution 1 : placer un circulateur de recyclage.
Ce circulateur peut être placé en by-pass ou en série. Il tempérera la chute de température dans la chaudière grâce au recyclage d’une partie de l’eau chaude de départ.
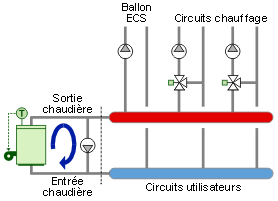
Placement d’un circulateur de by-pass.
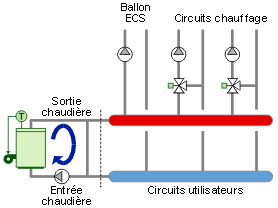
Placement d’un by-pass avec circulateur en série avec la chaudière.
Attention, lorsque le circulateur est placé en by-pass, il faut être particulièrement attentif à son bon choix, pour éviter tout problème hydraulique, comme par exemple des circulations inverses.
| Pour en savoir plus sur le dimensionnement d’un circulateur de by-pass. |
Dans le cas d’un circulateur placé en série, le circuit hydraulique des chaudières est séparé des circuits utilisateurs, comme avec une bouteille casse-pression. Dans ce cas, le débit de la pompe sera au moins égal à la somme des débits des circuits utilisateurs.
> Solution 2 : agir sur les vannes 3 voies des circuits.
A la relance, le régulateur libère la ou les vannes des différents circuits juste ce qu’il faut pour que la température de retour ne tombe pas sous la valeur de limitation. A la limite, par exemple au démarrage de l’installation, la chaudière ne reçoit absolument aucune eau en provenance des circuits.
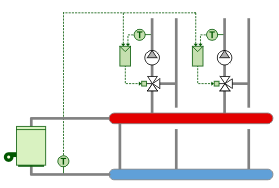
Cette solution convient :
- si tous les régulateurs et toutes les vannes sont regroupées,
- ou si le verrouillage de quelques circuits les plus importants suffit pour assurer une température de retour minimale.
> Solution 3 : placer une vanne 3 voies sur le circuit de retour.
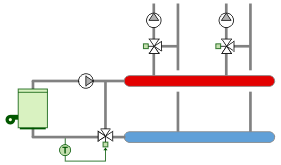
Cette solution convient si les départs sont fort éloignés, s’ils sont munis de vannes manuelles ou même sans vannes, ou encore munis de régulateurs de marques différentes …
Dans le cas d’une chaufferie avec plusieurs chaudières régulées en cascade, on peut envisager le placement de vanne 3 voies sur chaque chaudière (vanne 3 voies progressive thermique car plus lente).
Fissuration d’éléments aux jonctions ou au surplomb du foyer
Cause
Le manque de débit dans une chaudière entraîne la vaporisation superficielle de l’eau au niveau de l’échangeur. Il en résulte l’apparition de corrosion et d’érosion dues à la cavitation ou encore des chocs thermiques pouvant provoquer une fissuration prématurée du métal.
Ceci est critique pour les chaudières ayant une très faible capacité en eau. Dans ce cas le moindre défaut d’irrigation peut être fatal.
Le manque d’irrigation d’une chaudière peut être dû :
- au circuit hydraulique (circuit primaire en boucle ouverte),
- à la production d’eau chaude sanitaire en été (maintien en température de la chaudière),
- à la présence de boue dans l’installation,
- à la régulation (ex : uniquement sur le circulateur),
- au placement de vannes thermostatiques sans soupape de décharge.
Solutions
- Asservir le fonctionnement du brûleur à l’existence d’un débit suffisant, par le biais d’un « contrôleur de débit » (flow-switch) placé dans le circuit de la chaudière. Cette sécurité doit être d’office prévue quel que soit le type de circuit de distribution.
- Garantir un débit minimum d’irrigation par l’action d’un circulateur en by-pass sur la chaudière. Le fonctionnement du brûleur est asservi au fonctionnement de celui-ci.
- Prévoir une soupape à pression différentielle placée en « by-pass » sur la distribution hydraulique.
- Construire une boucle primaire à débit constant.
- Prévoir une post-circulation hydraulique après extinction du brûleur, avant l’éventuel arrêt de l’irrigation. En effet même si le brûleur est arrêté, la quantité de chaleur emmagasinée dans la chaudière est telle que à l’arrêt du circulateur, la température de la chaudière peut atteindre des valeurs inacceptables.
- Placer un filtre ou plutôt un pot de décantation sur le retour de l’installation afin d’éviter la sédimentation dans les fonds d’éléments et le bouchage de conduites.
| Exemple.
Endroit de prédilection de dépôt de boue dans une chaudière à triple parcours. La présence de ces boues limite le débit, diminue l’échange, provoquant des surchauffes locales. |
Gonflement du foyer et aspect spongieux avec rouille
Cause
Il s’agit d’une montée en température excessive de la paroi. La cause peut en être un coup de feu dû à une flamme heurtant le fond du foyer ou non placée dans l’axe du foyer ou encore à un entartrage de l’échangeur.
Exemple.
Température de la paroi d’une chaudière avec ou sans entartrage. |
Solutions
- Traiter les eaux d’appoint. Attention toutefois de ne pas créer d’autres problèmes de corrosion.
- Prévoir un dispositif de purge de la partie basse de la chaudière afin de désembouer.
- Placer un pot de décantation sur le retour des circuits (pour empêcher la sédimentation à basse vitesse dans les fonds d’éléments).
- Certains constructeurs ont prévu un thermostat palpant la température du fond des chaudières atmosphériques, ne pas le supprimer en tous cas, déterminer la cause de sa coupure éventuelle.
- Contrôler l’état et le dimensionnement du vase d’expansion.
- Améliorer la garniture réfractaire éventuelle.
- Contrôler et modifier si nécessaire la puissance de la flamme qui doit être en correspondance avec la puissance de la chaudière.
Corrosion côté « fumées »
Dans une chaudière, les fumées condensent à une température d’environ 50°C. Dans le cas de la combustion du fuel, la vapeur d’eau se combine avec le soufre contenu dans le combustible pour former de l’acide corrosif pour les chaudières.
Une chaudière traditionnelle se corrodera si, en certains endroits, la température des fumées descend trop bas.
Cela est possible :
- Si la température de l’eau au retour des circuits descend en dessous de 50°C et que la chaudière n’est pas prévue pour travailler à très basse température. En effet, on peut considérer que, dans ce cas, la température de la paroi de l’échangeur, côté « fumées » est presque égale à la température de l’eau. Cette situation peut apparaître de façon transitoire lors des relances matinales, lors d’une relance pour produire de l’eau chaude sanitaire ou de façon permanente si la régulation entraîne un fonctionnement en température glissante (régulation en fonction de la température extérieure, régulation par thermostat d’ambiance agissant sur le brûleur).
- Si la puissance du brûleur est trop faible par rapport à la puissance de la chaudière : la surface du foyer par kW de flamme augmente lorsque la puissance du brûleur diminue. Les fumées se refroidissent donc plus. Par exemple, la plupart des fabricants de chaudières très basse température recommandent de travailler à température élevée constante lorsque l’on utilise un brûleur modulant, pour éviter la condensation à faible charge.