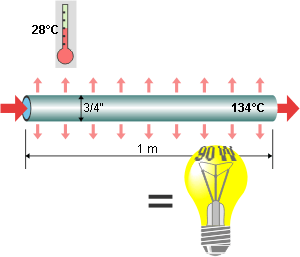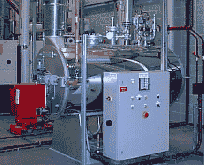1. Critères de choix
Le choix d’une configuration centrale ou locale est liée à plusieurs critères:
Confort thermique des zones de travail
Le confort thermique des occupants de la stérilisation centrale est très sensible. En effet, l’ambiance est souvent surchauffée de part le contact direct et quasi permanent avec les déperditions des parois des autoclaves lorsque les portes sont fermées (500 W par stérilisateurs selon un constructeur) et de l’intérieur des chambres de stérilisation lorsque les portes sont ouvertes (1 400 W par stérilisateur selon le même constructeur). Il faut ajouter à cela les déperditions des parois de séparation de l’ambiance de travail (zones stérile et propre) et de l’espace technique qui sont, en général, de simples parois de propreté en inox sans isolation.
Si cet espace technique est mal ventilé, il risque de surchauffer de part les apports internes importants et de transmettre au travers des parois de propreté une chaleur importante. On y relève les apports internes de déperdition au travers des parois :
- de la double enveloppe de l’autoclave et de la distribution (de l’ordre de 2 100 W);
- du générateur de vapeur (800 W).
Les apports internes, s’ils ne sont pas :
- limités par une bonne isolation des parois des équipements,
- confinés dans l’espace technique par une bonne isolation des parois de propreté,
- évacués par une ventilation intelligente (récupération des calories au niveau d’un quai fournisseur en période froide par exemple),
- …
cela risquent de rendre les zones de travail incorfortables; d’où nécessité de climatiser.
Il est pratiquement certain que la conception d’une stérilisation centrale passe par la climatisation des zones de travail car il est difficile, de toute façon, de réduire les apports internes de manière à passer en dessous du seuil de climatisation (gestion des déperditions des portes des autoclaves, de l’ouverture limitée de ces portes, …) mais on peut du moins les limiter au maximum comme, par exemple, la centralisation des générateurs dans un local technique annexe.
Puissance installée
Il est clair que lorsqu’on choisi comme vecteur énergétique de l’électricité directe, il est nécessaire de se soucier de l’appel de courant ou de la pointe quart-horaire. Avec la centralisation, on pourrait espérer réduire la puissance installée sachant que le coefficient de foisonnement des cycles de l’ensemble des stérilisateurs est faible. Mais vu que la priorité reste la garantie de résultat au niveau du cycle de stérilisation, le sous-dimensionnement n’est pas une solution en soi car rien n’empêche la possibilité de démarrer tous les stérilisateurs en même temps; une piste à suivre ?
Enfin la centralisation d’une production électrique de vapeur n’est pas le cheval de bataille des constructeurs. A puissance égale, l’investissement est donc beaucoup plus important dans le cas d’un générateur central que celui de la somme des générateurs locaux (rapport annoncé de 1 à 4)
Pertes en ligne
Les pertes en ligne d’une configuration centrale sont plus importantes qu’une configuration locale. Il faudra en tenir compte lors du dimensionnement si on choisit quand même cette option.
Intermittence
L’intermittence permet de réduire les consommations énergétiques et d’eau osmosée. Pourquoi maintenir une installation sous pression entre les cycles ? sachant que :
- les déperditions inutiles au travers des parois continuent de se produire;
- les condensats dans la double enveloppe continuent de se former;
- les temps d’intercycle sont, en général, importants,
- le temps de remise en pression faible;
- les contraintes mécaniques peuvent être maîtrisées;
- …
Dans une configuration locale, l’intermittence pourrait être pratiquée sans trop de problème en coupant l’alimentation électrique du générateur à la fin d’un cycle de stérilisation et en la rétablissant au cycle suivant. C’est vrai que l’on va légèrement allonger le temps de cycle effectif pour relancer le générateur afin qu’il puisse fournir une vapeur correcte en terme de pression et de température. Par contre, les consommations vont s’améliorer.
Dans une configuration centrale, l’intermittence ne peut être pratiquée puisque, par son principe même, la centralisation permet une mise à disposition permanente de la vapeur pour les autoclaves.
2. Synthèse
Configuration locale

Dans ce cas, le générateur de vapeur se trouve souvent sous l’autoclave et chaque autoclave possède son propre générateur. La compacité est importante vu qu’il est nécessaire de favoriser l’espace pour les zones de travail du personnel de Stérilisation Centrale.
On peut synthétiser les avantages et inconvénients suivants :
(+)
- le générateur réagit rapidement à la demande du stérilisateur;
- l’intermittence peut être pratiquée aisément;
- les pertes en ligne sont limitées;
- le dimensionnement de la puissance du générateur est plus aisé puisqu’il ne dépend pas d’un coefficient de foisonnement;
- la mise en parallèle de deux ou plusieurs générateurs peut être envisagée comme secours;
- …
(-)
- la source de chaleur reste à proximité immédiate de l’ambiance de travail;
- la compacité de l’installation pose des problèmes de maintenance;
- une panne du générateur entraîne souvent l’abandon du cycle et l’indisponibilité de l’autoclave (sauf si les générateurs sont reliés par une conduite de secours);
- …
|
Configuration centralisée

Si le service de Stérilisation Centrale dispose d’un local technique annexe à proximité immédiate, on peut très bien envisager le regroupement des générateurs dans ce local afin de diminuer la puissance installée sachant qu’il est rare de voir tous les stérilisateurs du parc fonctionner ensemble.
On peut synthétiser les avantages et inconvénients suivant :
(+)
- gain de place pour la maintenance de l’installation (détection aisée des fuites au niveau de la distribution);
- une panne d’un générateur n’empêche pas de continuer le cycle du stérilisateur;
- Une des sources de chaleur est sortie de la zone de travail;
- …
(-)
- la conduite mère est de forte section (2″ par exemple); ce qui veut dire que les déperditions sont plus importantes et qu’il faut mieux l’isoler;
- la longueur importante de la conduite mère augmente les déperditions;
- les difficultés techniques et d’encombrement augmentent pour le tracé de la conduite mère sachant qu’il est important de récupérer la quantité de condensats produite par les déperditions des parois par gravitation naturelle (nécessité d’espace dans les faux-plafonds pour bénéficier d’une pente vers le générateur);
- nécessité de multiplier les points de purge;
- …
|
Alternative
Dès le début du projet, il est possible de demander au concepteur de prévoir une conduite mère reliant les générateurs locaux entre eux afin d’augmenter la sécurité d’alimentation en vapeur et de pouvoir réduire la puissance installée des générateurs.
Nous manquons d’étude de cas en la matière. S’il y a des expériences heureuses ou pas en terme de dimensionnement, il serait intéressant pour tout le monde qu’elles figurent ici !