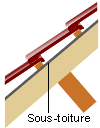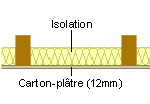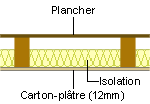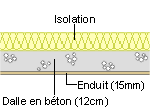Choisir la couche isolante du plancher des combles [Concevoir]
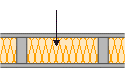
L’efficacité isolante
La valeur isolante du matériau dépend de son coefficient de conductivité thermique. Plus sa conductivité est faible, plus l’isolation sera efficace et donc plus l’épaisseur nécessaire à mettre en œuvre sera réduite. Le matériau doit également conserver une efficacité suffisante dans le temps.
Le choix l’épaisseur d’isolant doit donc se réaliser en fonction de la performance thermique à atteindre.
Exemple d’épaisseur calculée d’isolantRemarque. Les calculs ci-dessous sont faits avec l’hypothèse que le plancher est étanche à l’air. Dans le cas contraire, la valeur U peut être très fortement dégradée.
Le plafond n’est, par contre, pas rendu étanche par une finition en lambris ou planchettes. Calcul précisL’épaisseur « di » de l’isolant se calcule par la formule suivante : 1/U <=> di = λi [(1/U) – (1/hi + d1/λ1 + d2/λ2 + … + Ru + 1/he)] où,
Le tableau ci-dessous donne les résultats des calculs pour des toitures avec sous-toiture et pour différents modèles d’isolation de plancher.
Calcul simplifiéLa valeur U d’une toiture est presque uniquement déterminée par la couche isolante. Pour simplifier le calcul, on peut négliger la résistance thermique des autres matériaux. La formule devient alors : ei = λi ((1/ U) – (1/he + 1/hi) [m] Exemple pour U = 0,3 W/m²K,ei = λi ((1/ 0,3) – (1/23 + 1/8 )) m L’épaisseur ne dépend plus que du choix de l’isolant et de son λi. L’épaisseur ainsi calculée doit être adaptée aux épaisseurs commerciales existantes. Exemple. Si l’isolant choisi est la mousse de polyuréthane (PUR). Son λi vaut 0.039 W/mK (suivant NBN B62-002) L’épaisseur commerciale : 13 cm (par exemple : 6 + 7 cm).
|
||||||||||||||||||||||||||
Un isolant semi-rigide :
- s’intercale facilement dans les espaces qui lui sont réservés (pose entre les gîtes);
- calfeutre correctement les raccords (autour de l’isolant);
- ne résiste pas à la compression (non circulable).
Un isolant souple :
- peut suivre la forme très compliquée d’un plancher (contournement des gîtes);
- s’intercale facilement dans les espaces qui lui sont réservés (pose entre les gîtes);
- calfeutre correctement les raccords (autour de l’isolant);
- ne résiste pas à la compression (non circulable);
doit être supporté (par le plafond).
Un isolant rigide :
- résiste mieux à la compression (peut éventuellement supporter une aire de foulée);
- calfeutre moins facilement (entre les gîtes ou lambourdes);
- s’adapte plus difficilement à des formes compliquées.
Les flocons ou granulés :
- s’intercalent facilement dans les espaces qui leur sont réservés (pose entre les gîtes);
- calfeutrent correctement les raccords (autour de l’isolant);
- ne résistent pas à la compression (non circulable);
- doivent être supporté (par le plafond);
- se déplacent facilement.
Le choix de l’isolant dépend des caractéristiques énumérées ci-dessus et du modèle d’isolation choisi en fonction du type de plancher (lourd ou léger).
Le plancher lourd
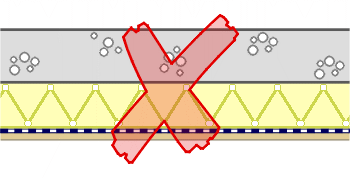
Le plancher lourd sera idéalement isolé par le haut afin de lui maintenir une température constante. On évite ainsi des contraintes internes dans la structure et les désordres qu’elles risquent de provoquer. Le volume protégé profite également de l’inertie thermique importante du plancher lourd.
Non circulable
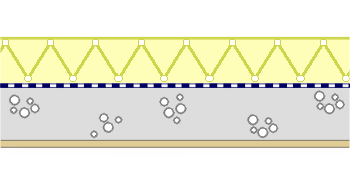
Si le plancher ne doit pas être circulable, tous les isolants en matelas ou en panneaux conviennent.
Si, en outre, la face supérieure du plancher est compliquée ou irrégulière, on préférera les matelas d’isolant souples qui épousent mieux la forme.
Les matelas souples seront idéalement enveloppés d’un papier perméable à la vapeur qui le protège de la poussière.
Circulable
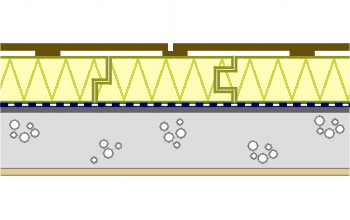
Si le plancher doit être circulable, tous les panneaux rigides conviennent à condition que leur résistance à l’écrasement soit compatible avec les surcharges prévues.
Ils seront ensuite couverts par des plaques de protection constituant l’aire de foulée.
Ces panneaux rigides ne nécessitant pas de lambourdes pour porter l’air de foulée, les ponts thermiques sont évités.
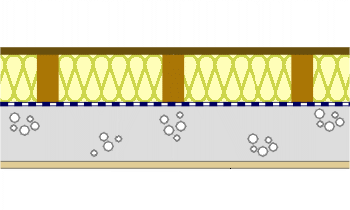
Si pour des raisons économiques ou de protection au feu un isolant semi-rigide ou souple devait être posé, il le serait entre lambourdes. (voir plancher léger, isolation entre gîtes).
Le plancher léger
Non circulable
Isolation sur le plafond entre les gîtes
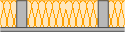
On utilisera idéalement des matelas rigides ou semi-rigides, car ils sont faciles à ajuster et à calfeutrer.
On peut également utiliser des flocons ou granulés. Ils sont plus faciles à poser, mais risquent d’être déplacés avec le temps par des facteurs mécaniques extérieurs (vent, circulation intempestive, rongeurs, oiseaux, …).
Isolation autour des gîtes
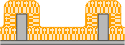
On utilisera exclusivement un matelas souple épousant bien la forme du support. Les matelas souples seront idéalement enveloppés d’un papier perméable à la vapeur qui le protège de la poussière.
Isolation au-dessus du plancher
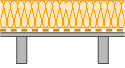
Si le plancher ne doit pas être circulable, tous les isolants en matelas ou en panneaux conviennent.
Si on utilise des panneaux suffisamment résistants, ceux-ci peuvent être recouverts ultérieurement d’une aire de foulée et le plancher des combles serait ainsi rendu circulable, si nécessaire.
Dans ce cas, il ne faut pas oublier de prévoir le pare-vapeur éventuellement requis.
Circulable
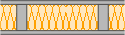
Le plancher léger circulable sera généralement isolé dans son épaisseur pour des raisons d’économies d’espace et de matériaux.
Dans ce cas, on utilisera idéalement des matelas rigides ou semi-rigides, car ils sont faciles à ajuster et à calfeutrer.
Lorsque le plafond est posé avant l’aire de foulée, on peut utiliser des flocons ou granulés. Ils sont faciles à mettre en place.
Dans certains cas lorsqu’il n’y a pas de plafond ou lorsque des appareils volumineux sont encastrés dans celui-ci, on pose l’isolant sur une plaque de support reposant sur le gîtage.
Tous les panneaux rigides conviennent à condition que leur résistance à l’écrasement soit compatible avec les surcharges prévues.
Ils seront ensuite couverts par des plaques de protection constituant l’aire de foulée.
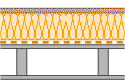
Ces panneaux rigides ne nécessitant pas de lambourdes pour porter l’air de foulée, les ponts thermiques sont évités.
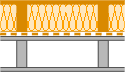
Si pour des raisons économiques ou de protection au feu un isolant semi-rigide ou souple devait être posé, il le serait entre lambourdes. (Voir plancher léger, isolation entre gîtes).
Attention !
Certains isolants sont incompatibles avec d’autres éléments du plancher en contact avec l’isolant.
Par exemple, les mousses de polystyrène sont attaquées par les agents d’imprégnation du bois à base huileuse et par certains bitumes, par les solvants et les huiles de goudron.
Le comportement au feu
Lorsque le support résiste mal au feu (plancher en bois, tôles profilées métalliques), l’inflammabilité de l’isolant joue un rôle important.
Suivant le degré de sécurité que l’on souhaite atteindre, en fonction de la valeur du bâtiment et de son contenu, de son usage, de sa fréquentation, etc., on déterminera le degré d’inflammabilité acceptable pour l’isolant.
Le verre cellulaire et la laine de roche sont ininflammables. Les panneaux à base de mousse résolique ou de polyisocyanurate ont un bon comportement au feu.
Les mousses de polystyrène et de polyuréthane sont inflammables et résistent mal à la chaleur.
La chaleur produite par les spots peut dégrader ces mousses et provoquer des incendies. Si des spots doivent être placés à proximité du panneau isolant (solution à éviter), les mousses doivent être protégées en interposant des boucliers thermiques efficaces.
On veillera également à ce que ce matériau ne dégage pas de gaz toxique lorsqu’il est exposé à la chaleur d’un incendie. C’est notamment le cas de mousses auxquelles ont été rajoutés des moyens retardateurs de feu.
L’impact écologique
Le prix
« Le nerf de la guerre…! »
A performance égale on choisira le matériau le moins cher. Il faut cependant raisonner en coût global, et tenir compte, non seulement du coût de l’isolant mais aussi de sa mise en œuvre.
Lorsqu’ils sont posés dans les planchers, les isolants correctement posés et protégés des agressions extérieures ne nécessitent aucun entretien et leur durée de vie ne pose pas de problème particulier.
Les conseils généraux de mise en œuvre
- L’isolant est mis en œuvre conformément aux prescriptions de son agrément technique.
- L’isolant doit être placé sur toute la surface du plancher sans oublier les éventuelles parties verticales, les trappes d’accès, etc.
- Les joints entre les différents panneaux isolants et entre les panneaux isolants et les gîtes (planchers légers) doivent être bien fermés.
Pourquoi ?
L’air chauffé à l’intérieur d’un bâtiment se dilate. Il devient ainsi plus léger et monte. Il est alors remplacé par de l’air plus froid qui se réchauffe à son tour. Il s’établit ainsi une circulation d’air dans le local. C’est la convection. Dans une toiture, le même phénomène de rotation de l’air peut se développer autour des panneaux isolants si les joints ne sont pas fermés correctement. Il s’en suit des pertes de chaleur importantes et des risques de condensation dus à la vapeur d’eau dans l’air.
- Pour la même raison que ci-dessus et pour éviter les ponts thermiques, l’isolation de l’enveloppe doit être continue. La couche isolante de la toiture doit être raccordée avec les couches isolantes des autres parois du volume protégé.
Par exemple :- L’isolant du plancher doit être en contact avec l’isolant des murs extérieurs et des éventuels murs intérieurs du grenier;
- Il doit être dans le prolongement et en contact avec le dormant du trapillon isolant des accès.
- Il doit être en contact avec l’isolant autour du conduit de cheminée.
- Les panneaux isolants ne peuvent être perforés pour la pose de conduite, etc.
- Les panneaux isolants doivent être protégés et manipulés avec précaution pour éviter les écrasements, les déchirures, l’eau, la boue.