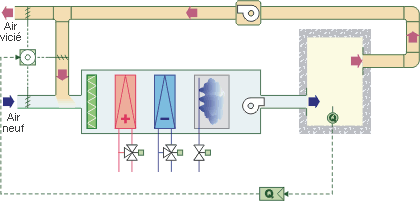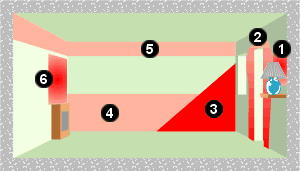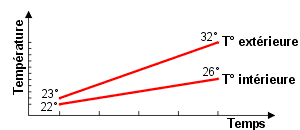Améliorer une climatisation « tout air » à débit constant


Diminution du débit d’air neuf
Moduler le débit d’air neuf en fonction de la présence des occupants et/ou de la température de l’air extérieur
Si le système dispose d’un recyclage de l’air extrait, il est possible de commander l’ouverture du registre d’air neuf en fonction de la présence effective des occupants : sonde de présence, sonde CO2, sonde de qualité d’air, … Le poste « chauffage de l’air neuf » étant le premier poste en terme de consommation de l’installation, on imagine les économies substantielles possibles.
Cette sonde peut également être placée dans la reprise pour bénéficier de la valeur moyenne de plusieurs locaux.
En période de relance, stopper l’air neuf
Également, il est possible de stopper totalement l’arrivée d’air neuf en période de relance du bâtiment (avant l’arrivée des occupants). Cette technique permet de diminuer la puissance installée des chaudières.
Fonctionnement en free cooling
Le taux d’air neuf doit être fonction des températures intérieures et extérieures et des besoins en refroidissement. Ainsi, si en mi-saison, un besoin de refroidissement se fait sentir et que la température extérieure est inférieure à la température intérieure, l’augmentation du taux d’air neuf doit permettre de valoriser le pouvoir rafraîchissant de l’air extérieur: c’est le « free cooling ».
Le registre d’air neuf peut donc s’ouvrir soit pour apporter l’air neuf minimal, soit pour refroidir l’ambiance. Le régulateur de qualité d’air devra être informé de la demande du régulateur de température et il prendra la demande la plus exigeante pour agir sur le servo-moteur du registre d’air neuf.
Vérifier le fonctionnement en free-cooling de l’installation

L’avantage indiscutable d’une installation à air est de pouvoir valoriser l’air frais gratuit extérieur. Il sera donc très utile de vérifier que le fonctionnement de la régulation ouvre à 100 % les registres d’air neuf lorsque la température extérieure est inférieure à la consigne ambiante et que le local est en demande de froid.
Voici comment devrait se comporter la régulation.
Le débit d’air neuf pulsé doit être établi sur base de la comparaison des températures extérieures, intérieures ambiantes et intérieures de consigne, avec le maintien d’un taux minimum hygiénique ou mieux encore établi sur base de la comparaison des enthalpies de l’air intérieur et de l’air extérieur :
- Lorsque la température intérieure ambiante est inférieure à la température de consigne, le taux d’air neuf doit être maintenu au minimum hygiénique qui peut être variable en fonction du taux d’occupation.
- Lorsque la température intérieure ambiante est supérieure à la température intérieure de consigne et que la température extérieure est inférieure à la température intérieure ambiante, l’augmentation du débit d’air neuf doit être prioritaire au fonctionnement de la batterie froide.
- Lorsque la température intérieure ambiante est supérieure à la température intérieure de consigne et que la température extérieure est supérieure à la température intérieure ambiante, le taux d’air neuf est ramené au minimum hygiénique.
Réhabiliter le système
Réhabiliter un système classique à débit constant en système à débit variable.
Les installations « tout air » à débit constant sont extrêmement coûteuses suite au risque de produire simultanément du chaud et du froid (dans les systèmes multizones), mais aussi suite à la consommation électrique des ventilateurs fonctionnant à vitesse constante : entre 10 et 30 % de l’énergie transportée. Il suffit d’imaginer le moment où le bâtiment est sans demande, que de l’air à 22° est pulsé… avec un débit correspondant à celui calculé pour vaincre la pire période caniculaire !
Le principe du VAV (débit d’air variable) est nettement plus efficace.
Son application est sans doute fort coûteuse : rénovation des bouches de distribution, adaptation de la vitesse variable aux ventilateurs de pulsion et d’extraction, renouvellement de la régulation… Si le régime de haute pression, autrefois nécessaire pour le fonctionnement des bouches terminales, n’est plus automatiquement requis, le bilan financier risque d’être lourd.
On peut imaginer qu’une réflexion globale s’impose et que les avantages des autres types de systèmes doivent alors être étudiés.
| Pour en savoir plus sur la climatisation des bureaux, les critères de choix généraux entre systèmes. |
Si un de nos lecteurs a réalisé ce type de rénovation, nous serions heureux de pouvoir être informés de son expérience.
Réhabiliter un système classique à deux conduits à débit constant en système à débit variable.
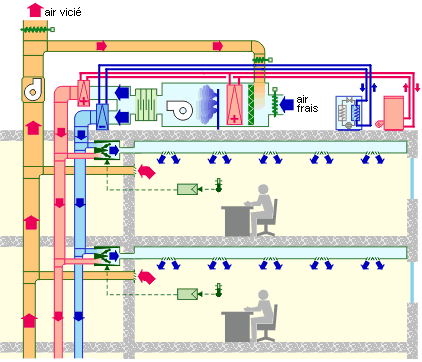
La technique de climatisation en « dual duct » schématisée ci-dessus est très énergivore. Il est opportun d’envisager sa rénovation. Une technique possible est de la transformer en système VAV à deux conduits.
En pratique :
- La variation de débit est faite uniquement sur l’air froid.
- Lorsque les apports calorifiques sont maximaux, le volet d’air froid est ouvert à 100% alors que le volet d’air chaud est fermé.
- Lorsque les apports diminuent, le débit d’air froid diminue jusqu’à un débit minimum de soufflage.
- Lorsque des besoins de chauffage apparaissent, on ouvre le volet d’air chaud et on mélange alors l’air froid et l’air chaud comme dans un système classique à deux conduits (l’air froid est à ce moment de l’air extérieur « gratuit »).
Si tout n’est pas résolu, la consommation d’énergie est diminuée par ce système.
Différents schémas sont présentés dans le tome 4 de la collection « climatisation et conditionnement d’air » de Bouteloup aux éditions CFP.
Remarque : dans tous les cas, il y a lieu de bannir la simultanéité d’utilisation d’air chaud et d’air froid. En période de refroidissement partiel, l’air correspondant à la gaine « chaude » ne doit être que de l’air recyclé, la batterie de chauffe ne pouvant pas être sollicitée.
Optimaliser la régulation par point de rosée
Souvent les groupes de traitement d’air (simple ventilation, groupe CAV ou VAV) équipés d’un humidificateur à pulvérisation ou à ruissellement sont régulés suivant le principe dit du « point de rosée« .
Cette régulation est tout à fait correcte en hiver, mais pose des problèmes en mi-saison et en été, avec des consommations d’énergie importantes. Il arrive de rencontrer des installations où humidification et batterie froide fonctionnent simultanément…
Reprenons les solutions déjà mentionnées dans l’ « amélioration de l’humidificateur » :
- Dans un premier temps, il importe d’abaisser la température de rosée en hiver et de la relever en été. Cela peut s’imaginer manuellement ou automatiquement par la régulation.
- On peut également stopper le fonctionnement de la batterie froide pour des besoins de déshumidification en commandant la batterie froide en fonction des besoins de l’ambiance uniquement.
- On peut limiter le temps de fonctionnement de l’humidificateur en le commandant en tout ou rien sur base d’un hygrostat dans l’ambiance ou placé dans l’extraction. Des légères fluctuations d’humidité et de température se produiront cependant dans le local.
- On peut étudier la possibilité de travailler à débit d’eau variable, notamment à partir d’un humidificateur rotatif …
- Puisque le laveur d’air ne pose pas de problèmes en hiver, il reste la solution d’imposer un arrêt total de l’humidification au-dessus d’un seuil de température extérieure : de 5°C à 8°C, par exemple. Le respect d’une consigne fixe de 50 % HR ne pourra plus être assuré, mais l’occupant d’un bureau ne s’en rendra pas compte, puisque le confort est assuré dès 40 % HR …
| Pour plus de détails sur l’analyse d’une régulation par point de rosée. |